Colère
Triste vendredi 13 ou La honte d'appartenir à la race humaine
- Par Liliane Schraûwen
- Le 18/11/2015
- Commentaires (4)
- Dans Actualité
 La négation de l'humanité. Des bêtes sauvages. Pire, en réalité, car les animaux, même les plus féroces, ne tuent que pour se nourrir ou se protéger. Ceci n'a pas de nom.
La négation de l'humanité. Des bêtes sauvages. Pire, en réalité, car les animaux, même les plus féroces, ne tuent que pour se nourrir ou se protéger. Ceci n'a pas de nom.
Qu'est-ce donc que ces crapules malfaisantes, ces rebuts de la race humaine, ces abrutis dénués de la moindre étincelle de raison, qui s'attachent à ainsi massacrer leurs semblables, gratuitement, stupidement, connement ? Il faudrait créer pour eux des adjectifs et des adverbes qui n'existent dans aucune des langues parlées par les hommes, des mots nouveaux pour définir le degré d'abjection imbécile où ils descendent. Il me semble que c'est la première fois dans l'Histoire (du moins à ma connaissance) que l'on tue sans même feindre de s'appuyer sur une quelconque raison ni justification, même ignoble et absurde. Par le passé, on n'a pas cessé de tuer, massacrer, exterminer, éventrer, génocider, sous toutes sortes de prétextes, tant la barbarie est universelle et inventive. On a assassiné de prétendus adversaires, des soldats enrôlés dans une armée ennemie, des combattants d'une cause injuste, des envahisseurs, des bourreaux ; on l'a fait pour punir un crime réel ou imaginaire, on l'a fait parce que les cibles étaient censées appartenir à une « race », à un peuple honni, à une religion qui n'était pas la bonne, à une communauté, une caste, une classe sociale ; on a décimé les rois et les princes, les riches, les nobles, les curés et les bonnes sœurs en ces mêmes lieux où aujourd'hui… On a massacré des noirs parce qu'ils étaient noirs, des blancs parce qu'ils étaient blancs, des rouges parce qu'ils étaient rouges… On a trucidé des gens parce qu'ils étaient des dirigeants, des responsables politiques, des leaders... Bref, l'homme a toujours tenté de rationaliser sa bestialité, de lui donner une vague apparence de cohérence.
Aucun de ces meurtres, qu'ils fussent collectifs ou individuels, n'était bien sûr admissible. Mais du moins ceux qui les commettaient répondaient-ils à une certaine logique. Logique absurde et inepte, mais logique quand même. Les milliers de disparus du 11 septembre 2001, les centaines de milliers de morts du Rwanda, les millions de victimes du nazisme et tous les autres qui, tout au long de l'aventure humaine, ont été exterminés en masse, étaient visés pour d'inacceptables raisons, certes, mais d'une certaine manière ils étaient « ciblés », chosis, désignés. On mourait parce qu'on était juif, parce qu'on était arménien ou tutsi, parce qu'on appartenait à la race du « Grand Satan » américain, parce qu'on descendait de quelque ancienne et noble famille… Bref, on mourait sans raison, mais du moins les assassins faisaient-ils mine de justifier leurs atrocités et le choix de leurs victimes. Déjà, à ce stade, la barbarie a atteint des paroxysmes que l'on a peine à imaginer, et l'on en vient à avoir honte de faire partie de cette engeance, la plus nuisible de toutes, la plus malfaisante et la plus dangereuse, celle des hommes. L'on se dit que rien de pire ne pourrait arriver, jamais. Que certaines horreurs ne pourront pas être dépassées, ni même reproduites. De nouveaux génocides pourtant ont eu lieu, de nouveaux camps de torture et d'extermination se sont ouverts, des murs se sont édifiés, des enfants continuent d'être enrôlés dans d'improbables armées d'assassins, des femmes sont journellement kidnappées, violées, réduites au rang d'esclaves sexuelles. Tout continue, au nom de la race, de l'argent, d'une prétendue société idéale. Au nom de Dieu aussi, souvent.
Mais ceci… Un nouveau degré dans l'abjection a été franchi. Ce n'est pas le nombre des victimes qui me bouleverse (même si...), c'est le hasard absurde qui a présidé à leur massacre. Aucun prétexte cette fois. Des gens qui mangent, assis à une terrasse, un vendredi soir, ou qui prennent un verre. D'autres qui dansent et s'amusent dans une salle de concert. Fauchés comme ça, sans raison, juste parce qu'ils étaient là. Des jeunes, des moins jeunes, des Français « de souche », des Français plus exotiques, des touristes, des gens comme vous et moi. Indistinctement. Des amateurs de musique ou de foot, des croyants adeptes de je ne sais quel Dieu qui décidément prouve chaque jour son inexistence, d'autres qui se fichent bien des questions métaphysiques. Des gamins tirent dans le tas comme on joue à la guerre sur une console de jeux. Le sang coule, du vrai sang. Les meurtriers crient le nom d'Allah puis se font exploser en un atroce bouquet final. Des enfants, eux aussi. À chaque nom, à chaque photo de ces cinglés que diffusent les médias, je tremble à l'idée de découvrir le patronyme ou le visage de l'un de mes anciens étudiants… Mais qu'est-ce qu'on leur a fait, à ces gosses qui ont grandi ici, qui ont fréquenté nos écoles, qui ont joué dans les rues de chez nous ? Comment fait-on pour ainsi détruire un cerveau humain, pour transformer des jeunes gens à peine sortis de l'adolescence en bêtes malfaisantes et folles ?
Et leur Allah, qu'attend-il donc pour les foudroyer ? Ce Dieu que des milliards d'individus invoquent chaque jour : Seigneur, aide-moi, protège mes enfants, rends-moi meilleur, sauve-moi, éloigne de moi la maladie et la tentation, toi qui es « notre père » à ce qu'on dit. Où se cache-t-il ? Celui qui paraît-il ne permet pas que tombe le moindre cheveu de notre tête, ce Yavhé, cet Allah, ce Dieu qui toujours est du côté des plus forts, ce Gott mit uns, et qu'importe le nom qu'on lui donne, que fait-il d'autre que démontrer, jour après jour, sa définitive absence ? Et, même s'il n'existe pas, comment peut-on se revendiquer de lui pour violer, pour décapiter, pour massacrer, pour s'abaisser plus bas que le plus laid, le plus monstrueux, le plus nuisible des animaux ?
Ce qu'ils font, ces dégénérés répugnants, c'est détruire l'humanité dans les plus faibles et les plus innocents de ses représentants, tout comme ils s'acharnent à détruire la mémoire des siècles, à anéantir toute trace de la pensée, de la beauté et de l'intelligence humaine en dynamitant temples et statues.
Voulez-vous que je vous dise ? J'ai honte. Honte d'appartenir à cette race, la seule qui sur la surface de la Terre soit capable de telles atrocités. Et je me prends à songer que, lorsque les dauphins, les rats ou les fourmis auront pris notre place sur cette planète que nous nous acharnons à saccager comme tout ce que nous touchons, ce ne sera pas une grande perte. Car l'univers sera meilleur et plus beau quand nous n'y serons plus.
Les ruines de l'Histoire humaine
- Par Liliane Schraûwen
- Le 26/05/2015
- Commentaires (2)
- Dans Actualité

« Syrie - Palmyre : défaite d'une civilisation » titrait ce lundi 25 mai 2015 Ravanello dans son blog. Mais non, ai-je envie de lui répondre. Ce n'est pas la défaite d'une civilisation. C'est la défaite de LA civilisation. L'échec, l'agonie, la mort peut-être, de ce qui fonde notre humanité. La destruction de ce que nous sommes, la négation de notre origine commune, le saccage de ce lieu hors du temps et de l'espace d'où nous venons tous.
J'ai vu Rome et Athènes, Mycènes, Corinthe, j'ai vu la Crète… Je n'ai pas vu Palmyre, et sans doute je ne la verrai jamais. Palmyre la Sémite, la Grecque, la Romaine. Palmyre l'universelle, oasis de beauté et de culture dans un désert. Trace miraculeuse de ce qu'ont construit et rêvé les hommes quand les dieux parfois se promenaient parmi eux, tellement humains, tellement proches de nous, avec leurs amours et leurs querelles, avec leurs visages semblables aux nôtres. Là-bas, au cœur d'un désert inconnu, non loin du mythique jardin d'Eden, une ville somptueuse s'est édifiée que ses dieux jusqu'ici avaient voulu protéger. Afin sans doute que nous puissions quelquefois nous retourner vers un passé de rêve et de beauté. Vers un monde où c'est au glaive que les hommes se battaient, avec courage et force. Marc-Antoine a voulu la détruire, puis les Perses, puis Tamerlan... Mais les dieux veillaient, les anciens et les nouveaux, qui en ce temps-là vivaient en bon voisinage. Quelques temples furent convertis en églises, où l'on continua d'invoquer la divinité. Les musulmans s'y installèrent au VIIe siècle, sans rien saccager, plus sages que les barbares qui prétendent aujourd'hui servir le même dieu, et qui en son nom massacrent et asservissent leurs semblables, et détruisent tout ce qui sans doute les rappelle à leur incurable stupidité, à cette bestiale sauvagerie que Cro-Magnon et Néandertal eux-mêmes auraient désavouée.
Qu'est-ce donc que ce monde où l'on tue sans vergogne ceux qui pensent autrement, ceux qui prient (ou ne prient pas) dans une langue qui n'est pas celle de l'un ou l'autre texte prétendument sacré ? Qu'est-ce que cette société où l'on massacre ceux qui donnent à leur Dieu un nom qui n'est pas le bon, ceux surtout qui, au spectacle de la vie comme elle va, se disent que Dieu, justement, n'existe pas. Car s'il existait, ne devrait-il pas les foudroyer, tous ces déments qui en son nom répandent la mort et la bêtise ? Ceux qui détruisent la vie mais aussi la pensée, la beauté et l'art qui pourtant ne sont rien d'autre qu'un éternel mouvement vers Lui qui continue de se taire et se cacher.
Qu'est-ce donc que cet univers où l'on enlève des femmes, des jeunes filles, des collégiennes, pour en faire des esclaves sexuelles ? Qu'est-ce que ce monde dans lequel on enrôle des petits garçons pour en faire des machines à tuer, pour leur apprendre à jouer avec de vrais fusils, a mourir dans de vraies guerres, à devenir à leur tour de vraies bêtes à peine humaines ?
Des fous et des imbéciles, des psychopathes et des assassins, des crétins incultes et des égorgeurs fanatiques, des bourreaux sadiques et des abrutis sans conscience, il y en a toujours eu, hélas. Sous toutes les latitudes, à toutes les époques, au cœur de toutes les croyances. Rien de vraiment neuf donc, sinon l'ampleur incroyable que prend aujourd'hui la catastrophe. Car la technique moderne, celle des armes et celle des médias, fait que la cruelle imbécillité de ces barbares couverts de sang se répand plus vite que l'éclair et plus loin que le vent. Et qu'ils font des émules.
Nos enfants s'en vont mourir au soleil en rêvant d'un paradis où les attendent je ne sais combien de vierges qu'ils pourront impunément violer tout comme ils auront violé, ici-bas, les femmes et les filles trouvées sur leur route. Nos enfants s'en vont tuer, là-bas ou chez nous, pour étendre sur la Terre le règne d'un Dieu plus terrible et monstrueux que Baal, Moloch et Satan lui-même. On leur offre un idéal de violence et de force, à eux qui vivent dans un univers où l'idéal n'existe plus depuis longtemps. On leur parle de force et non d'amour, de puissance et non de fraternité, de domination, de pouvoir, de la supériorité d'une croyance sur les autres tout comme, jadis, on avait prêché la supériorité d'une race. Alors ils se font exploser dans les marchés, les temples ou les mosquées, emmenant avec eux au paradis qui n'existe pas les âmes innocentes de centaines d'infidèles qui se contentaient de vivre, d'aimer leurs enfants, de regarder le ciel et les nuages en se disant que la vie sur notre Terre peut être jolie, malgré la faim et la misère quelquefois. Ils sèment le feu et la terreur en tout lieu où ils passent, eux qui ont été des petits garçons aux cheveux bouclés que pourtant nous avons bercés de rêves et nourris du lait de notre amour. Ils s'en vont détruire les traces merveilleuses de l'intelligence humaine partout où ils les trouvent, ils s'en vont effacer les souvenirs mêmes de l'art, de la pensée, de la beauté.
Des animaux, voilà ce qu'ont fait d'eux leurs croyances imbéciles et leurs prêcheurs fous. Des bêtes plus sauvages et plus cruelles que les grands fauves d'Afrique ou d'Asie qui, eux, ne tuent que pour se nourrir. Des animaux, oui, plus primitifs et plus nuisibles qu'aucune autre de ces espèces créées par Dieu et sauvées par Noé, du moins si l'on en croit les textes. Et je me dis, en me souvenant de cette histoire, qu'un nouveau déluge serait le bienvenu, sélectif cette fois, qui noierait comme des rats cette engeance de faux prophètes dont la seule philosophie se lit non pas dans les pages de quelque bible ou de quelque coran, et moins encore dans celles d'Averroès ou d'Avicenne, mais dans le feu de leurs kalachnikovs. Que fais-tu donc, Dieu silencieux ? Pourquoi ne les punis-tu pas, ces malades qui te blasphèment – si tu existes – bien plus que les dessins des uns, les églises ou les synagogues des autres ?
En attendant ce peu probable châtiment, Le Monde m'apprend que « dans Palmyre contrôlée par l'EI, l'épuration a commencé » et que « l'armée d'Assad bombarde Palmyre, tenue par l'État islamique ». Et c'est la culture et l'histoire qui, sans fin et sans espoir, se débattent dans les douleurs d'une interminable agonie.
Voulez-vous que je vous dise ? Quand reviendra le Déluge, je ne crois pas que j'aurai envie de monter dans l'arche. Car je n'ai pas vraiment le goût de vivre dans ce monde détruit, parmi les ruines de l'Histoire humaine.
Écrivain, un métier ?
- Par Liliane Schraûwen
- Le 28/03/2015
- Commentaires (0)
- Dans Colère
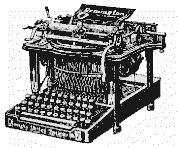 Voulez-vous que je vous dise ? Il y a des moments où ce que d'aucuns appellent « le métier d'écrivain » est bien déprimant. Et cela même si, je le maintiens, ce n'est pas un métier, puisque ce terme désigne, selon le Robert, un genre de travail déterminé (…) et dont on peut tirer ses moyens d'existence (renvoi à « gagne-pain »). L'écriture, à mon sens, est donc tout autre chose qu'un métier, sauf sans doute pour ceux qui, justement, la pratiquent dans l'optique de gagner leur vie, voire de s'enrichir. De ceux-là, on peut d'ailleurs dire qu'ils ont du métier : ils appliquent des recettes, vont au plus efficace, sont passés maîtres dans l'art d'utiliser et parfois de manipuler les médias. Ils « vendent », et proposent chaque année à leur fidèle clientèle un produit neuf mais aussi prévisible qu'attendu. Ils pratiquent en quelque sorte le fastfood de l'écriture : ouvrage attirant, bien présenté, ciblé, conçu pour plaire au plus grand nombre, vite absorbé, vite oublié… Mais sans cette touche de génie ou cette saveur unique qui font la grande cuisine. Sans aucun style, en vérité.
Voulez-vous que je vous dise ? Il y a des moments où ce que d'aucuns appellent « le métier d'écrivain » est bien déprimant. Et cela même si, je le maintiens, ce n'est pas un métier, puisque ce terme désigne, selon le Robert, un genre de travail déterminé (…) et dont on peut tirer ses moyens d'existence (renvoi à « gagne-pain »). L'écriture, à mon sens, est donc tout autre chose qu'un métier, sauf sans doute pour ceux qui, justement, la pratiquent dans l'optique de gagner leur vie, voire de s'enrichir. De ceux-là, on peut d'ailleurs dire qu'ils ont du métier : ils appliquent des recettes, vont au plus efficace, sont passés maîtres dans l'art d'utiliser et parfois de manipuler les médias. Ils « vendent », et proposent chaque année à leur fidèle clientèle un produit neuf mais aussi prévisible qu'attendu. Ils pratiquent en quelque sorte le fastfood de l'écriture : ouvrage attirant, bien présenté, ciblé, conçu pour plaire au plus grand nombre, vite absorbé, vite oublié… Mais sans cette touche de génie ou cette saveur unique qui font la grande cuisine. Sans aucun style, en vérité.
Mes anciens étudiants se souviennent, je l'espère, des cinq critères qui, selon moi, permettent de reconnaître ce que j'appelle « le véritable écrivain ». Petite révision en cinq points :
- Un véritable écrivain est toujours mû, à mon sens, par un besoin quasi pathologique d'écrire. Et quand j'emploie le mot « pathologique », ce n'est pas une figure de rhétorique.
- Il doit, consciemment ou le plus souvent inconsciemment, avoir créé un univers qui est caractéristique, identifiable, que l'on retrouve d'œuvre en œuvre, de livre en livre.
- De même, ce que j'appelle « le vrai écrivain » a-t-il une thématique qui lui est propre. Là aussi, c'est un phénomène qui sans doute n'est pas voulu, qui n'est pas conscient. Mais lorsqu'on se penche sur l'œuvre d'un grand auteur, on y retrouve quelques thèmes, toujours les mêmes, qui la traversent et la sous-tendent.
- Il possède également un style reconnaissable entre tous, qui le définit et qui fait partie de lui. Un style qui fait que lorsqu'on lit quelques pages de lui, on se dit quelque chose comme « on dirait du Le Clézio »… « Si ce n'est pas lui, c'est un excellent imitateur… ».
- Enfin, bien sûr, (et c'est le minimum), il doit maîtriser la langue dans laquelle il s'exprime.
Chacune de ces conditions est nécessaire mais pas suffisante : c'est la conjonction de ces cinq caractéristiques qui seule fait l'écrivain, le vrai, au sens que je donne à ce terme. Je n'ai pas dit « le bon écrivain », car nous entrons là dans des critères subjectifs et donc discutables.
Vous remarquerez que je n'ai pas inclus dans ma liste la gloire, le succès médiatique, le tirage ou le chiffre des ventes. Certes, ces éléments quelquefois viennent couronner l'un ou l'autre élu, et c'est heureux. Dans certains cas, cela se produit même de son vivant. On peut citer, dans le passé, les Hugo, Dumas, Gide, Mauriac et, plus près de nous, le merveilleux Le Clézio (merci l'académie Nobel) et autres Laurent Gaudé ou Dany Laferrière... Mais à côté de ceux-là, combien de Verlaine, de Balzac et d'autres, morts dans la misère ou vivant dans l'anonymat et la précarité ?
Car il faut avouer que gloire et argent privilégient plus souvent les ex de présidents, ceux qui cultivent le scandale ou la provocation, ceux qui défendent des thèses indéfendables, ceux qui gravitent parmi les people, les « fils ou cousins de… », sans compter tous ceux qui ont trouvé un filon ou une recette et l'appliquent avec régularité : un tiers de suspense, trois dixièmes d'exotisme, une larme de fantastique, une louche d'érotisme, moins de trois pour-cent de descriptions, beaucoup de dialogues, un assortiment de lieux communs, un vocabulaire simpliste et restreint, un nombre de pages limité… Afin de ne pas me faire d'ennemis, je ne citerai pour exemples que l'un ou l'autre auteur aujourd'hui tombé dans l'oubli, mais ayant joui en leur temps d'une renommée et d'un compte en banque intéressants, tels Guy des Cars, Georges Ohnet ou Pierre Benoît. De nos jours, il y a bien sûr les romans publiés par Harlequin dont, d'ailleurs, les auteurs doivent se plier à des impératifs précis et entrer dans une grille préétablie. Et aussi plusieurs prétendus « écrivains » que je ne nommerai pas…
Et puis il y a les autres, tous ceux pour qui décidément on ne peut pas dire que l'écriture soit un métier… Qu'est-elle donc pour eux ? Une passion peut-être, un genre de vie ou de survie, un art, une maladie, une addiction, un besoin… Je suis ouverte à toutes les propositions. Pour l'un de mes anciens contrôleurs fiscaux, c'est même un hobby (si si, ce n'est pas une blague, comme le macramé ou le coloriage).
Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que la grande majorité des écrivains sont aujourd'hui bien mal traités (bel oxymore, pas vrai ?) par leurs contrôleurs fiscaux, par la presse, par tous les « métiers » de la chaîne du livre (quand leurs créations trouvent éditeur et deviennent ainsi un vrai livre). Sauf exceptions, et nous en connaissons tous car, oui, il existe de vrais écrivains et même de vrais éditeurs.
Pourquoi cette forme de mépris ou de méconnaissance ? Parce que les gens qui pratiquent ces métiers, de l'éditeur au libraire en passant par toutes les étapes intermédiaires, ont pour but, justement, de gagner de l'argent, alors que le malheureux artiste ne songe quant à lui qu'à s'exprimer le mieux possible, qu'à créer une œuvre d'art (dans le meilleur des cas), qu'à mettre un peu de beauté ou d'humanité, voire un peu de pensée et de conscience, dans notre triste univers…
C'est pour cette raison que le métier d'écrivain est quelquefois bien déprimant. Avez-vous la moindre idée de ce que coûte, en temps (parfois ce sont des années), en efforts de toute sorte, en hésitations, en doutes, en nuits blanches et en bien d'autres choses, la conception d'une œuvre que son auteur, finalement, juge digne d'être montrée ? Un éditeur alors reçoit le manuscrit. Il le lit, il l'apprécie, il y croit (dans le meilleur des cas, car ce n'est pas fréquent). Il prend des risques, lui aussi, décide de le publier. Enfin ce texte existe vraiment, enfin il est devenu un livre, l'un de ces objets à faire rêver, à émouvoir, à faire réfléchir, à faire rire. Et l'auteur alors se prend à rêver à son tour. Par la magie de son écriture, il va toucher des inconnus, quelque part en terre de francophonie. On va le lire, l'aimer peut-être, le comprendre, vibrer à ce monde qu'il a créé. Un dialogue va s'instaurer entre un inconnu et lui, à travers ces pages qui ont germé au plus profond de ce qu'il est.
Mais pour que ce livre arrive entre les mains de l'inconnu fantasmé, pour que celui-ci ait la moindre chance de le découvrir et peut-être de l'apprécier, encore faut-il qu'il en ait connaissance. Qu'il puisse le voir, posé sur l'étal d'une librairie, le feuilleter. Qu'il en ait entendu parler ne serait-ce que par un seul critique, dans les pages du supplément littéraire d'une obscure feuille de chou ou d'un grand quotidien. Mais non… Rien. L'éditeur a pourtant envoyé un peu partout ces fameux services de presse qui s'accumulent dans la poussière des salles de rédaction. L'auteur les a consciencieusement signés, dédicacés, cherchant la petite phrase originale ou sympathique. Mais rien. Les critiques sans doute préfèrent commenter les « incontournables » dont parlent tous leurs confrères, signaler cinquante nouvelles nuances de je ne sais quelle couleur douteuse, attirer l'attention sur un nouveau livre à scandale… Et le pauvre « petit » auteur reste dans l'ombre, à noircir du papier, sans grand espoir d'être jamais lu.
De la colère dans mon propos, ou plus bassement de l'envie, de la jalousie ? Mais non… Juste une certaine amertume. S'il s'agit de moi, il s'agit aussi de nombre de mes confrères en écriture. De vrais écrivains pourtant. Mais il leur manque sans doute quelque chose comme « des relations », un bon carnet d'adresses, un réseau, que sais-je… Alors, dites-moi, c'est cela, aujourd'hui, être écrivain ? C'est être prêt à tout pour décrocher une interview quelque part, c'est consacrer à « faire la pute » du temps volé à l'écriture ? Il y aurait de quoi sombrer dans le découragement, vous ne croyez pas ? Et dans le silence…
To be or not to be Charlie ? – Les larmes du Prophète
- Par Liliane Schraûwen
- Le 15/01/2015
- Commentaires (0)
- Dans Actualité
 Un journal existait, que je n'aimais pas beaucoup, tout comme je n'avais pas aimé son prédécesseur Hara-Kiri. Parce que je n'apprécie ni la vulgarité ni la provocation gratuite. Ni la gaudriole exacerbée. Ni l'humour potache, ni la mise en scène d'obsessions scabreuses. Question de goût. Du temps que mes parents étaient libraires, j'ai quelquefois feuilleté ces magazines, l'un puis l'autre, et aussi à l'occasion de certains événements particuliers. Sans plaisir, en général, même si quelques-uns de leurs dessinateurs avaient un vrai talent, tel Cabu dont « Le grand Duduche » avait fait mes délices il y a longtemps, si longtemps. Trop longtemps.
Un journal existait, que je n'aimais pas beaucoup, tout comme je n'avais pas aimé son prédécesseur Hara-Kiri. Parce que je n'apprécie ni la vulgarité ni la provocation gratuite. Ni la gaudriole exacerbée. Ni l'humour potache, ni la mise en scène d'obsessions scabreuses. Question de goût. Du temps que mes parents étaient libraires, j'ai quelquefois feuilleté ces magazines, l'un puis l'autre, et aussi à l'occasion de certains événements particuliers. Sans plaisir, en général, même si quelques-uns de leurs dessinateurs avaient un vrai talent, tel Cabu dont « Le grand Duduche » avait fait mes délices il y a longtemps, si longtemps. Trop longtemps.
Il existe bien des organes de presse, bien des romans aussi, et des films, et des idées politiques, et des positions philosophiques, et même des croyances prétendument religieuses, et bien d'autres choses encore, que je n'apprécie pas, auxquelles je n'adhère pas. Comme il existe des gens que je trouve tout à fait déplaisants. Ces gens-là, je ne les fréquente pas. Je m'efforce de ne pas les croiser, de les rencontrer le moins possible, mais je ne m'empare pas d'une arme pour les tuer. De même, ces revues, ces magazines, ces livres, ces films, je ne les achète pas, je ne les lis pas, je ne les regarde pas. Les idées qui me semblent fausses ou dangereuses, je les combats par la parole, par l'écriture. Je les combattrais par le dessin si je savais dessiner. Ou je les ignore. C'est ainsi qu'il faut faire, quand quelque chose ou quelqu'un ne nous plaît pas, pour de bonnes ou de mauvaises raisons : on l'évite ou on le conteste.
Je conçois volontiers que tout le monde ne partage pas mon avis. J'admets que d'autres aiment des gens que moi, je juge imbuvables. J'accepte que quelques-uns de mes contemporains aient d'autres goûts que les miens, d'autres idées que les miennes, d'autres croyances et d'autres refus, d'autres moyens d'expression… J'avoue d'ailleurs que certains des dessins de Charlie Hebdo m'ont fait rire et, quelquefois, m'ont amenée à réfléchir. Grossiers parfois, vulgaires souvent, provocateurs presque toujours, mais talentueux, aucun doute là-dessus. Et l'outrance et la caricature ont au moins le mérite de mettre en lumière certains ridicules, certaines hypocrisies, certains travers de notre société. Dénoncer ces travers par le biais de l'humour, même si cet humour n'est pas toujours de bon goût, c'est quand même beaucoup mieux que le faire par la violence, qu'elle soit verbale ou physique, ou par le meurtre.
Les gars de Hara-Kiri et de Charlie Hebdo, c'étaient des sales gamins qui n'avaient pas su grandir. Des adolescents prolongés, des soixante-huitards attardés, des anarchistes sans bombes. Ils n'avaient pas tort sur tout. Ils n'avaient pas non plus raison sur tout. Bien sûr, j'avais le droit de ne pas aimer ce qu'ils publiaient, tout comme j'ai le droit, aujourd'hui, de le dire. Mais ils avaient le droit, eux, de s'exprimer à leur façon, bonne ou mauvaise, et le public avait le droit de les lire, de les admirer ou de les rejeter, de les critiquer. Surtout, ils avaient le droit de vivre.
Sarkozy, pour ne pas varier dans ses habitudes, y est allé de son petit couplet sur la civilisation et la barbarie. Qu'est-ce donc que la civilisation, me suis-je demandé ? Qu'est-ce qui la distingue de cette barbarie sauvage qui conduit deux individus à massacrer des hommes dont le seul tort est de publier des dessins satiriques, pendant qu'un troisième s'en va tuer du juif pour la simple raison qu'il est juif ? Pourquoi ne pas tuer du noir parce qu'il est noir, de l'indien parce qu'il est indien, de l'arabe parce qu'il est arabe, du flamand, du wallon, du jeune, du vieux, du blond, du roux, du n'importe quoi ou du n'importe qui, juste parce qu'il est ce qu'il est ? Du flic parce qu'il est flic, par exemple, même s'il se prénomme Ahmed et qu'il est musulman.
Massacrer des êtres pour ce qu'ils sont : voilà une idée qui n'est pas neuve, et qui a connu déjà un certain succès en bien des lieux. En Arménie au début du vingtième siècle, dans toute l'Europe dans les années 40, au Rwanda dans les années 90, au Cambodge, en Tchétchénie, en Bosnie… et la liste n'est pas exhaustive. Comme quoi la barbarie n'a pas de couleur, pas de nationalité, et moins encore de religion. La France elle-même, qui aime tant à se définir par « les valeurs de la République » et se définir comme « la patrie des droits de l'homme » devrait se souvenir qu'elle s'est construite, cette république, sur un bain de sang que l'Iran des Ayatollah n'eût pas renié. Combien de gens coupés en deux au terme de pseudo procès, pour la seule raison qu'ils étaient prêtres ou portaient un nom à particule ? C'était il y a plus de deux siècles, me direz-vous. Certes. Vichy, par contre, et le Vel d'Hiv, c'est plus récent. Tout comme l'Allemagne nazie. Croyez-moi, nul n'est à l'abri, nul ne peut se proclamer juste ou pur. Les victimes d'hier sont quelquefois les bourreaux d'aujourd'hui. La barbarie nous guette tous, elle sommeille en chacun de nous. C'est là qu'il faut la combattre d'abord, et ce combat-là, peut-être est-ce seulement ce que l'on appelle la civilisation qui peut le mener.
Qu'est-ce donc que la « civilisation » ? me demanderez-vous. Sans doute existe-t-il bien des manières de la définir. Il me semble, quant à moi, que l'un de ses aspects essentiels réside dans le respect des lois (des lois justes, s'entend). Dans le respect des droits de l'homme en général, et dans le respect de ce que l'on appelle (et ce n'est pas un hasard) « LE droit ». Or l'un des droits fondamentaux de tout pays civilisé, c'est-à-dire de tout pays démocratique, sous quelque latitude qu'il se situe, est bien la liberté d'opinion et d'expression, qui ne peut évidemment être dissociée de la liberté de la presse. Un organe de presse ou même un particulier doivent jouir de la liberté totale et absolue de s'exprimer, pour autant qu'ils restent dans le cadre de la loi. Ce sont les tribunaux qui ont à intervenir lorsqu'un journaliste, un artiste, un simple citoyen, publient (même si ce n'est « que » sur face book) des textes ou des images contraires à la loi, tels des propos racistes ou constituant une incitation à la haine ou au meurtre. Et j'en ai vu beaucoup, de ces jours-ci, bien plus graves et dangereux que les dessins de « Charlie ».
Vous n'aimez pas Charlie Hebdo ? Fort bien, je ne l'aime pas non plus. Faites donc comme moi : ne l'achetez pas. Vous le jugez choquant, insultant, blasphématoire par rapport à ce qui constitue VOTRE code de conduite, votre orientation philosophique, vos croyances religieuses ? Vous en avez le droit, et je puis vous comprendre. Vous estimez que tel ou tel de ses collaborateurs va vraiment trop loin ? Déposez plainte contre lui, et laissez les tribunaux faire leur travail. Mais dans la mesure où ce que vous appelez « blasphémer » ne constitue pas une invitation à la haine et à la violence, dans la mesure où la caricature vise à faire rire ou à choquer et non à pousser les gens à s'emparer d'un fusil, je crains que ces plaintes restent lettres mortes, et c'est bien ainsi.
Pas de sanction judiciaire en effet pour le blasphème, car le blasphème (Grâces en soient rendues à Dieu qui peut-être n'existe pas) n'est pas un délit au sens juridique du terme. Quoi de plus logique, puisque la croyance et l'appartenance à une religion sont du domaine privé ? Si chacun est parfaitement libre d'adhérer à la religion de son choix et de la pratiquer comme il l'entend, il n'en reste pas moins que son voisin de palier, son camarade de classe, son charcutier ou son médecin adhèrent peut-être, pour ce qui les concerne, à une autre religion, ou bien se rangent parmi les athées ou les agnostiques. Comment un chrétien pourrait-il se rendre coupable de blasphème contre l'Islam, puisque telle n'est pas sa religion ? Comment un athée pourrait-il blasphémer le Christ, puisqu'il n'est pas chrétien ? Si je m'en réfère au Grand Robert de la langue française en 9 volumes, je découvre en effet que le blasphème est une « parole qui outrage la Divinité, la religion, le sacré ». Littré et le dictionnaire de l'Académie française vont dans le même sens. Il découle de cette définition que nul ne peut outrager une Divinité qui pour lui n'existe pas, une religion à laquelle il ne croit pas ; ce qui revient à dire qu'un incroyant, par définition et par essence, ne peut se rendre coupable de blasphème. Tuer le prétendu blasphémateur revient tout simplement à tuer celui qui ne pense pas comme moi, celui qui ne croit pas ce que je crois. La voilà, la barbarie. Si Sartre vivait aujourd'hui, lui qui considérait toute forme de religion comme une manifestation de mauvaise foi (propos blasphématoire s'il en est), peut-être aurait-il été tué, lui aussi…
Quant à la notion de sacré, elle est plus floue encore. Pour un athée, il n'est rien de sacré dans la religion, que d'ailleurs il perçoit peut-être comme une absurdité ; pour un agnostique, rien non plus de sacré dans l'éventualité de l'existence d'un Dieu sur lequel il s'interroge. Pour ceux-là, cependant, seront peut-être sacrés leur patrie, leur famille, l'enfant à naître, leur mère, la vie elle-même, que sais-je encore ? Autant d'objets potentiels de blasphème.
Et quand bien même le blasphème existerait et correspondait à quelque chose de réel, de définissable, d'explicable, quand bien même serions-nous tous croyants et pratiquants de la même religion (horrible perspective, en vérité !), ce prétendu délit mériterait-il la mort ? Dieu, s'il existe, n'est-il donc pas capable de se défendre tout seul, de châtier lui-même ceux qu'il voudrait punir ? Qu'est-ce que donc que cette croyance fanatique qui ose prendre sa place, celle de Dieu, qui ose juger en son nom, massacrer des gens dont la seule faute est de penser « mal » ? C'est à vous dégoûter de toute forme de religion ! Et je ne cite que pour mémoire l'humour et l'ironie involontaires qu'il y a dans le fait de sans cesse associer le nom du prophète de l'Islam à l'expression « le très miséricordieux », alors même que l'on tue, que l'on massacre, que l'on invite à la haine en son nom. Et je ne me limite pas ici aux 12 morts de Charlie Hebdo ; je pense aussi aux milliers de victimes de l'État Islamique en Syrie et ailleurs, à celles de Boko Haram au Nigéria… Belle miséricorde, en vérité ! Ils n'ont pas tort, les survivants, de l'avoir représenté en larmes avec à la bouche les mots d'un pardon bien nécessaire. Car il a de quoi pleurer, certes, le Prophète, et depuis longtemps. Tout comme le Christ a trop souvent eu de quoi pleurer lui aussi devant les croisades, les bûchers de l'Inquisition, les guerres de religion, la Saint-Barthélémy… Reste à espérer que, prophète ou messie, ils pourront pardonner tout cela à ces fous furieux fanatiques qui se réclament d'eux, à ces « fous qui n'ont ni couleur ni religion » comme l'a proclamé devant les caméras le frère d'Ahmed Merabed. Car le vrai blasphème, le seul sans doute, c'est là qu'il se situe : dans le meurtre commis au nom de Dieu, quelle que soit la manière dont on l'appelle ou la langue dans laquelle on l'invoque.
En ce qui me concerne, je ne suis ni prophétesse ni sainte et, je le reconnais, je conçois mal la possibilité d'un pardon face aux flots de sang qui depuis toujours noient la terre au nom de Dieu.
Mais je m'égare. Revenons à Charlie Hebdo que je n'aime pas plus aujourd'hui qu'hier. Ce qui ne m'empêche pas de proclamer, moi aussi, que « je suis Charlie ». Car je suis un être humain doué de raison, je suis une citoyenne libre de penser et de s'exprimer, même si ma façon de penser et de m'exprimer peut en choquer certains.
Je veux pouvoir continuer de vivre dans un pays et une civilisation où ces droits existent. Je veux rester libre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, « je suis Charlie ». Parce que je suis ce qui refuse toute entrave à sa liberté et à son intégrité. Je suis ce qui persiste à respecter l'autre, l'étranger, celui qui ne pense pas comme moi, celui qui ne prie pas comme moi, celui qui ne s'habille pas comme moi, ne parle pas la même langue que moi, ne partage pas mes coutumes. Je suis ce qui se relève quand on l'a jeté à terre, je suis la voix qui s'élève après avoir été muselée. Je suis ce qui survit et se révolte. Je suis tout cela, que l'on a voulu tuer le 7 janvier 2015, en plus d'avoir exécuté sauvagement des êtres de chair et de sang qui jamais n'avaient porté les armes, ni incité quiconque à partir en guerre.
Dénigrer l'écrivain
- Par Liliane Schraûwen
- Le 13/12/2014
- Commentaires (0)
- Dans Colère
Lu sur Internet, sous la plume d'un ami (bien réel et non virtuel) : « Je rêve d'ouvrir un jour un livre et d'y lire à la première ligne de la première page ceci : Cher lecteur, vous avez fait un mauvais choix en achetant ce livre, ne vous fatiguez pas en essayant de l'apprécier, il ne vaut rien. D'ailleurs je me demande comment mon éditeur a pu s'intéresser à mon manuscrit, il devait être passablement éméché. Surtout n'en faites pas la publicité et ne croyez pas quiconque aurait la désobligeance de le recommander sur un réseau dit social. Voilà ce qui aiguiserait justement mon envie de le lire ! »
Je dois avouer que mon sang n'a fait qu'un tour, et que j'ai aussitôt adressé à l'auteur de ces lignes une réponse que je vous fais partager ici en la développant. Car m'enfin, selon l'expression du merveilleux Gaston… Trop is te veel comme on dit chez nous. Il y a des limites, quand même, à ce qu'un écrivain peut supporter sans sourciller. Voici donc ma réaction à l'étrange propos de mon non moins étrange ami.
Pourquoi diable voulez-vous que les malheureux auteurs déjà trop souvent ignorés par la critique, obligés pour survivre de trouver des sources de revenus bien éloignées de la littérature, se sabordent de la sorte ? À moins d'être déjà célèbres, évidemment, et d'accéder par-là à une nouvelle forme de publicité. Car à part Amélie Nothomb, personne ne pourrait insérer ces lignes en première page d'un livre, pour la simple raison que l'éditeur (qui n'est ni fou ni suicidaire) les refuserait. Ou, plus vraisemblablement ne publierait pas, ledit manuscrit.
Écrire, composer de la musique, peindre, que sais-je, c'est toujours dans l'optique de communiquer, c'est-à-dire d'être lu, écouté, regardé. Sans quoi on laisse dormir ses textes dans un tiroir sans jamais les proposer à l'édition. L'artiste qui présente ses œuvres au public doit être le premier à croire en leur valeur et leurs qualités… sinon le seul. Et si je veux être lue (et donc, accessoirement, achetée), il faut que mes textes aient un minimum de notoriété. Par conséquent, voici au contraire ce que j'insèrerais volontiers, quant à moi, en première page de mes livres, paraphrasant ainsi l'ami cité plus haut : « Cher lecteur, achetez mon dernier livre, achetez mes autres œuvres, lisez-les, et jugez-les en connaissance de cause. Si vous les aimez, faites les connaître autour de vous ». À ce propos, je profite de l'occasion pour vous renvoyer à mes dernières publications ainsi qu'à la prochaine (en février 2015 : « Ailleurs » chez MEO éditions).
Avez-vous la plus petite idée du temps, du travail, de l'énergie, de la passion, de la somme de difficultés (je n'ose pas écrire « de souffrances ») qu'il a fallu pour donner naissance à un livre ou à toute autre forme de production artistique ? Et vous voudriez que le pauvre type qui a ainsi sué sang et eau pendant des mois ou des années se dénigre ensuite lui-même ? Oui, je sais, les artistes sont souvent un peu fous quand ils ne sont pas tout simplement « maudits », mais quand même… pas à ce point ! Si vous n'aimez pas lire, n'achetez pas de livres (sauf sans doute celui de Valérie Machin) ; si vous n'aimez pas la musique, n'en écoutez pas. Tant pis pour vous, car vous demeurerez seul au cœur d'un univers égocentré, stérile et prodigieusement limité. C'est votre droit, bien sûr, mais cessez de railler, d'éreinter, de mépriser, d'assassiner les malheureux auteurs. Ce n'est pas parce que vous-mêmes êtes dénués de la moindre créativité ou de la plus infime originalité, ce n'est pas parce que vous manquez cruellement d'imagination ou parce que vous êtes incapable de fournir l'effort nécessaire à produire ne serait-ce que l'ébauche d'un projet vaguement artistique, que vous devez vous consoler dans le mépris de ceux qui, au contraire, ne peuvent vivre qu'en créant « même peu même mal » comme le chantait Brel. L'artiste, même s'il ne s'agit que d'un tout petit artiste, que d'un modeste artisan (et c'est déjà beaucoup), voire d'un mauvais artiste (encore faudrait-il définir le mot « artiste » et l'expression « mauvais artiste ») s'adresse au public. Or, qui dit public dit publicité, celle-ci consistant précisément à rendre public ne qui ne l'est pas (ou pas encore). Et la publicité, aujourd'hui, passe par les réseaux sociaux. Est-ce un bien, est-ce un mal ? C'est ainsi, voilà tout. Et dites-moi, est-il plus honorable pour un écrivain d'aller parader sur les plateaux des talk-shows (en français dans le texte), d'accepter que son éditeur dépense des fortunes en placards publicitaires insérés dans journaux et magazines, de s'inventer pour les médias une vie rêvée qui n'a rien à voir avec la réalité ? Il me semble, quant à moi, que les réseaux sociaux et les blogs ont du moins cet avantage de donner la parole aux « vraies gens », à ceux qui ont aimé ou détesté telle ou telle œuvre, et qui partagent leurs coups de cœur ou leurs dégoûts avec la masse de leurs virtuels « amis », sincèrement, maladroitement peut-être, et l'on peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils écrivent ou avec leur manière de l'écrire. Mais ce qu'ils expriment, ce n'est pas une admiration feinte et rémunérée ni un mépris mercenaire. Ils n'appartiennent pas au sérail, ils ne sont pas payés pour briller aux dépens de l'auteur qu'ils encenseront ou incendieront dans les pages littéraires de journaux qui, le plus souvent, ne font que se plagier mutuellement, affichant les mêmes enthousiasmes et les mêmes aversions pour les mêmes bouquins « qu'il faut avoir lus ». Ils ont découvert une œuvre, et ils ont envie de faire connaître leur point de vue sur cette œuvre, de le partager avec un maximum de gens. S'ils ont détesté le livre ou le film concernés, ils le diront, et ceux qui les liront, sans doute, renonceront à juger eux-mêmes ce livre ou ce film. Mais s'ils les ont aimés au contraire, leurs « amis » de face book et d'ailleurs le sauront aussi et, peut-être, feront circuler l'information. Dans les deux cas, un créateur se sera fait connaître, en bien ou en mal, sans le truchement du système ni des décideurs et prescripteurs institutionnels. Ces gens-là, ils sont le public, le vrai public. Et ça, c'est plutôt bien.
Je me réjouis, quant à moi, de ne pas être obligée d'aller manger des fruits pourris sur un plateau de télévision, de ne pas devoir fondre en larmes devant un quelconque Ardisson, de ne pas être contrainte à faire le clown, tout cela pour que les titres de mes livres aient une petite chance d'être connus d'éventuels lecteurs. Je me réjouis de pouvoir moi-même, sans intermédiaire, faire savoir que j'existe, que j'écris, que tel de mes manuscrits vient d'être édité, que je serai en signature à tel endroit… Parfois d'ailleurs, la boucle est bouclée, et les médias traditionnels qui s'informent, eux aussi, sur les réseaux sociaux, réagissent à leur tour… Ainsi s'élargit le public, ce qui revient à dire que je puis toucher plus de personnes. Ma solitude se défait doucement…
Je vous le dis, à vous qui aimez la littérature comme à tous les médiocres qui jugent de bon ton de la critiquer : cessez de croire qu'il suffit de s'attaquer à un artiste pour acquérir un peu de pouvoir. Car ces créateurs que vous aimez tant mépriser, ce sont vos rêves qu'ils expriment, vos joies, vos tourments, donnant du sens à vos errances. Quand vous les attaquez, c'est à vous-mêmes que vous vous en prenez. Quand vous les blessez, c'est votre propre sang que vous faites couler et vos propres larmes Et ne l'oubliez pas : un monde sans livres et sans lecteurs, c'est le retour à la barbarie. Ce n'est pas un hasard si tyrans et ayatollahs, inquisiteurs et dictateurs de toute espèce, de Hitler à Ceausescu en passant par bien d'autres, ont toujours commencé par interdire et brûler les « mauvais » livres et même, quelquefois, leurs auteurs.
Lettre ouverte à Monsieur l'Officier du Ministère public de Lille
- Par Liliane Schraûwen
- Le 18/12/2012
- Commentaires (0)
- Dans Colère
 Écrivain, j’ai été invitée à Lille samedi dernier, le 15 décembre, à l’occasion des Escales Hivernales et littéraires.
Écrivain, j’ai été invitée à Lille samedi dernier, le 15 décembre, à l’occasion des Escales Hivernales et littéraires.
J’ai, semble-t-il, mal garé mon véhicule en une ville séduisante, brillamment illuminée par les soins du génial (et belge) François Schuiten, et peuplée ce jour-là de toutes sortes de promeneurs, de touristes et de manifestants appartenant à la race des « flamands (ou flamants) roses » si je m’en réfère aux calicots qu’ils brandissaient. Oui, jolie cité que Lille, mais tristement dénuée de toute possibilité de parking, en tout cas pour un visiteur étranger.
J’ai donc trouvé sur mon pare-brise, au moment de reprendre la route, un sympathique billet doux m’invitant à m’acquitter du modeste montant de 35 euros, correspondant à ce qui est défini comme « l’amende forfaitaire » pour « interdit matérialisé ». J’avoue que, même si je suis une professionnelle de l’écriture, il m’a fallu quelque temps pour traduire ce message dans un dialecte accessible au commun des mortels. Ainsi ai-je découvert que les 35 euros réclamés se transformeraient en 75 euros en cas de non-paiement dans les 45 jours. Bigre ! ai-je pensé, ils n’y vont pas de main morte, nos sympathiques voisins.
Je suis arrivée, finalement, à comprendre l’essentiel du sibyllin message, car il ne faut jamais désespérer de l’intelligence humaine ni de l’intuition d’un artiste, fussent-ils belges. Quoi qu’il en soit, au vu du montant des amendes hexagonales, je comprends mieux l’exil du grand (et gros) Gégé et sa fuite vers nos cieux belges et accueillants.
Mais foin de ces considérations économique-artistico-philosophiques. Pour rester pragmatique, je vous dirai que, malgré mon mécontentement, je suis toute disposée à payer. Car on peut aimer l’art et n’avoir aucune tendance à l’anarchie, et tous les écrivains ne sont pas maudits. J’ai donc retourné dans tous les sens la « carte de paiement » délicatement coincée sous mes essuie-glaces, cherchant – en vain – un quelconque numéro de compte sur lequel effectuer le versement réclamé. Rien. Tout au plus ai-je pu lire qu’il me faut « payer pa r chèque ou coller à cet emplacement la partie à envoyer du timbre-amende ».
r chèque ou coller à cet emplacement la partie à envoyer du timbre-amende ».
Ainsi donc, ai-je songé, les Français en sont toujours à l’ère du chèque, disparu depuis quelque vingt ans des usages de notre petit Royaume. Quant à « la partie à envoyer du timbre-amende », comment diable une voyageuse non hexagonale pourrait-elle l’avoir en sa possession ?
Heureusement pour moi et pour les caisses de l’État français qui ont bien besoin de mes 35 euros d’écrivain sous-alimenté et sous-payé, certains de mes proches vivent en France (les malheureux !). Me voici donc contrainte de leur envoyer par courrier postal la fameuse « carte de paiement » accompagnée de 35 euros en jolis billets tout neufs, à charge pour eux d’utiliser le chèque ou le timbre ou le je-ne-sais-quoi qui ont cours dans cet étrange pays.
Tout cela cependant a suscité chez moi quelques intéressantes réflexions sur l’accueil fait aux étrangers en terre de France. J’ai aussi compris que, si Obélix est en passe de devenir belge, il y a longtemps, selon toute apparence, que Kafka est français.
Frédéric Deborsu et Jean-Yves Hayez
- Par Liliane Schraûwen
- Le 13/12/2012
- Commentaires (0)
- Dans Colère
 J’ai reçu, comme beaucoup d’autres, la « lettre ouverte » de Jean-Yves Hayez, lettre dont Le Soir s’est également fait l’écho, et que l’on peut trouver aussi sur plusieurs sites Internet.
J’ai reçu, comme beaucoup d’autres, la « lettre ouverte » de Jean-Yves Hayez, lettre dont Le Soir s’est également fait l’écho, et que l’on peut trouver aussi sur plusieurs sites Internet.
Au premier abord, j’ai décidé de ne pas la lire, n’ayant guère de temps à perdre en réactions au livre concerné. Les médias, d’ailleurs, nous ont largement documentés sur le contenu de cet ouvrage et sur les réactions qu’il suscitait, à croire que rien de plus important de par le monde ne vaut qu’on s’y intéresse. Il me semble pourtant que le Kivu, que la Syrie, que l’Egypte, que la Corée, que la crise économique, que le chômage, que …
Mais ne nous attardons pas sur l’échelle des valeurs qui préside aux choix de nos journaleux et de leur public. Rien de nouveau sous le soleil. Au Vème siècle avant Jésus-Christ, déjà, Athènes n’attachait-elle pas autant d’importance à la queue du chien d’Alcibiade qu’à la guerre qui ravageait le Péloponnèse ?
Par curiosité sans doute, par amitié aussi pour la personne qui me l’a envoyé, j’ai cependant fini par ouvrir et lire ce texte, et cela même si j’avoue que les heurs et malheurs de notre famille royale, que les frasques sentimentales ou sexuelles de ses représentants présents et passés, que les amours ou désamours qui président à leurs unions ne me passionnent guère. Pas plus d’ailleurs que la bigamie de feu le président Mitterrand, que le goût de Bill Clinton pour quelque jolie stagiaire ou que l’orientation sexuelle des grands de ce monde et autres « people ». Quant aux enfants de notre Flupke national, je ne me fais pas trop de soucis pour eux, leurs parents ayant largement, pour les aider à dépasser leurs éventuels traumatismes, de quoi payer les plus grands thérapeutes (et je ne leur recommanderais pas pour cela certain professeur bavard et prolixe). Ce qui n’est pas le cas pour tous les mioches victimes de présumés « experts » dont l’incompétence quelquefois a détruit la vie. Le souci exprimé par Jean-Yves Hayez et la cosignataire de sa lettre de « respecter mieux, encore et encore, tous les enfants de notre communauté, par exemple en faisant attention de (sic) ne pas blesser inutilement leurs sentiments profonds », pour noble et généreux qu’il soit, a en effet de quoi faire rire – ou pleurer… Croyez-moi, je sais de quoi je parle.
 Quant aux traumatismes princiers tels que décrits par monsieur Hayez, je n’y crois guère. Car enfin, si un enfant vit chaque jour l’amour de ses parents et peut le sentir, le voir, l’éprouver, il me semble qu’on peut sans trop de risque lui raconter n’importe quoi sur la façon dont il a été conçu. J’ajoute, pour faire bonne mesure, que des milliers de petits Belges et des millions sinon des milliards d’autres enfants ont à souffrir de traumatismes bien plus graves que ceux auxquels s’intéresse l’inénarrable Jean-Yves Hayez en une langue et avec une orthographe et une syntaxe qui, en outre, me paraissent aussi approximatives que problématiques. Pour la sécurité de ses patients, on peut donc espérer (sans trop d’illusions) que l’enseignement qu’il a reçu à Louvain a laissé dans sa mémoire plus de traces en ce qui concerne les matières scientifiques qu’en ce qui touche à celles ayant un rapport avec la langue française.
Quant aux traumatismes princiers tels que décrits par monsieur Hayez, je n’y crois guère. Car enfin, si un enfant vit chaque jour l’amour de ses parents et peut le sentir, le voir, l’éprouver, il me semble qu’on peut sans trop de risque lui raconter n’importe quoi sur la façon dont il a été conçu. J’ajoute, pour faire bonne mesure, que des milliers de petits Belges et des millions sinon des milliards d’autres enfants ont à souffrir de traumatismes bien plus graves que ceux auxquels s’intéresse l’inénarrable Jean-Yves Hayez en une langue et avec une orthographe et une syntaxe qui, en outre, me paraissent aussi approximatives que problématiques. Pour la sécurité de ses patients, on peut donc espérer (sans trop d’illusions) que l’enseignement qu’il a reçu à Louvain a laissé dans sa mémoire plus de traces en ce qui concerne les matières scientifiques qu’en ce qui touche à celles ayant un rapport avec la langue française.
Mais, bien sûr, il est parfaitement inutile, médiatiquement parlant, de s’intéresser au sort de mômes dont les parents ne sont « que » des immigrés clandestins, des quart-mondistes, des hommes violents ou des femmes violentées…, pas plus qu’aux enfants abusés, maltraités, abandonnés, kidnappés, harcelés… Leurs traumatismes, pourtant, me semblent plus terrifiants que ceux de nos blonds petits princes.
J’ajoute enfin que ce monsieur qui, comme trop souvent, s’intéresse à ce qui ne le concerne en rien, me paraît relativement mal placé pour donner des leçons de morale à qui que ce soit. Son souci des enfants, fussent-ils royaux, lui a souvent assuré une présence récurrente sur les plateaux de télévision. Tant mieux pour lui. Quant au bien-être psychologique et à la protection des enfants en question, ceux-là mêmes dont il s’autoproclame le défenseur, c’est peut-être une autre histoire.
Je précise, pour en terminer, que tout ceci ne signifie aucunement que j’adhère à la démarche de Frédéric de Borsu. Je ne lirai pas son livre, qui ne m’intéresse pas. Remuer la boue, réelle ou imaginaire, me paraît être une démarche tout à fait répugnante, nous en sommes bien d’accord.
Mais il me semble que les signataires de cette lettre ouverte, ainsi que ceux qui la diffusent, pourraient trouver sans difficulté à utiliser plus utilement leur temps et leur énergie. D’autant que je ne me leurre pas davantage sur les motivations de Jean-Yves Hayez que sur celles de Frédéric de Borsu, tant il est vrai que la notoriété pour l’un et l’argent pour l’autre sont peut-être la clef de leurs actions respectives.
À tous les deux, d’ailleurs, j’ai surtout envie de répondre ceci : « Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde, messieurs, et commencez par balayer devant votre propre (si j’ose dire) porte. Et cessez de nous importuner ».
Cherchez l'erreur
- Par Liliane Schraûwen
- Le 05/07/2012
- Commentaires (0)
- Dans Colère
Laurent Fabius a le même âge que moi. En réalité, il est mon aîné de trois mois ; cela ne l’empêche pas de se trouver désigné comme ministre des Affaires étrangères du tout nouveau gouvernement Hollande.
J’ai le même âge que Laurent Fabius. En réalité, je suis sa cadette de trois mois. Cela ne m’a pas empêchée de me trouver mise au rebut à la date de mon fatidique 65ème anniversaire. Plus bonne à rien, pas même à signer le moindre procès-verbal d’examen oral.
Cherchez l’erreur.
La Bruyère pas mort
- Par Liliane Schraûwen
- Le 12/02/2012
- Commentaires (1)
- Dans Colère

Mes "anciens" tout neufs – mes derniers "anciens" – ont organisé aujourd'hui un repas chez l'une d'entre eux, auquel ils m'ont invitée. La plupart étaient là. WT bien sûr, puisque cela se passait chez elle. JL, DV, FC, AW, BV, SAINT, LC, MM, QK, YM, NJ, ND. Certains n'avaient pas été conviés (!!!), d'autres n'avaient pas pu venir.
J'ai été heureuse et émue de les retrouver. Mon Dieu, que ce métier me manque! Le nevermore de Baudelaire, quelle horreur et quelle tristesse. J'ai tellement aimé le contact avec ce genre d'étudiants, et j'ai eu tant de plaisir à leur faire découvrir et partager la littérature, la philo… Personne, je pense, ne peut imaginer le déchirement que cela représente que de devoir arrêter, brutalement, pour cause de date de péremption. On vous jette comme on jette un pot de yoghourt moisi, un bout de fromage ranci. Il y a là une violente cruauté. Et ce n'est pas l'indifférence et la muflerie de certains collègues ou de l'un ou l'autre petit tyran bouffi de suffisance et drapé dans la pseudodignité de sa fonction qui adoucissent le départ. Le croiriez-vous? Pas un au revoir, pas même la traditionnelle carte signée par une communauté scolaire qui s'en fiche mais qui du moins ferait semblant, par souci des convenances sinon par générosité. Pas la plus petite trace de compassion ou d'humanité chez ces gens qui depuis, à ce qu'on me dit, se réjouissent ouvertement de ma définitive absence. Forcément: Plus personne pour leur tenir tête, ce doit être reposant. Plus personne pour se soucier réellement des étudiants, de leurs vrais problèmes, de leur vie en somme. Et vas-y que je pontifie et fulmine, et que j'impose mes vues (si courtes faut-il le préciser) sans concertation et sans la moindre empathie : le voile islamique, dorénavant, sera interdit. Na! C'est moi le Chef, j'ai parlé. Un peu stalinien, le grand sachem, comme toujours.
Il y a de nombreuses années, la directrice de l'époque, madame D, avait voulu, déjà, prendre la même décision. Je l'avais menacée de démissionner, et les choses n'ont pas été plus loin. Non pas que je sois favorable à ce que les femmes cachent leur chevelure, bien sûr. Pour dire le vrai, je trouve cette pratique choquante. Mais je suis favorable, par contre, à la liberté, et notamment à la liberté de se vêtir comme on en a envie. Si "l'enseignement de promotion sociale" n'admet plus ces jeunes filles ou ces femmes, que fait-il d'autre que leur refuser l'accès à l'un des seuls lieux de réflexion et d'émancipation qui leur sont ouverts? Sous prétexte d'un prétendu féminisme professé – bien sûr – par le prototype même du mâle dominant, on les rejette dans l'exclusion. Restez donc chez vous, mesdames. Nous qui plaçons au-dessus de tout – en paroles du moins – votre liberté et votre dignité, nous qui prétendons que votre voile vous est imposé dans tous les cas par l'obscurantisme et la brutalité d'un père ou d'un mari, eh bien, nous vous renvoyons chez ce père ou ce mari, entre les quatre murs de la maison où nous nous plaisons à vous imaginer cloîtrées, enfermées, asservies. "Nous sommes dans une école gérée par les Femmes Prévoyantes socialistes" s'exclame le gros poussah, "nous sommes donc essentiellement féministes". Ce serait rigolo si ce n'était si triste. Car bien sûr, le féminisme masculin (bel oxymore, n'est-ce-pas?) consiste d'abord et avant tout à empêcher les femmes de juger par elles-mêmes, de décider par elles-mêmes, de choisir par elles-mêmes costume et coutumes, toutes religions ou mécréances confondues.
Garçons ou filles peuvent bien se déguiser en rappeurs ou skateurs, se présenter à l'école en short ou le nombril à l'air, arborer piercings étranges et tatouages bizarres, oublier de se laver (j'en ai connu), fumer des joints gros comme des maisons sur l'escalier, devant l'école, qu'importe? Que les filles montrent leurs cuisses et leurs seins, mon Dieu, pourquoi pas? Il se trouve certainement l'un ou l'autre collègue plus ou moins pervers pour trouver cela tout à fait plaisant. Mais qu'elles portent le voile, alors là, non! Trop, c'est trop, pas vrai? Te veel is te veel comme on dit chez nous.
Tout ce que mes anciens me racontent n'arrange guère mon humeur, faut-il le dire, et n'adoucit pas la tristesse de mon départ. Et je n'ose imaginer les séances de TFE en juin et en septembre, les "moi qui sais tout, je vais vous expliquer…", les "je vais tenir le crachoir afin d'éblouir les foules, et tant pis pour le temps de parole du malheureux récipiendaire"…
Connaissez-vous le fameux Giton de La Bruyère? Il n'est pas mort, je puis vous l'assurer pour l'avoir longtemps fréquenté et pour entendre encore parler de lui, hélas. Laissez-moi vous le présenter, certains vont le reconnaître.
Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l'œil fixe et assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance; il fait répéter celui qui l'entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit (…). Il occupe à table et à la promenade plus de place qu'un autre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux; il s'arrête, et l'on s'arrête; il continue de marcher, et l'on marche; tous se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole: on ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler; on est de son avis, on croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans le fauteuil, croiser les jambes l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser le chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du temps, il se croit des talents et de l'esprit.".
Pauvres "petits lapins" livrés à tant de fatuité… Je me sens remplie d'un mélange de tristesse et de colère quand j'entends ce qu'on me raconte. Difficile, de se sentir impuissante, plus difficile encore d'accepter de "décrocher", de se dire qu'on n'est plus concernée, qu'on n'a plus rien à voir avec tout cela, et que de toute façon ma "dernière classe" pour parodier Daudet sera en effet la dernière dont j'aurai à connaître, même de loin, les aventures et mésaventures. D'autres groupes suivront, aussi longtemps du moins que se maintiendra l'école, qui traverseront les mêmes difficultés, seront confrontés aux mêmes crises d'autorité, devront se soumettre à de nouvelles règles aussi abusives que dénuées de sens, et je ne le saurai pas. Out, ma bonne dame. "L'Orage est passé" comme le proclame ce cher Giton. L'Orage, c'est moi.
Quoi qu'il en soit, j'ai eu de la chance de terminer ma carrière avec ce groupe-ci. J’ai tissé avec bien des classes qui les ont précédés des rapports d'affection, de sympathie, de respect réciproque (mais pas avec toutes, je dois l'avouer). Mais ceux-ci, c'est particulier. Peut-être parce que je savais qu'ils seraient les derniers. Mais même sans cela, c'est une H2 particulièrement sympathique et attachante… dans l'ensemble et à quelques exceptions près, mais il existe toujours et partout l'un ou l'autre mouton noir, hélas. Je riais avec eux, tout à l'heure, je les retrouvais dans un autre contexte, mais tellement pareils à eux-mêmes, à peine un peu plus libres dans leur manière de se comporter, et je me disais que je les aimais, vraiment. J'ai aimé beaucoup de mes étudiants, tout au long de ces années, et ceux-ci sont les derniers. Sont-ils plus attachants, plus sympathiques que tous ceux qui les ont précédés? C'est en tout cas d'eux que je me souviendrai tant qu'Alzheimer me laissera quelques neurones en état de fonctionnement.