De la littérature
Adieu à "La librairie francophone"
- Par Liliane Schraûwen
- Le 14/05/2024
- Commentaires (133)
- Dans Ecrire
Je fais partie des quelque 560 auteurs et autres « membres de la chaîne du livre » signataires de la pétition adressée à France Inter pour protester contre la suppression de l’émission « La librairie francophone ». Comme sans doute les 559 autres signataires, j’ai donc reçu un aimable mail émanant de « mediatrice@radiofrance.com » dont voici le contenu :
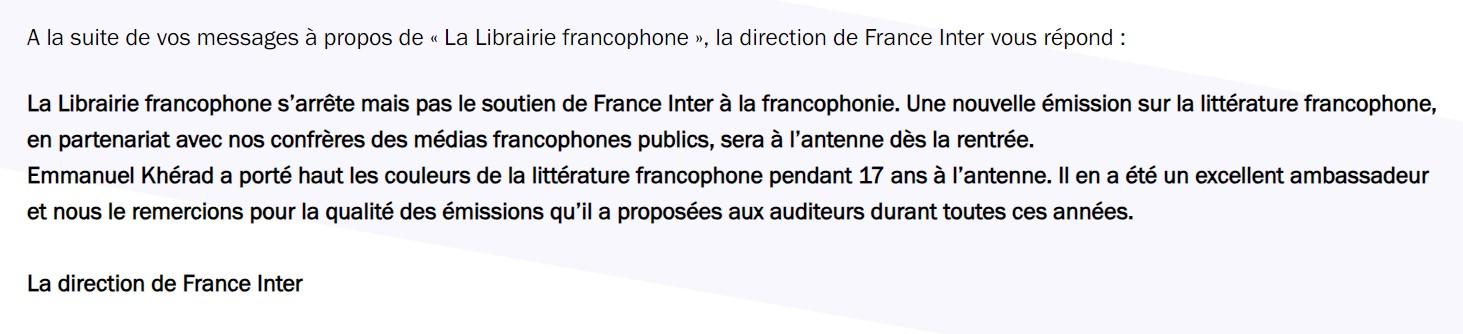
Une manière élégante de nous dire… que nous n’avons rien à dire, que c’est comme ça, voilà tout, que la décision de supprimer La librairie francophone est irréversible et qu’Emmanuel Khérad a été (mais n’est plus) « un excellent ambassadeur » qu’il convient de remercier, dans tous les sens du mot.
Aucune explication, bien entendu, aucune justification. Aucune réponse anticipée à la question que, forcément, l’on se pose : si, comme l’écrit madame médiatrice sans doute inspirée par monsieur Chat GPT, « une nouvelle émission sur la littérature francophone sera à l’antenne dès la rentrée », alors même que celle que l’on enterre aujourd’hui était « de qualité »… comme toutes celles qu’Emmanuel Khérad « a proposées aux éditeurs durant toutes ces années », pourquoi donc la supprimer ?
Voulez-vous que je vous dise ? Ceci démontre que France Inter et, dans la foulée, que toutes les instances auprès desquelles on pétitionne à tour de bras, n’en ont rien à cirer, rien à foutre, rien à br***. À l’ère des réseaux prétendument sociaux sur lesquels chacun peut dire et écrire n’importe quoi, vitupérer sur tout et sur rien, répandre menaces, fake news et propagande en tout genre, à l’ère où X, Instagram, Tik Tok et le vétuste Facebook des vieux internautes ont remplacé livres et journaux, en ces temps où CULTURE ne rime plus avec écriture ou littérature mais plutôt avec déconfiture, enflure, caricature ou injure quand ce n’est pas avec CENSURE ou DICTATURE, à l’heure des émeutes ici ou là, des occupations d’universités, des manifestations pour toutes sortes de causes parfois discutables…, en ces temps où influenceurs et influenceuses dirigent les goûts et les passions de nos ados…, qui s’intéresserait, je vous le demande, aux « pétitions » de plumitifs tout juste bons à produire des livres que personne ne lit ?
Et, globalement, en quoi une pétition qui ne serait ni accompagnée de jets de pierres ou de cocktails molotov, ni soutenues par des troupeaux d’émeutiers en colère, aurait-elle la moindre chance d’être entendue ?
« Sic tansit gloria muni », ou à tout le moins : « sic transit gloria francophoniae librariae »…
Au revoir monsieur Kherad. Ce fut un plaisir de vous entendre, un plaisir riche de souvenirs, et ce fut un honneur de vous rencontrer et d’échanger quelques mots avec vous à la récente foire du livre de Bruxelles.
Les surprises de la Foire du Livre
- Par Liliane Schraûwen
- Le 19/04/2024
- Commentaires (223)
- Dans De la littérature
(Texte publié dans les « nouvelles du jour » de la revue Marginales en collaboration avec Le Soir)
En notre joli et tout petit royaume vit un écrivain de sexe féminin — c'est-à-dire une écrivaine, si l’on accepte de se fondre dans l’air du temps, de se couler dans le wokisme, le féminisme exacerbé et le prétendu « éveil » contemporains. Elle ne se nomme pas Amélie mais Hélène, Hélène Untel pour être précis, et sa notoriété est restreinte. Elle a pourtant publié une vingtaine d'œuvres, tous genres confondus. Pour un éditeur français, elle avait également accouché d’un gros ouvrage de commande consacré aux affaires criminelles qui, depuis le moyen-âge, ont dans nos provinces défrayé la chronique.
Du coup, comme on dit aujourd’hui, la directrice de collection d’une maison d’édition belge l’a un jour contactée.
Hélène connaissait cet éditeur, relativement récent et spécialisé dans les livres « grand public » : mémoires de ministres, de présentateurs de journaux télévisés et autres personnalités médiatiques, histoires de flics ou de légistes, enquêtes, souvenirs de coureurs cyclistes, portraits de couples royaux, biographies de stars du foot…
— J’ai une proposition à te faire, lui dit l’éditrice. Tu connais sans doute « L’Instant T », l’émission quotidienne qui passe sur les antennes de notre radio nationale ?
— En effet. Il m’arrive de l’entendre lorsque je suis au volant.
— Tu sais donc que c’est le fameux Ludovicus-Johannes Lebuisson qui en fait la notoriété.
— Bien sûr, répondit Hélène. Difficile de ne pas le connaître ! Cela fait plus de vingt ans qu’on ne peut guère échapper à son visage, à sa voix et à son phrasé grandiloquent.
L’autre lui expliqua que la prod (entendez : la société de production responsable de la diffusion des innombrables « Instants T » et de tout ce qui les accompagne) envisageait une série de ces Instants centrée sur les meurtres et autres abominations spécifiques à notre sympathique pays.
— Il nous en faudrait une dizaine, qui donneraient lieu à un livre dont monsieur Lebuisson assurera la promotion avant de lire les textes sur antenne. Pourrais-tu être « la plume » de ce projet ? Nous savons que tes « Grandes affaires criminelles de Belgique » publiées naguère en France ont bien marché…
— Je vais y réfléchir…
— Bien sûr, tu auras un contrat en bonne et due forme, tu percevras des droits d’auteur. Et dans la mesure où il s’agit d’une commande, tu toucheras une avance importante à la remise du manuscrit.
— Je te donnerai ma réponse d’ici quelques jours.
Pour la forme, Hélène fit mine d’hésiter. Mais elle savait déjà qu’elle accepterait la proposition, pour bien des raisons, la première étant qu’un joli chèque serait le bienvenu. « Pour une fois que la littérature nourrit son homme — ou sa femme ! » se dit-elle. Et puis, elle éprouvait un certain plaisir à effectuer des recherches dans les bibliothèques, à consulter de vieilles archives, à dépouiller la presse du temps jadis. Nostalgie sans doute de ses années universitaires… En outre, plusieurs sujets qu’elle avait envisagé de traiter dans ses fameuses « Grandes affaires criminelles de Belgique » dormaient dans le ventre de son ordinateur, certains à l’état d’ébauche, d’autres à demi rédigés.
Elle se mit donc au travail. Un travail qui, cela n’étonnera personne, fut long, exigeant, parfois ardu. Enfin, le livre fut édité sous une couverture tape-à-l’œil comme il sied à ce genre de publication. Le titre jaune vif occupait le tiers de l’espace, surmontant l’image d’un poignard sanglant. Sur le troisième tiers, on pouvait admirer une photo de l’illustre Ludovicus-Johannes Lebuisson, accompagnée d’une épaisse accroche jaune flashy : « Histoires vraies racontées par LUDOVICUS-JOHANNES LEBUISSON ». Le nom d’Hélène était mentionné, lui aussi, en caractères beaucoup plus discrets : « Textes de Hélène Untel ».
Il y eut des articles dans la presse, des interviews du « conteur qui captive tous les après-midis les auditeurs de l’émission L’Instant T… », sans que le nom de l’auteur des textes fût cité. Hélène râla un peu, mais elle se dit que bon, c’est ainsi que cela se passe, et de toute façon, si cet ouvrage alimentaire était bien ficelé et assez réussi, ce n’était cependant pas « de la grande littérature »…
Quelque temps plus tard, elle apprit incidemment que « la prod » avait décidé de ne pas diffuser ses créations sur antenne. Sans doute son style n’était-il pas assez oratoire, à moins qu’il fût trop littéraire. Tant pis pour le faux comte russe qui avait trucidé une antiquaire, tant pis pour « le beau Gustave », pour l’affaire Caumartin-Sirey et pour quelques autres. Tout cela n’était pas très grave.
— L’incident est clos, se dit-elle. J’ai fait le job, le livre existe, je percevrai les droits annoncés. C’est très bien ainsi.
Quelques mois passèrent, jusqu’à ce jeudi 4 avril 2024, date d’ouverture de la Foire du Livre de Bruxelles. Hélène était attendue chez deux de ses autres éditeurs, où elle devait signer romans et nouvelles. Les amateurs le savent : cette « plus grande librairie du pays » se tient sur le site de Tour et Taxis. Les stands MEO et Quadrature se trouvaient tous les deux dans le hall numéro 2 ; or, avant d’atteindre le 2, il faut très logiquement passer par le 1. L’auteur-point-médian-rice, ainsi que l’indiquait son badge, laissa à sa droite le Salon des Auteurs de la SCAM (sans féminin ni point médian cette fois), et parcourut d’un pas pressé les espaces Actes Sud, l’École des Loisirs, Québec éditions, Racine et quelques autres. À sa gauche, en face du podium de la RTBF et juste avant l’entrée du « shed 2 » (en français dans le texte), il y avait le très vaste emplacement 139-140 qui regroupait plusieurs éditeurs. Derrière une rangée de tables couvertes de piles de bouquins, des chaises attendaient les auteurs de premier rang qui viendraient dédicacer leurs œuvres, et des affichettes annonçaient leur nom et l’heure du rendez-vous.
Hélène s’arrêta net. Sur l’une des tables, c’étaient une centaine d’exemplaires de son sanglant ouvrage de commande qui s’empilaient.
Interloquée, car on ne lui avait pas annoncé cette séance de signature, mais flattée quand même, elle s’approcha… et découvrit le texte de l’affichette de présentation : LUDOVICUS-JOHANNES LEBUISSON dédicacera son livre à 17 h.
La surprise passée, Hélène sentit monter la colère. Non mais… Depuis quand invite-t-on un quidam, même s’il est (relativement) célèbre, à dédicacer un volume dont il n’a pas écrit une ligne et que, à en juger par certains de ses propos en interview, il n’a sans doute pas lu ? Bien sûr, ce sont son nom, son visage et surtout la référence à l’Instant T qui attireront les amateurs… Mais la moindre des choses n’aurait-elle pas été de convier l’auteur, le vrai, à s’asseoir à ses côtés et à co-signer « son livre » ?
Elle était attendue chez MEO à midi. Accueil sympa, comme toujours, retrouvailles et rencontres d’autres auteurs (authentiques, ceux-là), discussions, échanges, découvertes… Elle raconta l’anecdote lebuissonesque à qui voulait l’entendre, et fut à la fois rassurée et réconfortée par les réactions indignées ou incrédules de ses confrères.
— Tu devrais aller lui parler, lui suggéra un ami, lui dire ce que tu penses de tout cela.
— Je t’accompagnerai, lui dit un autre.
— Moi, je filmerai la rencontre, ajouta l’assistante de monsieur MEO.
Hélène Untel se rendit donc, à 17 h précises, à proximité de la table sur laquelle trônaient ses crimes. Pas de Ludovicus-Johannes Lebuisson à l’horizon car, comme chacun sait, le propre des stars est de se faire désirer. Un chaland, planté devant la chaise vide du médiatique monsieur Instant T, patientait.
Hélène s’approcha.
— Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander ce que vous attendez ?
L’homme la regarda en lui montrant le livre qu’il serrait sur son cœur.
— J’attends Ludovicus Lebuisson, bien sûr. Je suis un fan, j’ai acheté son livre, et je vais le prier de me le dédicacer.
— Je comprends, fit Hélène. Cet ouvrage, vous savez qui l’a écrit ?
— Évidemment, c’est indiqué sur la couverture : c’est Ludovicus-Johannes Lebuisson.
— Ah bon ? Vous êtes sûr ? rétorqua Hélène en lui montrant sur ladite couverture la très discrète mention de son nom : « Textes de Hélène Untel », avant de lui mettre sous le nez le badge « auteur·rice » accroché à son écharpe, sur lequel figurait – forcément – le même nom.
L’homme la regarda, incrédule.
— C’est vous qui l’avez écrit ?
— Mais oui, vous le voyez bien.
Il réfléchit un instant, hésita, puis :
— Dans ce cas, vous voulez bien me le dédicacer ?
— Avec plaisir, répondit-elle en retenant le rire qu’elle sentait monter.
À Didier, avec l’amitié du véritable auteur de ce livre, inscrivit-elle, cependant que Ludovicus-Johannes Lebuisson arrivait enfin, lançant un regard courroucé à l’inconnue qui se permettait de gribouiller dans SON livre. Le fan s’avança, lui présenta l’ouvrage ouvert à la page déjà annotée par « le véritable auteur » qui s’était éloigné de quelques pas.
Hélène attendit que l’illustre personnage en eût terminé avec les quelques amateurs de dédicaces qui lui tendaient leurs livres. Puis elle passa derrière lui, lui frappa sur l’épaule. Il se retourna, lut son nom sur le badge épinglé à son revers.
— Ah, c’est vous ! dit-il avec son grand sourire télévisuel.
— Oui, c’est moi qui ai écrit ce livre…
Il y eut un moment de silence, puis elle enchaîna, avec toute la politesse et tout le calme dont elle était capable.
— À ce propos, je voudrais vous poser une question. Comment se fait-il que je n’aie pas été invitée à vous tenir compagnie derrière cette table, et à dédicacer avec vous cet ouvrage dont, somme toute, je suis l’auteur ? Ou au moins avertie, tout simplement ?
Il hésita un instant.
— Ce n’est pas moi qui décide. C’est l’éditeur qui a tout organisé, je n’y suis pour rien…
— Je comprends. Mais si j’avais été à votre place, j’aurais quand même suggéré à cet éditeur d’inviter l’auteur à co-signer avec moi… L’avez-vous fait ?
La star s’énerva.
— Mais je vous le répète : je n’y suis pour rien. Moi, je me contente de rendre service à l’éditeur. Je ne toucherai pas un centime pour cela, ni sur les ventes. Vos textes ne seront même pas diffusés sur antenne.
Hélène avala sa salive. Le « même pas » était de trop…
— Écoutez, monsieur Lebuisson, que cet ouvrage soit bon ou mauvais, là n’est pas l’affaire. C’est moi qui l’ai écrit, voilà tout. L’auteur, c’est moi, Hélène Untel. N'avoir pas pris la peine de m'aviser de cette séance de dédicace de MON livre par quelqu'un qui n’en a pas écrit une ligne, c’est un manque de respect, de politesse, de civilité, de…
Un petit attroupement s’était formé. L’illustre Dubuisson éleva la voix.
— Asseyez-vous donc, et signez avec moi, puisque vous y tenez ! Et je vous le répète : c’est à l’éditeur que vous devez vous en prendre, pas à moi.
Hélène haussa le ton, elle aussi.
— Vous n’avez rien compris, monsieur. Je me fiche bien de signer à vos côtés, je ne cherche pas ici une vaine gloriole. Je suis d’ailleurs censée dédicacer ailleurs mon dernier roman et quelques-uns de ceux qui l’ont précédé, en ce moment. Simplement, je suis choquée du surprenant manque de considération dont fait preuve ici l’éditeur… tout comme ceux qui, de toute évidence, n’ont pas pensé à lui rappeler que cette œuvre est le fruit du travail d’un écrivain véritable, d’un auteur qui y a consacré du temps et de l’énergie.
Elle ne put aller plus loin, interpellée – pour ne pas dire agressée – par une dame tirée à quatre épingles à l’allure imposante et au maquillage… très apparent. Son badge indiquait son nom et la fonction : attachée de presse.
— Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ?
Hélène respira un grand coup pour se calmer, puis expliqua.
— Je suis venue aujourd’hui pour signer certaines de mes œuvres sur les stands MEO et Quadrature, et j’ai découvert, en passant devant l’espace 139-140, que monsieur Lebuisson allait dédicacer à 17 h cet ouvrage, dont JE suis l’auteur. Je m’étonne donc que…
— Ce n’est pas vrai, rétorqua le désagréable personnage.
— Comment cela, ce n’est pas vrai ?
— Vous n’avez rien découvert. Vous le saviez très bien. D’ailleurs, vous vous êtes déjà plainte.
— Mais… mais… Je n’étais au courant de rien, je ne suis pas venue à la soirée d’inauguration, je suis arrivée tout à l’heure, vers midi, je suis passée devant les tables, j’ai vu mes livres et l’affichette, je…
— De toute façon, c’est ainsi, voilà tout. Et si vous voulez discuter avec un quelconque membre de l’équipe éditoriale, sachez qu’il n’y aura personne, ni aujourd’hui, ni demain… D'ailleurs, c’est monsieur Lebuisson qui assure le succès de ce livre.
Hélène se fâcha pour de bon.
— Je vais vous répéter ce que j’ai dit déjà à votre monsieur Lebuisson. Quel que soit le personnage responsable de ce prétendu « oubli », c’est un manque de la plus élémentaire considération envers le travail et la personne de l’écrivain. J’ai peine à concevoir une telle absence d’éducation, de civilité, de correction, de…
— Eh bien, fit la mégère, installez-vous et dédicacez, puisque c’est cela que vous voulez !!!
Hélène renonça à lui redire ce qu’elle avait déjà tenté d’expliquer à l’illustre Ludovicus-Johannes. Madame l’attachée de presse, d’ailleurs, avait tourné les talons sans plus attendre, avec la grossièreté qui semblait lui être coutumière, et s’en était allée vers d’autres horizons.
Hélène s’éloigna, elle aussi, en se disant que cette histoire aurait du moins l’avantage de lui donner matière à une nouvelle. Le proverbe a raison, songea-t-elle, qui affirme qu’à quelque chose malheur est bon.
Tout n’était donc pas perdu.
Adieu à "La librairie francophone"
- Par Liliane Schraûwen
- Le 14/05/2024
- Commentaires (137)
- Dans De la littérature
Je fais partie quelque 560 auteurs et autres « membres de la chaîne du livre » signataires de la pétition adressée à France Inter pour protester contre la suppression de l’émission « La librairie francophone ». Comme sans doute les 559 autres signataires, j’ai donc reçu un aimable mail émanant de « mediatrice@radiofrance.com » dont voici le contenu :
Une manière élégante de nous dire… que nous n’avons rien à dire, que c’est comme ça, voilà tout, que la décision de supprimer La librairie francophone est irréversible et qu’Emmanuel Khérad a été (mais n’est plus) « un excellent ambassadeur » qu’il convient de remercier, dans tous les sens du mot.
Aucune explication, bien entendu, aucune justification. Aucune réponse anticipée à la question que, forcément, l’on se pose : si, comme l’écrit madame médiatrice sans doute inspirée par monsieur Chat GPT, « une nouvelle émission sur la littérature francophone sera à l’antenne dès la rentrée », alors même que celle que l’on enterre aujourd’hui était « de qualité »… comme toutes celles qu’Emmanuel Khérad « a proposées aux éditeurs durant toutes ces années », pourquoi donc la supprimer ?
Voulez-vous que je vous dise ? Ceci démontre que France Inter et, dans la foulée, que toutes les instances auprès desquelles on pétitionne à tour de bras, n’en ont rien à cirer, rien à foutre, rien à br***. À l’ère des réseaux prétendument sociaux sur lesquels chacun peut dire et écrire n’importe quoi, vitupérer sur tout et sur rien, répandre menaces, fake news et propagande en tout genre, à l’ère où X, Instagram, Tik Tok et le vétuste Facebook des vieux internautes ont remplacé livres et journaux, en ces temps où CULTURE ne rime plus avec écriture ou littérature mais plutôt avec déconfiture, enflure, caricature ou injure quand ce n’est pas avec CENSURE ou DICTATURE, à l’heure des émeutes ici ou là, des occupations d’universités, des manifestations pour toutes sortes de causes parfois discutables…, en ces temps où influenceurs et influenceuses dirigent les goûts et les passions de nos ados…, qui s’intéresserait, je vous le demande, aux « pétitions » de plumitifs tout juste bons à produire des livres que personne ne lit ?
Et, globalement, en quoi une pétition qui ne serait ni accompagnée de jets de pierres ou de cocktails molotov, ni soutenues par des troupeaux d’émeutiers en colère, aurait-elle la moindre chance d’être entendue ?
« Sic tansit gloria muni », ou à tout le moins : « sic transit gloria francophoniae librariae »…
Au revoir monsieur Kherad. Ce fut un plaisir de vous entendre, un plaisir riche de souvenirs, et ce fut un honneur de vous rencontrer et d’échanger quelques mots avec vous à la récente foire du livre de Bruxelles.
AUTEURE, AUTRICE OU AUTEURICE ?
- Par Liliane Schraûwen
- Le 11/12/2022
- Commentaires (3215)
- Dans Société
J’ai découvert, au hasard d’une émission littéraire, l’existence d’une maison d’édition que je ne connaissais pas. J’ai eu la curiosité de me renseigner, et j’ai donc consulté le site de ladite maison.

Cela m’a permis de visionner la liste-trombinoscope des AUTEURICES (sic) qu’elle publie. Si si, je vous assure, vous avez bien lu. Ce qui ne l’empêche pas de se présenter, sur le même site, comme une maison « qui publie chaque année des romans, novellas et recueils de nouvelles D’AUTEURS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS ». Cherchez l’erreur…
Même dans le monde de la science-fiction, qui constitue le genre-phare de cette maison, ce mot est un non-sens (et une monstruosité). J’ai souvent rencontré des AUTEURES et des AUTRICES (deux catégories auxquelles je me refuse d’appartenir, bien décidée à demeurer à jamais UN AUTEUR, même si en l’occurrence cet auteur est sans conteste une femme, de même que je suis un PROFESSEUR et même un ÉCRIVAIN, tous de sexe féminin, et — tant qu’à faire — UN être humain.

Mais du moins les néologismes d’AUTEURE et d’AUTRICE s’inscrivent-ils dans une certaine logique linguistique, tout comme les mots INSPECTRICE, ACTRICE, CONDUCTRICE, MINEURE, PRIEURE ou SUPÉRIEURE, depuis longtemps entrés dans l’usage et les dictionnaires.
Car, rappelons-le, c’est l’usage qui fait évoluer une langue (et ce n’est pas le bon monsieur Grevisse qui m’aurait contredite), et non les ukases à connotation “politiquement correcte” ou “dans l’air du temps” de démagogues de tout poil ou de militantes féministes. Bien sûr, si ces féminisations et autres inclusivités avaient le moindre impact sur le nombre de “violences faites aux femmes”, sur le mépris dont trop souvent elles restent l’objet, si ces fadaises linguistiques permettaient de diminuer le nombre de meurtres, de viols, de mutilations, d’agressions, de “coups et blessures” dont elles sont victimes, eh bien, mon Dieu, peut-être me convertirais-je à cette religion nouvelle et j’inclusiverais à tout va, moi aussi. Mais de toute évidence, il n’existe aucun rapport entre ces tristes réalités et la prétendue bonne conscience syntaxique qui se répand aujourd’hui. Au contraire, suis-je tentée de dire.
Quoi qu’il en soit, constater qu’un éditeur, un vrai, qui ne semble pas pratiquer le compte d’auteur revendiqué ou déguisé, utilise ce néologisme aussi ridicule que barbare, cela a de quoi faire frémir…
Quant à moi, je ne risque pas, en tout cas, de lui proposer l’un ou l’autre manuscrit. Et je reviens à mon mantra préféré : “la connerie humaine est sans limites”…
ET TANT QU’À FAIRE... VICTOR HUGO EN INCLUSIF, C’EST INTÉRESSANT (LES CHÂTIMENTS)
Celles et ceux qui vivent, ce sont celles et ceux qui luttent ; ce sont
Celles et ceux dont un dessein ferme emplit l’âme et le front,
Celles et ceux qui d’un haut destin gravissent l’âpre cime,
Celles et ceux qui marchent pensif.ve.s, épris.e.e d’un but sublime,
(...) C’est le-la prophète.sse saint.e prosterné.e devant l’arche,
C’est le-la travailleur.euse, pâtre.sse, ouvrier.ère, patriarche ;
(...) Inutiles, épars.e.s, iels traînent ici-bas
(...) Iels sont les passant.e.s froid.e.s, sans but, sans nœud, sans âge ;
(...) Oh non, je ne suis point de celles et ceux-là ! grand.e.s, prospères,
Fier.ère.s, puissant.e.s, ou caché.e.s dans d’immondes repaires,
ET SI ON RÉÉCRIVAIT LES PENSÉES DE PASCAL ?
« L’homme-la femme n’est qu’un.e roseau.elle, le.la plus faible de la nature; mais c’est un.e roseau.elle pensant.e. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le.la tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme-la femme serait encore plus noble que ce qui le.la tue, parce qu’iel sait qu’iel meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui.elle, l’univers n’en sait rien. »
...ET DE LETTRES VOUS N'AVEZ QUE LES TROIS QUI FORMENT LE MOT "SOT"
- Par Liliane Schraûwen
- Le 27/11/2022
- Commentaires (160)
- Dans De la littérature

Un facebookien amateur de (belles) lettres publia récemment dans ses « impressions de lectures » quelques lignes relativement sympathiques sur mon dernier recueil de poèmes, ce dont je le remercie (« Traces perdues », éd. Bleu d’encre).
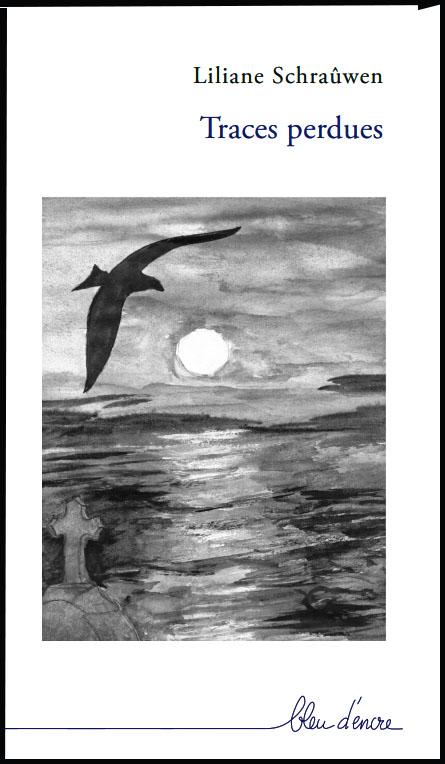
Un cuistre distingué, aussitôt, répondit à sa chronique par quelques lignes venimeuses dont je vous livre ici le contenu.
« On attend d'un poème qu'il fasse preuve de nouveauté, d'images jamais lues, de thèmes riches et féconds, d'émotion. (…)
Quelle déception quand, au fil des pages, se lèvent tant de clichés, de banalités, de stéréotypes, de poncifs, comme si l'auteur, reliant des thèmes intéressants (l'enfance, le temps qui ronge, les voyages), les banalisait, les reniait à force d'images convenues, mille fois lues. (…) Dommage. L'auteur eût pu resserrer son propos (146 pages) et condenser son écriture. Dommage pour l'excellent éditeur. Signé : Ph. Lx »
Lorsqu’on sait que le pseudonommé (si je puis me permettre ce néologisme) Ph. Lx est lui-même poète, auteur d’un nombre étonnant de textes édités (114 si j’en crois Wikipédia, excusez du peu), et est en outre l’un des administrateurs de l’AEB (Association des écrivains belges de langue française) dont est membre la pauvre petite plumitive que je suis, la chose ne manque pas de sel.
Je lui ai donc adressé une réponse quelque peu ironique, mais moins insultante (ou méprisante, c’est selon) que l’était son texte :
« Réponse au commentaire féroce de Philippe Leuckx à la critique que Denis Billamboz a publiée de mon dernier recueil de poésie, « traces perdues » (éd. bleu d’encre)
Chacun, monsieur le censeur, est évidemment libre d’apprécier ou non, d’admirer ou de détester toute forme de création artistique (littéraire, picturale, musicale ou autre).
Il me semble néanmoins que descendre en flèche un ouvrage (je n’ose pas écrire : « l'œuvre d’un autre poète ») ainsi que vous le faites ici, cela relève à la fois de la méchanceté gratuite, d’une certaine outrecuidance, d’une supposée supériorité et de prétendues compétences qui restent très discutables. Quant à moi, plus modeste sans doute que vous, ou moins perfide et teigneuse, lorsque je n’aime pas tel ou tel ouvrage, je le confie — peut-être — verbalement à certains de mes proches, je m’exprime dans un cercle restreint. Je ne déverse pas mon fiel sur FB, je n'émets pas de jugements à l’emporte-pièce, je ne m’attache pas à nuire urbi et orbi sur les réseaux sociaux (ou en cette occurrence asociaux), à tel ou tel de mes confrères que j’estimerais — à tort ou à raison — moins digne que moi de porter le nom de « poète »…
Il est vrai que sans doute je n’aurais aucun droit à agir de la sorte, moi qui n’ai pas comme vous à mon actif plusieurs centaines (!!!) de textes, courts ou moins courts, poétiques ou critiques. Bref, je ne suis pas quant à moi « un Grrrrand Poète » autoproclamé, je ne suis pas non plus administratrice de l’AEB ni d’aucune autre association culturelle. Et je me permettrai d’ajouter que je ne suis pas, comme certains, en quête permanente d’honneurs ou de reconnaissance (surtout s’il s’agit de la reconnaissance de cuistres malfaisants), quitte, pour cela, à pontifier gravement sur les « clichés, banalités, stéréotypes et autres poncifs » d’une autre plumitive, sans même parler de votre sympathique appréciation « d'images convenues, mille fois lues ». Venant de vous, la charge est étonnante autant que fielleuse.
Non seulement votre propos dégoulinant de venin risque d’ôter à tout lecteur potentiel le désir de découvrir mon recueil, mais il va jusqu’à se permettre de porter un jugement sur l’éditeur qui, en cette occurrence, a eu le grand tort de me publier (alors que peut-être il aurait refusé l’un ou l’autre de vos chefs-d’œuvre ???). Un tel commentaire, lui, risquerait de me nuire non pas auprès d’éventuels et rares amateurs de poésie, mais auprès de cet éditeur ou de ses confrères. Bleu d’encre, grâce au ciel, est dirigé de main de maître par un autre « professeur » et écrivain qui se fie à son propre jugement, et non aux ukases venimeux de certain gendelettre prolifique autant que désobligeant ou agressif.
Par ailleurs et même si cela n’a pas vraiment de lien avec le sujet qui m’occupe ici, je vais me permettre, cher collègue, de vous révéler que je suis tout comme vous, si je m’en réfère à votre page Wikipédia, « professeur de français, d’histoire de l’art, de philosophie » et de quelques autres disciplines, comme le latin et l’histoire. Mais tout ceci ne constitue évidemment ni un titre de gloire, ni une preuve de talent : j’en suis d’accord, monsieur le censeur-professeur-critique et surtout monsieur-le-poète rempli d’autant de vanité que de maîtrise revendiquée, voire de génie supposé…
Je conclurai cette réaction en ajoutant que je ne puis m’empêcher de songer que, peut-être, votre hargne et votre mépris à l’égard de mon recueil ont d’autres sources que ma prétendue et triste incompétence littéraire (surtout lorsqu’on la compare à l’incommensurable génie du prolifique et autoproclamé maître en la matière, l’inénarrable Philippe Leuckx). Je me souviens en effet de l’incident qui, in illo tempore, m’avait amenée à quitter l’AEB, et des textes (déjà) aussi féroces que violents et remplis de mépris que ce sympathique censeur avait diffusé tous azimuts en cette occasion. Auriez-vous donc la rancune tenace, en plus de prendre plaisir à humilier vos confrères ? “
J’ai su, par ailleurs, que des « amis » connus et inconnus avaient réagi à son post assassin avec moins de nuances que je l’avais fait moi-même (ce qui m’a réconfortée, je le confesse). Courageusement, ce noble et prolifique scribouillard a aussitôt supprimé son message et, dans la foulée, toutes les réactions qu’il avait suscitées, parmi lesquelles mon propre texte. Pour plus de sécurité, il semble bien m’avoir « bloquée » et donc empêchée de savourer les jérémiades fielleuses et narcissiques qu’il dispense généreusement sur sa page FB.
Malheureusement pour lui, les réseaux prétendus sociaux ont ceci de positif qu’ils permettent de « partager » tous azimuts textes et images, ce dont je ne me suis pas privée…
Et, malgré mes incommensurables faiblesses en matière de poésie, du moins si j’en crois l’illustre Ph. Lx, je me suis amusée à relater cette ridicule affaire en quelques alexandrins pastichant l’illustre Edmond Rostand, vers de mirliton peut-être, et riches sans doute de « clichés » et autres « images convenues », mais qui m’ont divertie, et divertiront de même, je l’espère, mes (rares) lecteurs.
Quand un cuistre pédant se prend pour un expert © Liliane Schraûwen 2022
Il y a par chez nous en terre de Belgique
Comme partout ailleurs des crétins maléfiques 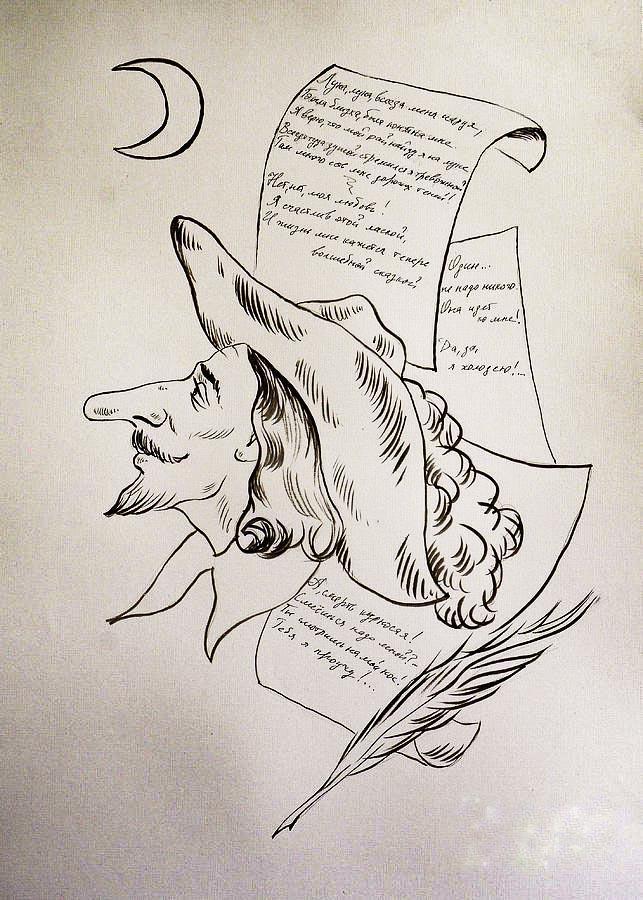
Tristes ayatollahs proférant des sentences
Décidant à tout va ce qu’il faut que l’on pense
Ce qu’il faut qu’on écrive et comment on le dise
Justifiant leurs propos par leur grande maîtrise
Sachant mieux que personne à quoi la poésie
Se doit de ressembler afin de faire envie
Il en est un certain qui meilleur que ses pairs
Vous regarde de haut en prenant de grands airs
Il éructe sans honte et juge vos « poncifs »
En des mots méprisants tristement corrosifs
Avec autant d’aplomb que de forfanterie
S’appuyant pour cela sur son propre génie
Attesté par le nombre de ses publications
Qui dépassent de loin d’Amélie Nothomb
La somme impressionnante des titres produits
En trente ans d’écriture de moult manuscrits
Il vous juge en expert mentionne vos « clichés »
Évoquant ce qu’il nomme vos « banalités »
Car « quelle déception » pour ce triste pédant
Pour ce cuistre sinistre et toujours malveillant
De lire « au fil des pages » les « stéréotypes »
D’une pauvre consœur qu’il aurait prise en grippe
Et qui, la malheureuse, ne peut que « renier »
Ce qui fait semble-t-il du grand art la beauté
« Images convenues »
Et « mille fois relues »
Autant de compliments venant d’un connaisseur
Vaniteux suffisant qui se croit supérieur
Et pour qui je voudrais parodier Cyrano :
« Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres,
Vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres
Vous n'avez que les trois qui forment le mot : sot ! »
(Edmond ROSTAND, Cyrano de Bergerac, acte 1, scène 4)
LA RAISON DU PLUS FORT ou LA FONTAINE EN UKRAINE
- Par Liliane Schraûwen
- Le 08/11/2022
- Commentaires (132)
- Dans Actualité
 Quand l’agneau des plaines ukrainiennes se trouve confronté au féroce loup des steppes de Sibérie
Quand l’agneau des plaines ukrainiennes se trouve confronté au féroce loup des steppes de Sibérie
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Chacun sait cela depuis… depuis… depuis… Depuis longtemps. Depuis toujours.
Ce n’est pas le loup du bon monsieur de La Fontaine qui me démentira, et moins encore l’agneau qui fit les frais de sa démonstration. Ce ne seront pas non plus monsieur Poutine aujourd’hui, pas plus que le sympathique et dodu dirigeant de Corée du Nord, ni aucun des tyrans, dictateurs, despotes et autres autocrates passés, présents ou à venir qui contrediront cette évidence.
Cela a toujours été ainsi. Les gros poissons mangent les petits, les lions dévorent les gazelles, les aigles font un sort aux renards qui mangent les écureuils amateurs de glands et de châtaignes… Et tout au bout de ce qu’on nomme la chaîne alimentaire, les hommes omnivores se nourrissent de tout le reste.
Quoi de plus normal ? C’est ce que l’on appelle la loi de la nature. Dieu lui-même l’a voulu ainsi, à ce qu’il paraît. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre » dit-il (Genèse 1, 2
6). Après quoi « il créa l’homme et la femme et leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.… ».
L’on connaît par ailleurs la fameuse théorie du « mâle alpha » née de l’analyse du comportement des loups. Chez ces animaux comme chez bien d’autres, la meute, ou le groupe, sont dirigés par un individu plus puissant que ses congénères, qui a démontré sa supériorité au terme d’un long processus de compétition. C’est lui qui choisit les lieux de chasse, qui s’accouple avec les femelles élues, qui impose à tous sa loi. C’est aussi lui qui protège les plus faibles, femelles gravides, jeunes fragiles ou blessés. C’est lui, enfin, qui a droit de vie et de mort sur ses compagnons, avant qu’un autre plus jeune, plus fort, plus vigoureux ou plus beau arrive à prendre sa place pour devenir vizir à la place du vizir.
Et c’est ainsi que Cro-Magnon remplaça Néanderthal, qu’Attila le Hun domina les Ostrogoths et quelques autres pour régner sur un empire devenu légendaire, qu’Alexandre devint Grand, que Gengis Khan, que Tamerlan…
|
La raison du plus fort est toujours la meilleure pensa Vladimir en son cœur, tandis que Zelensky rêvait d’une société future sans agression ni invasion ni forfaiture. Mais un voisin en ces lieux arrivait, séduit par la beauté de ce ciel sans nuages et la fraîcheur de ses herbages. Tu seras châtié de ta témérité, cria Volodymir le courageux fieffé devant les peuples en colère. Il faudrait que tu considères que je vais convoquer l’OTAN toujours présent lorsque ses vieux amis l’appellent et que par conséquent, en aucune façon, tu ne peux mener ton action. Je le ferai, reprit cette bête cruelle, et je vaincrai les Ukrainiens ces enragés sans me soucier du droit ni de la liberté. Alors partout se répandit la guerre le sang et la haine entre frères. Mais Chez Poutine s’agitèrent les chiens qui ne voulaient plus la guerre dont ils espéraient la fin. Il est temps qu’à ce jour enfin les choses changent disaient certains en grand secret afin que de lui l’on se venge sans autre forme de procès… (versification et rimes d’origine) |
CRITIQUE OU RECENSEUR ?
- Par Liliane Schraûwen
- Le 14/05/2022
- Commentaires (3413)
- Dans Ecrire

Je l'avoue sans honte, j'ai été étonnée (et un peu attristée, sinon déçue) que mon dernier opus, L'ALPHABET DU DESTIN (éditions Quadrature, décembre 2021) ait été LE PREMIER (et donc le seul à ce jour) des quelque 21 ouvrages de mon cru à n'avoir fait l'objet d'aucun commentaire dans l'un de nos journaux nationaux, fût-ce d'une seule ligne annonçant sa sortie. D'autant que, j'ose le rappeler sans modestie, il m'est naguère arrivé maintes fois d'avoir droit à une pleine page (dans La Dernière Heure), à une double page (dans Paris-Match, mais il est vrai que c'était pour un roman publié à Paris…), à un article de plusieurs colonnes (La Libre). Notamment… Celui-ci pourtant n'est pas plus mauvais (ou moins bon) que les deux dizaines qui l'ont précédé. Il n'a pas été publié à compte d'auteur ni via l'un de ces sites qui, d'un simple clic…, mais chez un véritable éditeur, et non des moindres. Bizarre, pas vrai ?
J'ai donc pris le risque d'interroger par message interposé l'un de nos critiques attitrés. Avait-il bien reçu l'ouvrage ? Si tel n'était pas le cas, je pouvais le lui faire envoyer illico. Le souhaitait-il ? J'ai joint à cette proposition un texte de quelques lignes présentant ledit recueil de nouvelles, histoire de l'allécher… peut-être.
Fallacieuse illusion. Fiasco complet. Gifle virtuelle qui est bien le reflet du mépris dans lequel on tient, dans notre beau pays (et ailleurs, sans doute) les tristes plumitifs qui passent des mois, des années parfois, à peaufiner un roman ou un recueil, et cela même s'ils ont été déjà encensés par la critique, primés par le Parlement de la Communauté française et même finalistes au Prix Rossel.
Réponse — qui bien sûr m'a atterrée — et que je ne résiste pas au plaisir de vous citer ici : « C'est malheureusement trop ancien pour se glisser encore dans une actualité qui déborde de partout », réponse précédée d'une sibylline et incompréhensible explication selon laquelle « les recensions, qu'elles soient de moi ou d'autres, s'attachent rarement à une œuvre complète, au fur et à mesure des parutions. » Sans doute suis-je stupide ou frappée d'Alzheimer, mais je dois reconnaître que je n'ai pas bien saisi le sens de ce propos. Signifie-t-il que les critiques ne « recensent » que des ébauches, des extraits, des synopsis peut-être ? Qu'une œuvre complète n'a aucune chance de se voir « recensée » ? Que le mot « critique » a changé de sens pour prendre celui de « recenseur » ?
Oui, je sais, je ne m'appelle ni Amélie, ni Guillaume (Musso), ni Marc (Lévy), et moins encore Jean Teulé (ouf, ça c'est plutôt une bonne nouvelle). Je ne suis pas non plus « un espoir de la littérature », vu mon âge apparemment trop canonique pour intéresser les « recenseurs » qui oublient d'être des critiques, et vu aussi le nombre d'ouvrages portant déjà ma signature. Quelques-uns de mes éditeurs « historiques », des Éperonniers à Luce Wilquin en passant par Régine Deforges, ont fermé boutique et mis la clef sous le paillasson, et les survivants sans doute n'ont pas la notoriété ou l'aura nécessaires pour mériter la moindre « recension » d'un opus paru au mauvais moment, ou dans un contexte difficile, ou dont le titre n'est pas suffisamment accrocheur, ou…
Ou bien ce silence est dû au fait que, je le sais pour l'avoir entendu de mes (très) propres oreilles de la bouche d'un autre « éminent » recenseur, nos pages culturelles belges se doivent de parler d'abord et surtout de ce qui se publie ailleurs. En France pour commencer, tant il est vrai qu'il « n'est bon bec que de Paris » comme l'écrivait déjà Villon avant de se faire assassiner par Jean Teulé, puis aux States, au Japon, en Grande-Bretagne… Bref, n'importe où sauf chez nous. Le même grand manitou de pages prétendument culturelles ajoutait sans vergogne que, d'ailleurs, il fallait impérativement que nos critiques commentent prioritairement les œuvres déjà évoquées en France.
Pour le cas où vous n'auriez pas tout compris, je résume. Pour être critique (pardon « recenseur ») dans un journal belge, il n'est pas utile d'ouvrir les ouvrages  à évaluer ou citer. Vous pouvez les revendre au Pêle-mêle ou chez Évasions, ce qui permettra à l'auteur de les y retrouver, agrémentés de la dédicace personnalisée, le lendemain de l'envoi. Je sais de quoi je parle, croyez-moi, pour l'avoir vécu.
à évaluer ou citer. Vous pouvez les revendre au Pêle-mêle ou chez Évasions, ce qui permettra à l'auteur de les y retrouver, agrémentés de la dédicace personnalisée, le lendemain de l'envoi. Je sais de quoi je parle, croyez-moi, pour l'avoir vécu.
Contentez-vous de vous abonner au Figaro (littéraire) au Monde (des livres), à Lire et à quelques autres quotidiens ou hebdomadaires culturels bien français, parcourez leurs colonnes, calculez le nombre global de lignes consacrées à tel ou tel roman, essai, recueil, et lancez-vous à l'assaut du livre le mieux pourvu, de préférence en répétant sous une nouvelle forme les propos de vos confères hexagonaux.
Ainsi les locomotives prétendument littéraires continueront-elles de foncer à travers plaines et vallons de notre plat pays sans jamais rencontrer aucun obstacle ni aucune concurrence, y répandant leur fumée souvent nauséabonde, avec de longs sifflements trouant la nuit paisible des cités endormies, cependant que les bons et moins bons auteurs de chez nous, les grands et les tout petits, les vieux croutons et les débutants, les invisibles, les tâcherons, les naïfs, les rêveurs, les découragés, continueront de se noyer dans l'anonymat sans que personne, jamais, ne songe à les lire et moins encore à acheter leurs œuvres. Car comment et pourquoi, je vous le demande, l'amateur de livres ouvrirait-il un roman dont personne n'a parlé, publié par un auteur qui ne passe ni chez Ruquier ni chez Anouna, qui n'a même pas (surtout pas) été « recensé » par nos journaux nationaux et, par conséquent, que personne ne connaît… Tant il est vrai que c'est en s'appuyant sur la critique que le lecteur potentiel se forge une première opinion, qu'il ressent — ou non — l'envie de découvrir le livre, le film, le spectacle dont il a appris l'existence et peut-être l'intérêt dans les pages de son journal favori.
Vous voulez être lus, amis écrivains (et je ne parle pas ici de votre éventuel talent) ? La recette est simple : faites en sorte que NOS critiques-recenseurs et aussi, et surtout, ceux de Paris, parlent de vous. Comment ? En tentant de vous faire éditer, justement, à Paris, ce à quoi vous arriverez sans doute si vous évoquez dans votre œuvre les violences que vous avez subies de la part de Johny Depp, de votre grand-père ou de votre curé, ou si vous étalez vos expériences et vos goûts sexuels hors normes, ou encore si vous avez connu personnellement quelque tueur en série monstrueux, quelque vedette déchue et de préférence morte et enterrée et donc incapable de rectifier vos élucubrations, quelque politicien plus ou moins illustre, quelque people faisant régulièrement la une de Voici. Vous pouvez aussi fréquenter de très près PPDA, Dominique Strauss Kahn ou ceux qui aujourd'hui les ont remplacés sur les marches glissantes et souvent nauséabondes des escaliers tortueux qui mènent au pouvoir médiatique. Il vous est loisible également de relater en détail vos traumatismes, surtout s'ils sont liés à l'un ou l'autre attentat barbare, aux violences conjugales ou aux viols que vous avez subis, voire aux meurtres que vous-même avez commis.
Il est possible aussi, bien sûr, que vous comptiez sur votre seul talent pour séduire Gallimard ou Grasset, mais je ne vous le cache pas : ce sera plus difficile. Pour rappel, comme le savent mes anciens étudiants en sociologie de la littérature, sur 6.000 à 7.000 textes reçus annuellement, Gallimard en publie 6 ou 7, ce qui représente un pourcentage de un pour mille. Cela laisse peu de chances au petit auteur belge qui n'entre dans aucune des catégories évoqu ées plus haut.
ées plus haut.
Bref, débrouillez-vous pour être publié dans l'Hexagone (ou au Japon, aux States, en Papouasie, sur la planète Mars, mais surtout pas en Belgique), puis faites la cour aux animateurs de télé, aux rédac-chefs des quotidiens, aux grands noms de la critique (toujours hexagonale). Graissez quelques pattes si nécessaire, faites jouer vos relations, brûlez des cierges à saint Rita, patronne des causes désespérées, rendez-vous en pèlerinage à Lourdes ou à la Mecque, et attendez en croisant les doigts.
Si vous décrochez ce que chez nous, en Belgique donc, on appelle « la floche », vous aurez peut-être la chance que le Monde ou Le Figaro parlent de votre œuvre. Aussitôt, inévitablement, nos journaux belgo-belges s'apercevront de votre existence et penseront à vous « recenser ». De coup, vous aurez, peut-être, un tout petit peu de visibilité et — on peut toujours rêver — un relatif succès.
Quoi qu'il en soit, ne vous fatiguez pas à peaufiner votre style ou à tenter d'améliorer votre éventuel talent. Car le talent, ici, n'a rien à voir.
DURE, DURE, LA VIE D’ÉCRIVAIN ou À LA POUBELLE, LES LIVRES
- Par Liliane Schraûwen
- Le 17/12/2020
- Commentaires (114)
 Je suis avertie par l’un de mes éditeurs (français, en l’occurrence) que sa collaboration avec le diffuseur belge Interforum prend fin, et que je peux donc récupérer, si je le souhaite, les livres qui se trouvent encore en stock chez ce diffuseur, à Louvain-la-Neuve. Je téléphone au diffuseur en question, qui me répond qu’il lui reste 200 exemplaires de cet ouvrage. Bigre ! Vais-je pouvoir embarquer tout cela dans ma (petite) voiture ? Je m’informe de ce qu’il va advenir des bouquins que je ne pourrais emporter. Réponse : « ON LES JETTE ». Vous avez bien lu : ON LES JETTE.
Je suis avertie par l’un de mes éditeurs (français, en l’occurrence) que sa collaboration avec le diffuseur belge Interforum prend fin, et que je peux donc récupérer, si je le souhaite, les livres qui se trouvent encore en stock chez ce diffuseur, à Louvain-la-Neuve. Je téléphone au diffuseur en question, qui me répond qu’il lui reste 200 exemplaires de cet ouvrage. Bigre ! Vais-je pouvoir embarquer tout cela dans ma (petite) voiture ? Je m’informe de ce qu’il va advenir des bouquins que je ne pourrais emporter. Réponse : « ON LES JETTE ». Vous avez bien lu : ON LES JETTE.
Voilà. Vous mettez des mois et parfois davantage à écrire un roman ou un recueil de nouvelles, avec « vos tripes » selon l’expression de l’une de mes consœurs ; vous le polissez et le repolissez sur les conseils de monsieur Boileau ; un éditeur croit en vous (ou fait semblant ?), quand il n’oublie pas de vous verser vos droits d’auteur ; la presse parfois vous ignore ; vous vous faites traiter de vil « marchand du temple » lorsque vous osez diffuser sur FB une photo de votre pauvre petit livre qui se languit tout seul dans un vaste entrepôt, car 3 ans d’âge, pour un livre, c’est pire que le Covid et le cancer réunis. Puis, un jour, votre éditeur et son diffuseur engagent une procédure de divorce, et l’on vous dit sans rire que les exemplaires qui se trouvent encore en attente d’hypothétiques commandes vont être JETÉS. Au rebut. À la poubelle. Comme un vulgaire préservatif usagé, comme une boîte de conserve vide, comme un vieux mouchoir dégoulinant de morve.
Covid et le cancer réunis. Puis, un jour, votre éditeur et son diffuseur engagent une procédure de divorce, et l’on vous dit sans rire que les exemplaires qui se trouvent encore en attente d’hypothétiques commandes vont être JETÉS. Au rebut. À la poubelle. Comme un vulgaire préservatif usagé, comme une boîte de conserve vide, comme un vieux mouchoir dégoulinant de morve.
N’en déplaise aux « artistes » du genre bisounours, je publie donc ici une photo du recueil de nouvelles concerné, accompagnée de deux critiques parues dans La Libre et dans Le Soir, histoire de vous mettre l’eau à la bouche. Ne vous précipitez pas chez votre libraire si vous avez l’intention de secourir une pauvre petit plumitive aussi furieuse que désespérée, ou si ce livre vous tente (c’est la période des cadeaux, je crois ?), ou encore si vous voulez lui éviter de finir dans une décharge. Prenez directement contact avec moi : il m’en reste 200 tout beaux tout neufs… Je vous ferai même une réduction sur le prix officiel qui est de 18,50 €.
Et mille excuses aux bisounours et aux donneurs de leçons qui sans doute frémiront d’horreur à la vue de cette tentative de « marketing », en vertu du principe selon lequel le véritable artiste n’a que faire de considérations mercantiles. Je leur répondrai que le véritable artiste a envie de hurler sa colère et son chagrin face à l’incroyable mépris de ceux qui, justement, considèrent ses œuvres comme des objets que l’on jette s’ils ne sont plus « rentables ». Le diffuseur belge ne les diffuse plus, l’éditeur n’a nulle envie d’investir de l’argent dans leur rapatriement vers son nouveau diffuseur, hexagonal cette fois. Tout cela, somme toute, n’est qu’une affaire de sous. Il ne reste donc que la destruction. À la poubelle, les livres. À la décharge, les écrivains.

Monique VERDUSSEN
Haine et vanités assassines (LIRE – La Libre Belgique 8 mai 2017)
Les pourquoi de ces crimes à deux pas de soi. Sous le regard aigu de Liliane Schraûwen.
Ces choses-là se passent toujours près de chez soi. Benoît Poelvoorde en a fait un film en 1992. Liliane Schraûwen, à sa manière percutante, en a écrit une succession de nouvelles qui, toutes, relèvent d’un ait divers dont on a l’impression d’avoir été informé hier ou avant-hier. Sous une tendresse et des rêves trahis par la vie, souffle toujours chez cette romancière au talent incontestable et à l’expérience éprouvée, une violence, une liberté, voire une méchanceté qui laissent peu de place à la fadeur des sentiments. Si elle ne se fait pas de cadeau là où elle met son « je » en scène, elle n’affiche aucune indulgence envers les vanités, les égoïsmes et les tromperies des autres et, plus particulièrement de ceux qui versent dans le crime. Elle tend pourtant à pointer du doigt les manques ou ressentiments qui les ont fait basculer du mauvais côté de la ligne.
Dès le premier texte qui a pour cadre la soirée inaugurale de la Foire du livre de Bruxelles, un romancier aigri de se trouver oublié de ceux qui l’avaient autrefois reconnu, cible avec une rage assassine le critique jugé responsable de son succès brisé. Et de s’en prendre aux « plumitifs plus ou moins connus » bavardant devant le podium, au discours désastreux du Ministre de la Culture, au public préoccupé du vin à venir plus que de livres et, même, au « Monseigneur à l’air profondément ennuyé… prince de sang parmi les quelques exemplaires que compte notre pays ». Un condensé de férocité. Chaque nouvelle est précédée d’un court texte qui semble échappé de la rubrique Faits divers d’un journal et apporte autant de crédit au crime évoqué dans ses motivations et détails imaginés.
Liliane Schraûwen a, voici trois ans, publié « Les grandes Affaires criminelles » où elle remettait en lumière quelques grands crimes du passé. Elle en a gardé – elle avait sans doute déjà – une curiosité questionneuse pour les criminels de tous bords et les passions qui les animent. De l’académicien qui se fait dérober son dernier et unique manuscrit à l’assassinat d’un dentiste, au fonctionnaire qui se délecte de la souffrance du bourreau, au drame de la jalousie, à l’imprudence de rejoindre l’homme rencontré sur le Net ou aux intentions peu amènes du séducteur sexuel, la palette est vaste où elle puise ses croquis. Chacun aura ses coups de cœur, les nôtres allant plus précisément à l’arnaque du voyant sur des êtres mis en confiance et sur la solitude de la mère vieillissante qui avait aimé ses « petits » sans retenue ni calcul de temps et se retrouve dans le vide de sa maison avec, pour perspective, la déchéance et la mort, n’ayant plus de place dans la vie des siens que par convenance. « Je ne suis plus qu’un souvenir encore un peu vivant, un nom, un visage auquel on pense à l’occasion ». Constat terrible et regard aigu sur les inévitables désillusions de l’âge.
Tous ces gens, victimes et bourreaux, ressemblent à s’y méprendre à ceux que l’on croise au quotidien. Pourquoi ceux-là ? Et comment en sont-ils arrivés là ? Il y a comme une stupeur chez Liliane Schraûwen face à la banalité de faits qui ont dérivé vers le pire. Mais c’est sans états d’âme qu’elle souligne les naïvetés, las haines et les perversions qui se croisent sur les pavés de nos rues. S’il n’est pas un livre drôle, « À deux pas de chez vous » porte un regard souvent sarcastique sur des réalités qui ne laissent pas sans réaction.
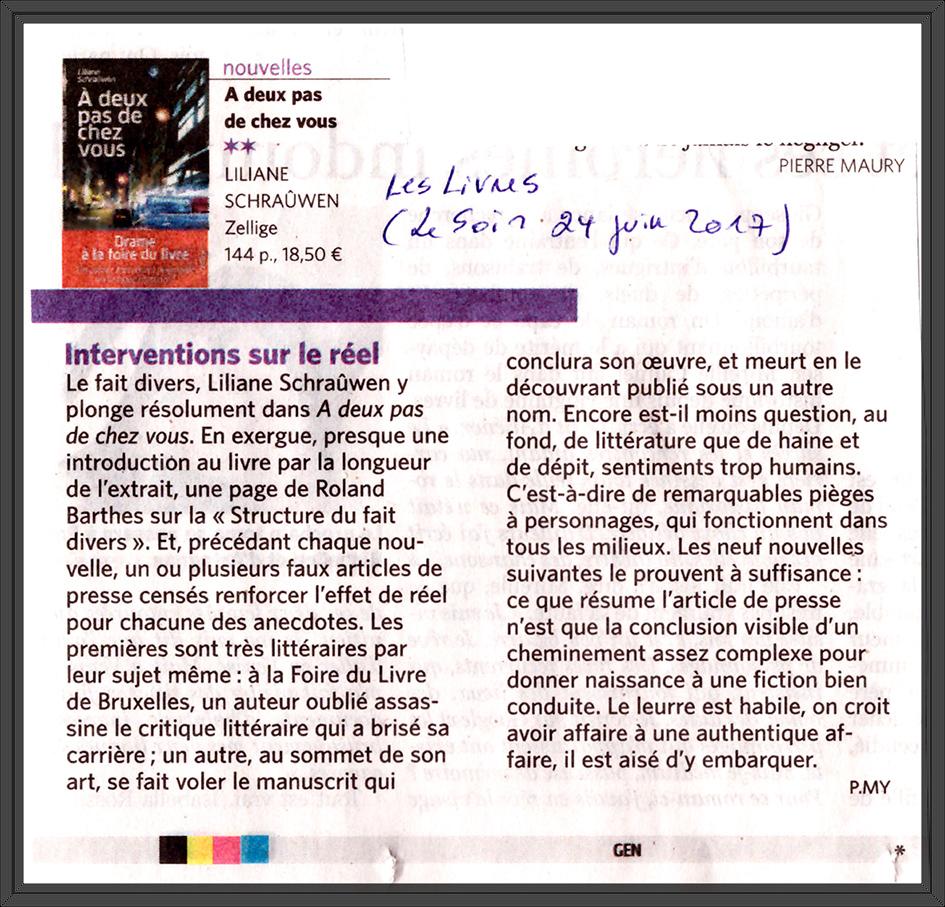
QUAND FB, NOUVEAU CAFÉ DU COMMERCE, CRITIQUE LES PRATIQUES DES ÉCRIVAINS, ou QUAND UN ÉCRIVAIN FAIT LA MORALE À SES PAIRS
- Par Liliane Schraûwen
- Le 10/12/2020
- Commentaires (13397)
 L’un de mes confrères en écriture publie sur FB un joli message dans lequel il parle du « sens du commerce » de « certains collègues auteurs » qui — toujours sur FB — écrivent :" Offrez un de mes bouquins pour Noël". Il ajoute que le sens du commerce est, à ses yeux, Le pire de tous les sens pour un artiste, concluant son texte sur une poétique envolée que je reproduis ici : « Offrez autre chose ou n'offrez rien, vous-même, un baiser sans masque, prenez dans vos bras, donnez ce qui ne coûte rien, ou du miel, ou une orange, ou la promesse de retrouvailles, un compliment, un souvenir d'Ostende, la grâce inouïe d'un sourire aimant, ou des mots qui viendront de vous, avec des fautes et des clichés, on s'en fout. Quelque chose de vous. »
L’un de mes confrères en écriture publie sur FB un joli message dans lequel il parle du « sens du commerce » de « certains collègues auteurs » qui — toujours sur FB — écrivent :" Offrez un de mes bouquins pour Noël". Il ajoute que le sens du commerce est, à ses yeux, Le pire de tous les sens pour un artiste, concluant son texte sur une poétique envolée que je reproduis ici : « Offrez autre chose ou n'offrez rien, vous-même, un baiser sans masque, prenez dans vos bras, donnez ce qui ne coûte rien, ou du miel, ou une orange, ou la promesse de retrouvailles, un compliment, un souvenir d'Ostende, la grâce inouïe d'un sourire aimant, ou des mots qui viendront de vous, avec des fautes et des clichés, on s'en fout. Quelque chose de vous. »
Joli, certes. Mais choquant. Voici donc ce que je réponds à ce message.

Bien sûr, un écrivain ne devrait pas avoir à publier sur FB des invitations à acheter ses œuvres. Mais un écrivain écrit pour être lu. Un écrivain doit aussi manger, se chauffer, etc. Or, à moins de s’appeler Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean Teulé, Amélie…, la société actuelle est ainsi faite que pour manger, il faut de l’argent ; pour être lu, il faut vendre. Quand la presse et la critique vous ignorent, quand on n’est invité ni chez Ruquier, ni chez Barthès, ni chez Busnel ni même chez le répugnant Hanouna, quand un livre est « mort » après trois mois de présence en librairie (dans le meilleur des cas), quand les libraires renvoient les « retours » pour faire de la place aux nouveautés, mémoires présidentiels, traités de nutrition, romans « feel good », révélations complotistes ou extraterrestres, quand notre éditeur historique, selon l’expression consacrée, cesse ses activités et que par conséquent les ouvrages publiés chez lui — chez elle, en l’occurrence — ont cessé d’exister, quand d’autres éditeurs (et je ne parle pas ici de la Belgique) oublient de payer les droits d’auteur, quand certains confrères vous plagient sans vergogne (et je parle en connaissance de cause), comment ne pas être contraint de « faire la pute » ? Ce qui implique ces « post » que tu critiques, de même que notre présence aux salons et foires du livre (qui sont cette année aux abonnés absents).
Il y a une différence, me semble-t-il, entre « avoir le sens du commerce », et souhaiter jouir d’un minimum de visibilité. D’ailleurs, depuis que l’art existe, les créateurs (peintres, musiciens, écrivains) ont toujours été contraints d’exercer ce fameux sens du commerce, vivant de commandes (tels Vinci ou Michel-Ange), de mécénat, se cherchant de riches protecteurs. Le fait que Picasso, Rubens, Matisse ou Magritte — pour n’en citer que quelques-uns — aient été de grands vendeurs enlève-t-il quelque chose à leurs qualités artistiques ? Mozart ne cherchait-il pas sans cesse commandes et protections ?
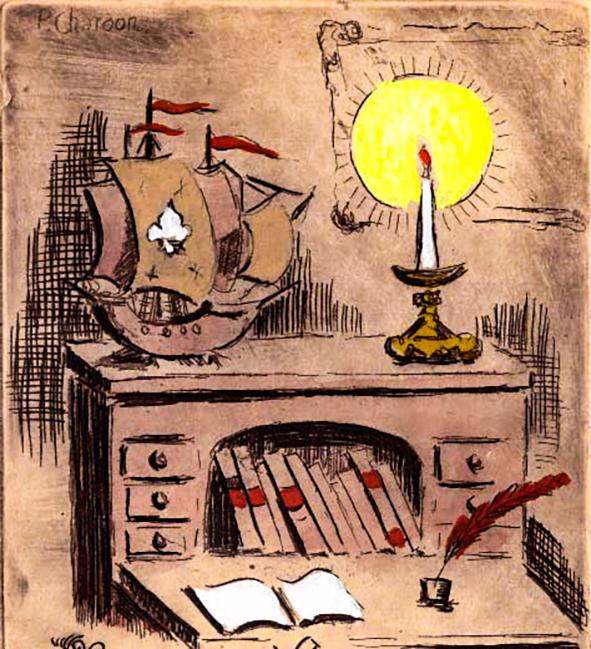
Le mythe du poète romantique et poitrinaire écrivant dans une pauvre mansarde à la lueur d’une bougie est bien joli, certes. Mais les artistes, bons ou mauvais, ont d’abord besoin de survivre, et ensuite d’être reconnus à défaut d’être compris. Plus de mécènes aujourd’hui, plus de rois à historiographier, plus de protecteurs riches et influents. C’est dommage sans doute, même si je ne suis pas certaine d’être prête à me plier aux goûts et exigences de quelque commanditaire fortuné. Il reste Facebook, qui du moins ne contraint pas les vilains écrivains, qui tentent d’acquérir par là un certain « sens du commerce », à soumettre leur talent réel ou supposé aux désidératas de l’un ou l’autre ayatollah. Je déplore tout cela, comme toi. Mais je trouve un peu facile, sinon choquant d’ainsi blâmer tes confrères en écriture qui ne font que chercher là une visibilité que souvent on leur refuse ailleurs.
Un autre de ces « amis » FB — qui quelquefois dirait-on deviennent des ennemis — réagit aussitôt :
« Rien n'est plus triste que de voir un ami se faire moucher par le fleuret cinglant d'une pasionaria de la littérature belge. Vu de l'extérieur, je trouve le mot de XXX d'une justesse tout en finesse pour exprimer ce qui doit rester l'âme de l'écrivain. L'écriture.
Loin de moi ces marchands du Temple qui s'alignent en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur. Journalistes, libraires, bibliothécaires et autres sont là pour se charger, à grands renforts [ndla: la faute d'orthographe d'origine] de tambours et trompettes, de promouvoir les ouvrages des auteurs.
Artiste tu es cher XXX. Laissons le cabot aboyer. Ta plume et tes amis t'attendent. »
Bon. Me voici donc rayée du nombre des « artistes » et reléguée au rang des « cabots » et des pasionarias. Un peu surprise quand même, je me fends d’une réaction, toute littéraire :
« Euh… C’est moi, la pasionaria de la littérature belge ? Et aussi le cabot qui aboie, si je lis bien ? J’aime beaucoup les chiens. Mais je ne suis pas certaine que le substantif « cabot » soit, en l’occurrence, un petit mot affectueux…
Certes, on ne peut que souscrire à l’affirmation selon laquelle « l’écriture doit rester l’âme de l’écrivain ». Mais ledit écrivain souhaite, généralement, être lu. Et donc être acheté (ou vendu) à travers ses œuvres. Malheureusement, si en théorie « Journalistes, libraires, bibliothécaires et autres sont là pour se charger, à grands renforts de tambours et trompettes, de promouvoir les ouvrages des auteurs », la réalité est souvent autre. Pour certains, rares, qui font sérieusement ce boulot (par passion sans doute et non parce que ce serait pour eux un métier, à l’instar de celui des critiques et autres intervieweurs professionnels), combien de ceux-là ignorent les auteurs belgo-belges, pasionarias ou non, au profit des « grands » qui ont l’honneur de se voir publiés dans l’Hexagone, quand ce n’est pas aux USA ou au Japon. Bizarrement, à chaque fois que j’ai publié en France, j’ai eu les honneurs de la radio et même de la télé, de même que lorsque j’ai été primée par la Communauté française de Belgique. Mes dernières productions « littéraires », en dehors des titres consacrés aux Grandes Affaires criminelles de Belgique et autres sujets sanglants de non-fiction, m’ont valu de jolies critiques… mais pas dans les journaux ou médias dits « importants » (à l’exception du Soir, que je remercie au passage de faire correctement son travail).
« Loin de moi ces marchands du Temple qui s'alignent en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur » écris-tu encore. Ah bon ? Tenter de faire savoir via FB ou autrement que tel ou tel livre existe, publié chez un « vrai » éditeur et non sur je ne sais quelle plateforme d’autoédition, quand les grands médias se taisent, est-ce jouer les marchands du Temple ? Mes lecteurs comme ceux de mes confrères en littérature doivent-ils être considérés comme « improbables » ? Ce que j’écris et publie, à l’instar de ce qu’écrivent et publient nombre d’autres écrivains de chez nous, est-il médiocre au point de ne pas mériter de séduire le lecteur, à l’exception de quelques « improbables » ? Que de mépris dans ces propos !
Publier de temps à autre la photo d’un livre oublié des critiques et absent des étals des librairies pour cause de Covid, de réassort ou d’actualité plus brûlante et plus people, est-ce donc « s'aligner en rangs d'oignons dans l'attente de l'improbable lecteur » ?
Pasionaria ou cabot aboyant à la lune, j’avoue que, moi aussi, je déplore le temps et l’énergie perdus à racoler ainsi (si j’ose dire). Mais je déplore plus encore le silence des espaces infinis du petit monde journalistico-littéraire, et je déplore surtout que certains se permettent de critiquer ou mépriser ouvertement les pseudo-cabots et marchands du Temple, quels que soient par ailleurs leur talent ou leur absence de talent, qui, simplement, tentent d’exister en tant qu’écrivains, faisant partie de ceux pour lesquels « l’écriture doit rester l’âme ». Car qu’est-ce donc qu’un écrivain, sinon quelqu’un qui écrit ? Et pourquoi écrit-il ? Pour être lu. Pour partager un peu de cette « âme » avec « d’improbables lecteurs » qui n’ont aucun moyen de savoir qu’il existe si on ne le voit pas à la télé, si on ne l’entend pas à la radio, si les pages de La Libre, du Monde des Livres ou du Figaro littéraires l’ignorent.
Je ne suis ni Guillaume Musso, ni Marc Lévy, ni dans un autre registre Amélie, ni le merveilleux Le Clézio. Ceux-là, en tout cas, n’ont nul besoin de cabotiner sur FB, et tant mieux pour eux. Quant à moi, si dans un avenir « improbable » j’atteins le dixième de leur notoriété, je m’engage à me retirer aussitôt des réseaux prétendument sociaux, et ce sera autant de temps gagné pour l’écriture et pour mon âme. Mais en attendant cette improbable reconnaissance, je continuerai à poster de temps à autre une photo de l’un de mes livres, ou une critique. Juste pour faire savoir qu’il existe un écrivain qui porte mon nom et qui essaye, tant bien que mal, de (sur) vivre.
Pour conclure, je me permettrai de r rappeler que l’ami XXX dont il est question (ami que j’apprécie sur le plan littéraire mais que je connais peu sur le plan personnel, en dépit d’une expédition commune à Mons où il fut question, pour lui et moi, de jouer aux marchands du Temple), cet ami donc, n’hésite pas à se mettre en scène sur FB, publiant avec un beau narcissisme des extraits de livres en cours d’écriture et des projets qui, par définition, sont inaboutis et ne verront peut-être jamais le jour. N’est-ce pas une autre manière, plus subtile mais très efficace, de jouer au marchand du Temple et de racoler « d’improbables lecteurs » ?
Loin de moi l’idée de critiquer cette pratique ; mais que l’on ne me traite pas de « cabot » ou de « marchand du Temple » quand je fais pareil. Sur ce, je m’en vais retrouver ma plume qui m’attend, et mes mots, qui sont mes amis.
Je vous le donne en mille : l’ami de mon ami qui, je le crains, ne sera plus désormais mon ami, s’est fendu d’une réponse que je ne résiste pas au plaisir de recopier ici :
Bon sang, mais c’est bien sûr ! Il est évident que j’avais bien besoin de ces excellents conseils littéraires, conseils que je vais m’empresser de suivre. C’est promis, m’sieur, j’éviterai à l’avenir les épanchements trop longs « comme souvent » ( !), et m’efforcerai à des argumentations plus concises. Surtout lorsque je m’adresserai à un cerveau « basique » (keksèksa ?).
Heureusement qu’il existe de tels maîtres pour expliquer aux écrivains comment il faut écrire… à défaut d’écrire eux-mêmes.
PAUVRE LITTERATURE BELGE
- Par Liliane Schraûwen
- Le 01/10/2020
- Commentaires (136)
- Dans De la littérature
COUP DE GUEULE : TROP IS TE VEEL COMME ON DIT CHEZ NOUS.
L’émission Monts des Arts (télébruxelles) traite ce jeudi d’une grave question : MUSIQUE : NOS ARTISTES SONT-ILS SUFFISAMMENT DÉFENDUS PAR NOS MÉDIAS RADIOS ?
Bonne question, certes. Mais qui, je ne sais pourquoi, m’a un peu énervée. M’a beaucoup énervée. Et en fait, je sais pourquoi.
Je vous explique.
Il est bon et souhaitable, sans doute, de diffuser sur les ondes belges des artistes belges, musiciens ou chanteurs. Quoi de plus naturel ? Il existe d’ailleurs des quotas, plus généreux en Flandre qu’en Communauté française.
Mais je ne peux m’empêcher de me dire qu’une autre catégorie d’artistes, celle à laquelle j’appartiens, celle des écrivains, aurait bien besoin d’être soutenue, elle au ssi, encouragée ou, à tout le moins, reconnue. Or, il est patent que la presse, en général, consacre ses colonnes ou ses ondes radio et télé aux « grands vendeurs », français et rarement belges (suivez mon regard). Il y a pourtant chez nous de nombreux auteurs intéressants, talentueux, originaux, performants, productifs, qui publient chez des éditeurs belges, et auxquels les médias ne s’intéressent que lorsque l’un de leurs livres est primé, « fait le buzz », ou se trouve édité à Paris. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des génies, il existe sans doute, ici comme ailleurs, des écrivains médiocres dont il vaut mieux ne rien dire, et les critiques ont parfaitement le droit d’être subjectifs, d’apprécier ou non tel ou tel auteur, de choisir de le défendre, de l’ignorer, voire de le descendre en flammes.
ssi, encouragée ou, à tout le moins, reconnue. Or, il est patent que la presse, en général, consacre ses colonnes ou ses ondes radio et télé aux « grands vendeurs », français et rarement belges (suivez mon regard). Il y a pourtant chez nous de nombreux auteurs intéressants, talentueux, originaux, performants, productifs, qui publient chez des éditeurs belges, et auxquels les médias ne s’intéressent que lorsque l’un de leurs livres est primé, « fait le buzz », ou se trouve édité à Paris. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des génies, il existe sans doute, ici comme ailleurs, des écrivains médiocres dont il vaut mieux ne rien dire, et les critiques ont parfaitement le droit d’être subjectifs, d’apprécier ou non tel ou tel auteur, de choisir de le défendre, de l’ignorer, voire de le descendre en flammes.
J’aimerais donner un exemple, cependant, si je puis me permettre de citer modestement ma petite personne. J’ai eu les honneurs de la radio et de la télé lorsque j’ai publié aux éditions Régine Deforges aujourd’hui disparues (éditions parisiennes), lorsque j’ai été primée par la Communauté française de Belgique et lorsque j’ai produit de « grandes histoires criminelles » (éditées en France également). Pour le reste… Silence radio (c’est le cas de le dire). Et je connais de très nombreux confrères (et consœurs), dont certains sont excellents, qui rament de la même façon, et qui existent à peine sur le plan médiatique. Par conséquent, le public n’a aucun moyen de découvrir leur production ni, très logiquement, d’avoir la curiosité de les lire. Ces auteurs demeurent donc ignorés pour ne pas dire méprisés, et leurs éditeurs ne vendent guère, ce qui les place dans des situations financières difficiles (ceci est une litote). S’il existe des quotas de diffusion pour les musiques et chansons belges, peut-être faudrait-il penser aussi aux plumitifs qui consacrent plusieurs mois, voire plusieurs années, à concevoir et mettre au jour un roman ou toute autre forme de création littéraire, et dont l’œuvre sombre aussitôt dans le silence et l’indifférence. Si je fumais, même rien qu’un peu, mes droits d’auteur ne suffiraient pas à me payer mes cigarettes.
Les pages « littéraires » des grands journaux belges sont de moins en moins nombreuses, et on y parle davantage de parutions françaises, américaines, chiliennes, vénézuéliennes, britanniques, italiennes, espagnoles… que des nouveautés « de chez nous ». Nul n’est prophète en son pays, ce n’est pas neuf. Mais il serait temps que les choses changent.
Que diable : la littérature belge vivante ne se limite pas à Amélie Nothomb, Adeline Dieudonné, Nadine Monfils ou Jean-Philippe Toussaint… qui publient en France.
Le mythe du poète affamé reclus dans sa mansarde où il aligne les rimes à la lueur d’une bougie est romantique à souhait. Encore faudrait-il que cela reste un mythe. Et que ceux qui écrivent des livres soient – au moins – aussi bien traités que ceux qui chantent, qui composent ou interprètent de la musique.
Mais que font les éditeurs ? Où sont les correcteurs ? À quoi songent les critiques ? Et pourtant il jouit d’un phénoménal succès…
- Par Liliane Schraûwen
- Le 24/03/2015
- Commentaires (38)
- Dans Actualité
 Ma longue carrière de prof et mes activités dans l'édition au sens large m'ont permis de collecter une impressionnante collection de perles et de barbarismes, que d'ailleurs je publierai peut-être un jour. En voici quelques exemples… dus non à un quelconque étudiant qui ne lirait que des SMS ou à un apprenti écrivain dont la langue maternelle ne serait pas le français, mais à un illustre et très vendeur auteur contemporain, encensé par la critique et invité sur de nombreux plateaux de télé. Je précise que je les ai récoltés non pas dans son dernier livre (que je ne compte pas acheter), mais dans les premières pages de cet ouvrage, publiées par le très sérieux magazine « Lire » (n° 433, mars 2015). Estelle Lenartowicz qui présente l'ouvrage n'hésite pas y comparer son auteur à Rabelais et à saluer son « érudition » et son « inventivité stylistique ». C'est le moins qu'on puisse dire !
Ma longue carrière de prof et mes activités dans l'édition au sens large m'ont permis de collecter une impressionnante collection de perles et de barbarismes, que d'ailleurs je publierai peut-être un jour. En voici quelques exemples… dus non à un quelconque étudiant qui ne lirait que des SMS ou à un apprenti écrivain dont la langue maternelle ne serait pas le français, mais à un illustre et très vendeur auteur contemporain, encensé par la critique et invité sur de nombreux plateaux de télé. Je précise que je les ai récoltés non pas dans son dernier livre (que je ne compte pas acheter), mais dans les premières pages de cet ouvrage, publiées par le très sérieux magazine « Lire » (n° 433, mars 2015). Estelle Lenartowicz qui présente l'ouvrage n'hésite pas y comparer son auteur à Rabelais et à saluer son « érudition » et son « inventivité stylistique ». C'est le moins qu'on puisse dire !
- Sa longue chevelure blonde vole derrière son crâne tout en cheveux.
- La demoiselle à la bourre, au corps allégé, libre, et presque glorieux, aperçoit une maison forte avec des tourelles vers laquelle s'approchent (…)
- On dirait, dans l'édifice face à la blondinette, le pétillement d'un vin nouveau qui bout à l'intérieur d'un tonneau et que ça se libère.
- Il semble avoir presque quarante ans et être particulièrement grand.
- Ma sœur fut rappelée à Dieu durant la naissance de sa petite.
- Enfant sortie brillante élève du couvent des bénédictines d'Argenteuil…
- À l'intérieur du salon sombre de son oncle au plafond bas soutenu par des poutres de chêne foncé…
- Je ne vais pas pouvoir.
- Oui, se dilate d'orgueil le chanoine. Il admire le front élevé de la filleule où plane l'intelligence.
- Je fais avec.
- Fulbert, être entier sans nuances au visage comme un groin de pourceau de saint Antoine et autour de la tonsure des cheveux crépus, fait clignoter ses yeux de poule aux paupières bombées.
- Pff, Anselme ! lève les yeux aux poutres Abélard.
Vous avez fini de rire ? Vous avez deviné qui est l'auteur du chef-d'œuvre (aux dires de la critique) dont les seules premières pages recèlent autant de perles ?
Avant de vous donner la réponse, je vais proposer ici mon commentaire à toutes ces hénaurmités et à quelques autres, toujours recensées dans les pages publiées par « Lire ».
- Une très jolie jeune fille sort précipitamment d'une maison à colombages tout en regrettant (…) : très…jolie…jeune…précipitamment : ça fait beaucoup d'adjectifs et d'adverbes, aussi redondants qu'inutiles.
- (…) qui détournent leur regard afin de reluquer cette créature si avenante qui court par un dédale de ruelles pleines de mendiants… « Reluquer » est un anachronisme flagrant (sans même parler de l'inélégance du terme) ; quant aux « ruelles pleines de mendiants », elles constituent une impropriété : un verre peut être plein (de vin), une pièce peut être pleine d'objets. Une rue est plutôt peuplée de mendiants, hantée de mendiants… Il aurait été plus joli et plus correct d'écrire, par exemple : « un dédale de ruelles où se pressent des mendiants nombreux »…
- Ses chaussures sont comme des ballerines entre lesquelles cavalent des poules affolées et sa longue chevelure blonde vole derrière son crâne tout en cheveux. Le ballet (et donc les danseuses nommées ballerines) n'est apparu qu'au XVème siècle ; la chaussure du même nom date du XXème siècle. Le verbe « cavaler » est un autre anachronisme, car il n'apparaît qu'au XVIème siècle. En outre, ce terme est inapproprié lorsqu'on parle de poules. De même, si les oiseaux – et les avions – peuvent voler, ce n'est pas le cas d'une chevelure (sauf bien sûr si elle s'est détachée du crâne auquel elle appartenait) ; quant à l'expression « un crâne tout en cheveux », elle est totalement incorrecte et incompréhensible. Sans compter la lourdeur de la répétition chevelure – cheveux dans la même phrase.
- La demoiselle à la bourre, au corps allégé, libre, et presque glorieux, aperçoit une maison forte avec des tourelles vers laquelle s'approchent (…). « à la bourre » : argotique et anachronique ; une maison forte = ??? ; on ne s'approche pas « vers » quelque chose, mais on s'approche « de » quelque chose.
- La petite porte du bâtiment sévère s'ouvre en une fente verticale qui baille. C'est alors semblable à un bourdonnement d'abeilles. Bailler = donner ; bâiller = « être entrouvert, mal fermé ou ajusté ; dans le cas présent, il fallait donc ne pas omettre l'accent circonflexe. De plus, une porte peut bâiller, mais une fente ne bâille pas, puisque ce mot désigne une ouverture et non un objet ouvert. Quant à la 2ème phrase, elle est incorrecte et incompréhensible ; à quoi renvoie le « c' » ? À l'extrême rigueur, on aurait pu écrire : « c'est alors comme un bourdonnement… », le « c' » étant dans alors impersonnel, mais pas « c'est semblable à… », car dans ce cas « semblable » est attribut du sujet « c' » qui ne peut donc être impersonnel.
- On dirait, dans l'édifice face à la blondinette, le pétillement d'un vin nouveau qui bout à l'intérieur d'un tonneau et que ça se libère. Les diminutifs en –et, ette datent du XVIème siècle. Que l'on se souvienne de la Pléiade (qui n'était pas encore une collection Gallimard) et de son manifeste, le fameux « Défense et Illustration de la langue française ». De plus, pour ce que j'en sais, un vin ne bout pas, ni dans un tonneau ni ailleurs. Quant à la fin de la phrase, elle est incompréhensible et incorrecte. Qu'est-ce qui se libère ???
- (…) trois écoliers acnéiques aux voix grêles pleines de crénoms, déclarant, dont un en latin : « … ». Des voix pleines… ??? Quant au mot « crénom » (qu'il aurait au moins fallu écrire entre guillemets ou en italiques, s'il veut représenter les paroles que prononcent les écoliers en question), il n'apparait pour la première fois dans la langue française qu'en 1832.
- (…) il nous faut s'ébattre. Erreur flagrante de construction : « il nous faut nous ébattre », ou bien « il faut s'ébattre » ; en aucun cas on ne peut associer le « on » et le « nous » dans la même phrase pour désigner la même réalité.
- Des bottes de paille palallélépipédiques, alignées en rang d'oignons, font office de bancs. « en rang d'oignons » : cette expression date de l'extrême fin du XVIème siècle et signifie « rangés en ligne, l'un derrière l'autre, comme des oignons dans un potager » ; elle ne peut s'appliquer à des bancs…
- Elle remarque un homme de dos et debout mais plié en deux sur sa chaire. Tout ça ??? « courbé » aurait été plus correct, et plus joli : « courbé sur sa chaire (ou "au-dessus de son pupitre".
- Il semble avoir presque quarante ans et être particulièrement grand. Illogique : on est grand ou on ne l'est pas, mais on ne peut sembler grand.
- Une cagoule sur la tête lui couvre aussi les épaules. Cette phrase est incorrecte. On aurait pu écrire : « la cagoule qu'il porte sur la tête lui couvre aussi les épaules ».
- Ma sœur fut rappelée à Dieu durant la naissance de sa petite. ??? « durant » est une impropriété dans ce contexte. La mort, par définition, ne se situe pas dans la durée, pas plus que la naissance qui désigne l'instant où l'enfant sort du ventre maternel : « elle a été rappelée à Dieu au moment de son accouchement ; elle est morte en donnant le jour à l'enfant… »
- Enfant sortie brillante élève du couvent des bénédictines d'Argenteuil où elle a appris la lecture et la grammaire, je désire que maintenant qu'elle habite avec moi en ce presbytère, à dix-huit ans, elle se perfectionne… Le début de la phrase est évidemment incorrect. Je suppose que l'auteur veut dire qu'elle a été une enfant brillante, et une élève brillante, et qu'elle a fait ses études au couvent des bénédictines : « elle fut une élève brillante au couvent (…) où elle a appris la lecture et la grammaire ». En outre, la répétition du mot QUE en fin de phrase est à déconseiller : « et je désire, aujourd'hui qu'elle réside chez moi, la voir se perfectionner… »
- À l'intérieur du salon sombre de son oncle au plafond bas soutenu par des poutres de chêne foncé et allant (qui « va » ? le salon ? l'oncle ? le plafond ? les poutres ? le chêne ?) dans un bruissement de tissu sur des tomettes couvertes d'hysope, le mélisse et de menthe fraîche, Héloïse, dorénavant vêtue d'une cottardie à large décolleté et fentes latérales, cherche quelque chose. J'aimerais bien le rencontrer, cet « oncle au plafond bas » ; quant au mot « dorénavant », il signifie « à partir du moment présent, à l'avenir » : la pauvre Héloïse est-elle donc condamnée à ne plus porter « dorénavant » que la cottardie en question, à l'exclusion de toute autre toilette ?
- Abélard, assis sur un banc, parcourt du regard le logis de l'ecclésiastique qui, chapelet entre les doigts, lui a formulé sa requête du fond de son grand fauteuil à dos sculpté. Un escalier à vis aux pierres disjointes doit mener aux chambres de l'étage. Ciel ! Quelle accumulation d'adjectifs et de notations aussi lourdes qu'inutiles : « sur un banc - de l'ecclésiastique - chapelet entre les doigts - du fond de son fauteuil – grand - à dos sculpté - à vis - aux pierres disjointes »…
- Le gros prélat âgé, bras sur le côté, tisonne un feu. Les bûches de résineux projettent dans la cheminée des petites explosions d'essence. Même remarque : en quoi tous ces détails sont-ils utiles au récit : « gros – de résineux – petites »… ? Quant aux « explosions d'essence », elles se passent de commentaires, de même que la notation « bras sur le côté »…
- Puisque j'enseigne déjà à l'école Notre-Dame, je ne vais pas pouvoir. Il s'exprime drôlement mal, l'illustre et médiéval philosophe. Le moindre potache qui me dirait qu'il « ne va pas pouvoir » encourrait ma colère et prendrait certains risques…
- Je fais avec. Même remarque !
- Je ne suis pas friand du gingembre. On dit (et on écrit) « friand de » et non « friand du », à moins que le produit cité soit accompagné d'un complément : « friand du gingembre que contient ce vin », par exemple, mais « friand de gingembre » (en général). Tout comme moi, qui ne suis guère friande de barbarismes en général, ni des barbarismes innombrables que recèle ce texte, en particulier.
- Fulbert, être entier sans nuances au visage comme un groin de pourceau de saint Antoine et autour de la tonsure des cheveux crépus, fait clignoter ses yeux de poule aux paupières bombées. Accompagner l'adjectif « entier » de la précision « sans nuances » est évidemment un pléonasme. Quant à la description du « visage comme un groin (…) et autour de la tonsure des cheveux crépus », elle me semble formulée dans une langue assez éloignée du français, qu'il soit actuel ou médiéval…
- C'est important d'être intraitable dans la vie… Vous, quand vous étiez scolare, vos professeurs sont dû l'être avec vous aussi. « vous, vos professeurs ont dû l'être » : construction tout à fait incorrecte.
- — Pff, Anselme ! lève les yeux aux poutres Abélard. ??? J'aurais pu à la rigueur comprendre et accepter une formulation comme « Pff, Anselme ! soupire Abélard en levant les yeux ». Mais « Pff, lève les yeux Abélard » ressemble à une mauvaise traduction qu'aurait proposée Google de je ne sais quelle langue exotique. D'autant qu'on peut lever les yeux « vers les poutres », mais certes pas « aux poutres », même s'il arrive qu'on lève les yeux au ciel (et c'est bien ce que j'ai fait à la lecture toutes ces horreurs).
- … tousse le gros prélat dont la croix pectorale rebondit sur sa bedaine. « dont – sa » : pléonasme grammatical. Il eût fallu écrire « … dont la croix rebondit sur la bedaine »).
- — Oh, ben en tout cas, j'ai récupéré ma clepsydre ! « Ben en tout cas » ??? étrange et anachronique langage pour une jeune personne vivant au début du XIIème siècle.
- Elle s'en amuse d'un grand rire qui la secoue de la tête aux pieds. Son parrain, tel Zeus, d'un pli des sourcils la réprimande : — Héloïse, cesse de t'esclaffer ainsi. « S'esclaffer de rire » : 1ère occurrence en 1534, devient courant à la fin du XIXème siècle. Or, sauf erreur, Héloïse et Abélard ont vécu au début du XIIème siècle. Quant à « réprimander quelqu'un d'un pli des sourcils »… mieux vaut en rire, j'imagine.
- Il en ouvre des grands yeux stupéfaits (cliché) du genre : « Elle est gonflée, celle-là ! » Anachronisme : cette expression – vulgaire, faut-il le préciser – est très récente. Quant à l'expression djeuns « du genre », elle est plus anachronique encore.
- — Oui, se dilate d'orgueil le chanoine. Correction : « oui, dit le chanoine en se dilatant d'orgueil ». Que je sache, « oui » correspond à un mot que l'on prononce et non à un phénomène de dilatation, fût-il même métaphorique.
- Il admire le front élevé de la filleule où plane l'intelligence. Mmm… comme j'aimerais, moi aussi, être dotée d'un front élevé où planerait l'intelligence, tel sans doute un aigle dans les cieux… Allons, monsieur l'écrivain renommé, achetez donc un dictionnaire, et vérifiez-y le sens du mot « planer » (et de quelques autres).
- Il se retourne vers le vitrail de la fenêtre. Ces deux mots constituent évidemment un pléonasme.
- Une fille qui poursuivrait ses études ne serait pas chose courante en ce temps où le savoir ne trouve jamais de prise dans le sexe féminin. « Une fille » (même au moyen-âge) ne peut être définie comme « une chose » (courante ou non). Quant au « savoir qui ne trouve pas de prise dans le sexe féminin », j'ai mis un moment à comprendre (après m'être remise de la crise de fou rire qui m'avait secouée) qu'il s'agit sans doute d'un « temps où le savoir n'est guère répandu parmi les femmes » (tout comme la maîtrise de la langue française ne trouve pas toujours de prise, de nos jours, dans le sexe masculin !!!). Oui, je sais, cela doit être douloureux…
- … la filleule aux formes d'une rare perfection. Jolie phrase pour un livre qui serait publié chez Harlequin.
- La nuit venant, l'air est encore frisquet. Frisquet ??? Ce mot, dérivé d'un terme flamand, a été créé au XIXème siècle. Mais nous n'en sommes pas à un anachronisme près !
- La soie de la cottardie roule en courts frissons sur la peau de la nièce semblant innocente encore même d'une caresse. Ouille ! comme le dit si bien le titre de cet impérissable amas de barbarismes et d'incohérences : cette phrase est totalement incompréhensible. Ajoutons pour compléter notre collection d'anachronismes que l'on ne trouvera de la soie en France que quelque 40 ans plus tard.
- Menton légèrement creusé au milieu tel que par le doigt de la réflexion qui se pose sous ses belles lèvres, elle répond, mimant un air fataliste. Tout aussi étrange… Outre la construction incohérente de cette phrase, je précise qu'on ne peut « mimer » « un air », puisque « mimer » signifie précisément « exprimer sans le secours de la parole » c'est-à-dire…" prendre l'air de"… : mimer la colère, mimer la peur…
- Il pose sa main droite d'homme sur l'épaule gauche et arrondie de l'orpheline. « Il » étant un pronom masculin, on peut en déduire que « sa main » est de toute évidence celle d'un homme. Du moins, il me semble…
Vous avez trouvé, bien sûr. Pour ceux qui auraient un doute, je précise : Jean TEULÉ, Héloïse, ouille, éd. Fayard. Consternant, isn't it ?
Ce qui me sidère, ce n'est pas que tel ou tel auteur commette des fautes ou fasse des erreurs. Errare humanum, comme disait l'autre, et sans aucun doute, il m'arrive d'errer, moi aussi. Mais autant de crimes contre la langue en si peu de pages, quand même… Et surtout, comment expliquer qu'un ouvrage truffé de fautes, un ouvrage qui semble n'avoir été relu ni par son auteur, ni par ce « premier lecteur » que tout écrivain se devrait de consulter, ni par l'éditeur (sauf à supposer que celui-ci soit quasiment analphabète), ni a fortiori par le moindre correcteur, ait pu franchir les obstacles que rencontre tout écrivain sur la route de la publication ? Comment comprendre qu'aucun critique, pas plus dans la presse écrite qu'à la télévision ou à la radio, n'ait formulé la plus petite remarque quant à l'écriture de cette montagne d'anachronismes et d'attentats contre la grammaire et la sémantique ? Où était donc le sniper de Laurent Ruquier, l'inénarrable et chevelu Aymeric Caron qui cependant se targue de traquer les plus petites erreurs grammaticales des ouvrages qu'il commente ? Jean Teulé serait-il intouchable ?
Ce silence universel et cet unanime flot de louanges nous en apprend beaucoup, ce me semble, sur les médias en général. Et sur l'édition, inutile de le préciser.
Pendant ce temps, de pauvres plumitifs qui n'ont rien pour plaire aux médias (ni grands chapeaux, ni conjoint, amant ou "ex" célèbre, ni passé sulfureux, ni parrain people…) continuent de noircir du papier dans l'ombre, de publier chez de courageux éditeurs qui s'intéressent plus à la valeur d'un texte qu'au look ou au carnet d'adresses de son auteur. Sans qu'aucun critique les remarque, sans que nulle part on ne parle d'eux, et donc sans que le public ait la moindre chance de découvrir qu'ils existent.
Critique des critiques
- Par Liliane Schraûwen
- Le 15/01/2015
- Commentaires (4)
- Dans De la littérature
 Lu dans Le Soir sous la plume de Jean-Claude Vantroyen :
Lu dans Le Soir sous la plume de Jean-Claude Vantroyen :
Comment choisir les livres dont on vous rend compte ?
C'est le problème permanent des suppléments littéraires ; ceux-ci sont limités : par l'espace et par la capacité de ses journalistes à lire intelligemment le plus de livres possible. Alors que l'offre des éditeurs apparaît plutôt illimitée : 549 romans cette rentrée de janvier. Comment rendre compte de cette abondance ? À raison de 80 pages à l'heure par journaliste, et c'est un maximum, et à raison de 250 pages par roman, or il y a des pavés de 800 pages, il faudrait 72 jours complets, 24 heures sur 24, pour lire ces 549 ouvrages. C'est impossible, même à plusieurs. Alors on choisit. De façon très subjective évidemment, comment faire autrement ? Il y a bien sûr les incontournables, comme Houellebecq, Despentes, Banks ou Barnes.ms il y tous les autres. Alors, on est attiré par un résumé, une couverture, le conseil d'un attaché de presse, la lecture d'une critique dans un autre média, la possibilité d'un entretien. Aléatoire, oui. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que ce choix est fait en toute honnêteté, sans aucune pression d'où qu'elle puisse venir.
Article de Jean-Claude Vantroyen dans Le Soir
(supplément Les Livres) du 3 janvier 2015.
Je ne suis pas journaliste, je n'ai guère de visibilité médiatique… Mais j'ai eu envie de réagir. Voici donc le texte que je n'ai pu m'empêcher d'adresser à Jean-Claude Vantroyen. Texte resté sans réponse, bien sûr.
J'ai lu avec des sentiments mitigés votre « oblique » du 3 janvier dernier, en admirant au passage votre maîtrise de l'arithmétique. 549 romans, 80 pages à l'heure, 250 pages par roman, 72 jours de 24 heures sur 24… Impressionnant !
Dans la mesure où je ne suis pas seulement écrivain mais aussi professeur, et où il m'est arrivé d'enseigner la sociologie de la littérature en me référant à des chiffres plus ou moins semblables, tout cela ne m'étonne guère, bien évidemment. Tout comme ne m'a jamais étonnée la somme de livres neufs (et parfois agrémentés de la dédicace adressée par le malheureux auteur au chroniqueur surchargé) que l'on trouve chez les bouquinistes de la rue du Midi, quelquefois même avant leur présence sur les étals des librairies. Je compatis, croyez-le bien, au triste sort de ces bourreaux de travail que sont les journalistes littéraires qui cependant ne manquent pas de compensations financières, via justement la revente des centaines d'ouvrages qu'ils n'ont pas eu le temps, ou pas pris la peine, de feuilleter.
Mais, je vous l'avoue, je compatis plus encore au sort des malheureux plumitifs – parmi lesquels je me classe en bonne place – qui ne sont pas tous « incontournables » comme les Despentes, Houellebecq, Banks ou Barnes que vous citez, noms glorieux auxquels il convient bien sûr d'ajouter (dans le désordre et sans mettre en cause leur intérêt littéraire) Nothomb, d'Ormesson, Rambaud, Darrieussecq, Boyd, Auster, Djian, Murakami, Rolin, Modiano, Le Clézio, Olivier Adam, Zeller, Khadra, van Cauwelaert, Schmitt, Grangé, Maalouf, Duroy et bien d'autres. Sans oublier Zemmour à l'occasion, les duettistes Lévy-Musso ou Musso-Lévy, les innombrables chanteurs, journalistes de télé et autres personnalités médiatiques ou people qui mettent à profit leur notoriété pour se fendre d'un roman vaguement autobiographique le plus souvent dû à la plume d'un nègre désargenté. Autant d' « incontournables » auxquels il convient d'ajouter les anciens, morts et enterrés depuis quelques décennies, mais classiques et réédités. Et puis, écrivez-vous, « il y a tous les autres », parmi lesquels est effectué un « choix honnête et aléatoire ». Honnête, je n'en doute pas. Quant à être aléatoire… Motivé parfois, c'est vous qui le précisez, par « le conseil d'un attaché de presse, la lecture d'une critique dans un autre média, la possibilité d'un entretien… ». Pas tellement aléatoire, donc. Le conseil d'un attaché de presse, qu'est-ce d'autre que de la publicité, en somme ? Quant à « la lecture d'une critique dans un autre média », elle me permet d'enfin comprendre un mystère qui jusqu'à ce jour m'était resté impénétrable. Je ne me demanderai plus, désormais, comment il se fait que tous les journaux et suppléments littéraires de France et de Belgique recensent systématiquement les mêmes ouvrages, laissant peu de place et moins encore de chance à la cohorte des obscurs, des sans-grade, des « contournables » qui, par manque de visibilité médiatique, se voient ipso facto retirés des rayons des librairies après quelques jours à peine, un ou deux mois dans le meilleur des cas, au profit de piles de « Despentes, Houellebecq, Banks ou Barnes »… N'est-il donc pas d'autres critères de choix que le hasard, l'argumentaire des attachés de presse ou le premier tri effectué par quelque confrère ? Pour avoir aussi travaillé dans l'édition, je sais qu'il suffit parfois de lire quelques pages au hasard ou de parcourir les premiers feuillets d'une œuvre pour s'en faire une idée. Si l'on ajoute à cela la quatrième de couverture, le titre, le genre, le nombre de pages et, le cas échéant, ce qu'on sait de l'auteur, on possède des éléments certainement aussi fiables que ceux auxquels vous vous référez. Et, tant qu'à pratiquer l'aléatoire, pourquoi ne pas tout simplement choisir au hasard les ouvrages à lire et recenser ? Du moins cette pratique laisserait-elle quelque chance aux presque inconnus, aux auteurs débutants comme aux vieux briscards qui n'ont jamais connu la gloire mais qui persévèrent, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans laisser couler deux le sang des mots qui les habitent. Une autre idée, en passant : les journaux belges pourraient – pourquoi pas – accorder une attention particulière aux auteurs belges, comme le font les Québécois et les Suisses dans les pages de leurs publications. Quelqu'un l'a dit avant moi : nul n'est prophète en son pays (surtout en Belgique semble-t-il), mais ne serait-il pas temps d'inverser la vapeur, et de faire découvrir, aux lecteurs des pages culturelles et littéraires de nos journaux et magazines, les talents du cru ?
Je me dis, en arrivant au bout de ce billet d'humeur, que peut-être je manque de prudence et que, selon l'expression populaire, je ne fais ici rien d'autre que me tirer une balle dans le pied. Car ce texte pourrait vous apparaître comme un accès de narcissisme doublé de basse jalousie, ou comme une tentative maladroite d'attirer sur moi l'attention qui parfois me fait défaut. D'autant que bientôt va paraître un nouvel opus signé de mon nom, que sans doute vous avez déjà reçu en service de presse… Mais bon… Je prends le risque.
Merveilleuse Tempête
- Par Liliane Schraûwen
- Le 05/05/2014
- Commentaires (6)
- Dans De la littérature
Un nouveau Le Clézio… Enfin. Tempête : « Deux novellas » selon le sous-titre et la quatrième de couverture de l'ouvrage. Voilà donc un mot qui vient enrichir la langue française puisque, comme l'écrit l'auteur, « en anglais, on appelle novella une longue nouvelle qui unit les lieux, l'action et le ton ». Si le genre sans doute est universel, le terme, quant à lui, est bien anglais. Ni le Littré ni le Robert en neuf volumes ne le connaissent. Mais je ne doute pas que, dans la foulée du bilingue et lumineux Prix Nobel, il apparaisse prochainement dans les dictionnaires et les manuels de littérature. Rien de surprenant, d'ailleurs, à ce que l'auteur de tant d'œuvres dans lesquelles figurent, presque toujours, le thème du signe – qu'il soit linguistique ou matériel – et celui du langage, de la communication, des langues dites étrangères, recoure une fois de plus à l'usage d'un mot venu d'ailleurs.
J'aurais plaisir à intégrer ce terme dans la refonte de mon syllabus, si j'enseignais encore, à l'expliquer, à lire et analyser avec mes étudiants, qui continuent à me manquer avec violence, des extraits de ce nouveau chef d'œuvre. Car je ne me console pas d'avoir atteint, comme je l'ai écrit par ailleurs, cette fameuse « limite au-delà de laquelle votre ticket n'est plus valable » selon l'expression d'un autre géant de la littérature. Ce n'est pas tant l'idée (et la sensation, quelquefois) de vieillir qui est en cause, que la relation tissée avec tous ces jeunes et moins jeunes qui, au fil des années, me sont passés entre les mains (si j'ose dire). Je me souviens notamment d'un Cédric qui, ayant découvert avec moi Le Clézio au travers de Mondo, est venu me dire que ce texte avait changé sa vie et sa vision du monde… Très souvent, il m'arrive encore de me rêver, la nuit, face à un groupe d'étudiants auxquels je parle de Camus, de Le Clézio ou d'un autre, ou de m'éveiller brusquement à l'idée qu'il va me falloir intégrer tel ou tel élément dans mon cours du lendemain. J'ai aimé passionnément ce métier, et l'âge ne change rien à l'affaire : je crois avoir été un bon prof, et je sais que je le serais encore si la bureaucratie absurde ne me l'interdisait pas.
Mais trêve de nostalgie et de regrets inutiles. Parlons plutôt de ce Tempête, ou plus exactement de la première novella, qui donne son titre au recueil. Car, comme les enfants devant un mets qu'ils aiment, je le savoure lentement, à petites doses, et je n'ai pas entamé le second texte. C'est comme cela qu'il faut lire les grands auteurs, ceux qui ont un style et une vision, ceux dont l'écriture nous emporte par sa splendeur. J'ai entendu François Busnel, récemment, affirmer que ce livre était le plus beau que Le Clézio eût écrit. Je ne sais pas s'il est le plus beau. Il y en a eu bien d'autres avant lui qui m'ont émerveillée, tels Onitsha, Révolutions, les nouvelles de Mondo, Désert, Le Chercheur d'or, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il est vrai que Tempête est une pure merveille, par sa sobriété, par la maîtrise des récits croisés (encore une caractéristique récurrente chez l'auteur), par ses deux personnages (« en marge » comme souvent dans son œuvre, et ici ils le sont tous les deux, Philip Kyo et l'adolescente June), par le décor, par ce thème obsessionnel chez lui du voyage, du départ et de l'errance, par les espaces vierges que sont dans ses textes le désert et la mer, et surtout par la beauté de l'écriture. Comme presque toujours lorsqu'on lit Le Clézio, on se trouve littéralement transporté en cet ailleurs où il nous emmène. Les couleurs, le bruit de la mer, le vent, les odeurs, on les perçoit, on les sent. Quelques exemples ?
« La brume s'épaissit à l'horizon. Il me semble que nous sommes sur un bateau, en partance vers l'autre bout du monde. »
« Je suis venu ici pour voir. Pour voir quand la mer s'entrouvre et montre ses gouffres, ses crevasses, son lit d'algues noires et mouvantes. Pour regarder au fond de la fosse les noyés aux yeux mangés, les abîmes où se dépose la neige des ossements. »
« Cette nuit-là était sans lune, le ciel s'ouvrait et se fermait de nuages. J'ai regardé les étoiles dans une anfractuosité de rochers, près de l'endroit où les femmes de la mer se déshabillent. J'ai même trouvé une grève de sable noir, et j'ai creusé une petite vallée pour me mettre à l'abri du vent. J'ai regardé le ciel, j'ai écouté la mer. (…) Je suivais des yeux les étoiles, elles glissaient en arrière, la terre tombait. »
« La nuit envahit l'île. Chaque soir, flaque après flaque, crevasse après crevasse. La nuit sort de la mer, sombre et froide, elle se mélange à la tiédeur de la vie. »
Rien à dire, après ça. Se taire et admirer.
Et je ne vous parle pas des descriptions qu'il fait ici d'étreintes charnelles, ce qui est assez rare chez lui pour mériter d'être souligné. Mais d'une telle beauté…
De Lubumbashi à Bruxelles
- Par Liliane Schraûwen
- Le 01/01/2014
- Commentaires (0)
- Dans De la littérature
Cela fait près d'une dizaine de jours que je suis revenue du Katanga, où j'ai participé au Premier Salon du Livre de Lubumbashi, organisé par le CELTRAM (Centre d'études littéraires et de traitement de manuscrits) et « sous le haut patronage du gouvernement provincial du Katanga ». Sans doute est-il temps de faire le point sur cette aventure.
Belle expérience, en vérité. Enrichissante et enthousiasmante.
Trois jours consacrés au Salon proprement dit : les 12, 13 et 14 décembre, dans les locaux du Musée national de Lubumbashi. Communications et débats se sont succédé à un rythme effréné (et épuisant), autour de quatre thèmes :
- La problématique de l'édition en Afrique. Expériences et témoignages.
- La problématique de la librairie en Afrique. Expériences et témoignages.
- La gestion et la consommation du livre. Expériences et témoignages des bibliothèques africaines.
- Pour qui écrire ? (voir billet précédent).
Des rencontres, des découvertes, des surprises.
Trois jours durant lesquels, au Salon mais aussi le matin, le soir, pendant les repas, je me suis trouvée en contact avec des fous de belles-lettres et de culture littéraire ; trois jours passés à discuter littérature, écriture, lecture, philosophie et même théologie, pratiquement jour et nuit. Avec des confrères écrivains, avec des professeurs, avec des libraires de Bukavu, avec un jésuite nommé Simon-Pierre (ça ne s'invente pas…), avec des étudiants… Et tout cela agrémenté de cet irrésistible humour typiquement congolais, bon enfant et joyeux, autour de l'inévitable bouteille de Simba. Reçue, ainsi que les autres invités lointains, comme des rois, encadrés, pris en charge, avec deux gentils doctorants chargés de nous seconder et de combler nos moindres désirs (si j'ose dire). L'un d'eux d'ailleurs va – peut-être – se lancer dans une thèse sur Le Clézio ; inutile de préciser que mon aide lui est acquise…
De nombreux participants avaient été invités, venus de Kinshasa, de Bukavu, de Bruxelles et d'ailleurs. Parmi eux, j'étais la seule femme, et la seule « blanche ». Honneur redoutable dû à mes racines katangaises et à mon amour pour ce pays autant qu'à mes modestes talents littéraires, j'imagine. Honneur redoutable, oui, mais tellement gratifiant et enrichissant.
Étrange ville où des milliers de gens se veulent « écrivains », ce qui est assez facile puisque, pour mériter ce titre, il suffit de voir imprimé son nom sur la couverture d'un « livre » qui, le plus souvent, n'est qu'un opuscule d'une vingtaine de pages. On commet un texte, roman, pièce de théâtre, essai, puis on paye quelques dollars à un imprimeur qui fait de tout cela « un livre » que l'on s'en va vendre aux « librairies-trottoir » ou « à la sauvette ». Comme l'a dit l'un des intervenants, ces écrivains transportent avec eux leur librairie et leur maison d'édition, dans une mallette qu'ils serrent sur leur cœur. Parmi leurs petits fascicules, on trouve donc le pire, mais aussi le meilleur. C'est dire que l'idée d'une « vraie » maison d'édition, avec comité de lecture, telle que l'envisage le professeur Amuri, serait la bienvenue.
J'écoutais discuter les participants sur les problématiques proposées, et je ne pouvais m'empêcher de penser à Kalemie, à ce mois que j'y ai passé en 2007 sans voir ne serait-ce qu'une seule page imprimée, à ces containers de livres que nous y avons envoyés, à cette bibliothèque que nous avons tenté d'y créer, aux médicaments et autres lits médicalisés, fauteuils roulants, seringues et matériel médical divers envoyés pour aider l'hôpital général. Surtout, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'échec de tout cela, échec lié à la désorganisation, à la corruption, aux excès d'autorité de fonctionnaires qui se soucient comme d'une guigne des besoins réels de la population…
Étrange pays, en vérité. Mais Lubumbashi n'est pas Kalemie, et ce Salon a existé. J'ai pu y vérifier l'effervescence autour de la lecture, de l'écriture, de la littérature au sens large.
Pendant mes rares moments de liberté, j'ai revu des amis anciens : Mireille, Alain, Euphrasie, Vérydienne, Virginie… Avec Euphrasie, je me suis rendue dans l'une des cités misérables de cette métropole qui compte 7 millions d'habitants. J'ai visité, à la Katuba, l'une ou l'autre école créée par les Sœurs de Saint-Joseph, j'ai parlé à ces enfants, à ces adolescents dont le seul espoir d'avoir une vie meilleure que celle de leurs parents se trouve, précisément, dans cet enseignement rare, précieux, et trop coûteux pour la plupart de ces gens qui survivent à peine, aux marches de la ville, de la vente de quelques morceaux de makala, de bananes ou de mangues cueillies sur l'arbre… Je revois le regard vif brillant d'un gamin, un crayon posé sur l'oreille, qui me disait qu'il avait envie, lui aussi, d'écrire des livres… Je revois le sourire incrédule d'une fillette qui avait entre les mains l'un des petits bouquins que j'ai publiés chez Averbode, arrivé là je ne sais comment, et qui comparait sans y croire ma photo, en quatrième de couverture, avec l'original en chair et en os.
Deux mondes totalement différents : celui des « intellectuels » de haut vol rencontrés au Salon, et celui de ces milliers de gosses déguenillés et illettrés, sur les chemins de latérite des cités, qui s'étonnaient de voir un visage blanc…
Moments de liberté… si l'on peut dire. J'ai lu des manuscrits, rencontré leurs auteurs, parlé avec eux, puisque je fais partie désormais du comité de lecture de la maison d'édition naissante du Professeur Amuri.
Le dimanche 15 décembre, les autres invités s'en sont tous retournés chez eux : à Bruxelles, à Kin, au Kivu et ailleurs. Pas moi, car je m'étais engagée à animer un atelier d'écriture de trois jours (les 16, 17 et 18 décembre). Je me suis donc retrouvée seule à « La Procure » où je logeais, au troisième étage, barza ouverte sur la cour intérieure peuplée de 6 ou 7 corbillards tendus de tentures mauves, non loin de la cathédrale qui sonnait je ne sais quelle prière à grandes volées de cloches bruyantes à cinq heures puis à six heures du matin…
Si le Salon du livre m'a intéressée, s'il m'a passionnée, je peux dire que l'atelier m'a comblée.
Une douzaine d'écrivains ou de candidats écrivains (11 hommes et une femme, un médecin, le « docteur Ginette ») de tous âges et de tous niveaux avaient été sélectionnés par le professeur Amuri. Pendant ces trois jours, j'ai passé avec eux toutes mes matinées et tous mes après-midis, et même les temps de midi, au centre d'art Picha. Le but était que chacun des participants, au terme de ces trois jours, produise le texte d'une nouvelle, de quoi constituer un recueil collectif qui devrait être publié par la Maison d'édition qu'est en train de créer Maurice Amuri.
Chacun lisait aux autres ce qu'il avait écrit : le portrait du personnage principal d'abord, puis le synopsis du récit et enfin la nouvelle achevée. Tous commentaient ensuite le texte lu, et je n'ajoutais mon grain de sel qu'en fin de parcours, si nécessaire. Je me suis régalée… Bien sûr, les textes étaient d'inégales valeurs. Mais j'ai découvert là deux ou trois petits bijoux, et autant de talents véritables. Et, surtout, un désir fou d'apprendre, de s'améliorer, un rêve d'écriture et une passion inimaginables sous nos latitudes. Je pense notamment à Jean-Chryso TSHIBANDA, poète et slameur, dont l'écriture est belle et fluide, et dont la maîtrise de la langue est parfaite. Son œil était plus sévère parfois que le mien, et plus pointilleux. Ses commentaires et ses critiques anticipaient souvent mes propres remarques. Très vite, je l'ai appelé « Maître » et « Monsieur l'académicien » avec un demi-sourire, en me disant in petto que certains professeurs de Belgique ne lui arrivent pas à la cheville.
Chacun donc critiquait et commentait les textes des autres, mais toujours avec une sorte de délicatesse policée qui veillait à ne pas blesser, à ne pas vexer, commençant par souligner les qualités du texte avant d'en évoquer les faiblesses. Quant à moi, je répondais aux questions, je donnais quelques conseils, je proposais des exemples (merci Le Clézio, Balzac, Kessel et quelques autres). Je traçais des pistes et je commentais et discutais, parmi les autres, les productions des participants. J'écoutais aussi, je découvrais. Travail collectif donc plus que directif. J'espère avoir été de quelque utilité à mes disciples, mais eux, en tout cas, m'ont beaucoup apporté.
Bref, une expérience enthousiasmante. Et tout cela sous un soleil entrecoupé des averses violentes de la saison des pluies que j'ai retrouvées, après plus de 50 ans, avec délice. Et dans l'odeur de la terre africaine, sa couleur, ce monde de fragrances, de poussière rouge, de fleurs lumineuses… Cette impression, dès que je mets le pied sur le sol du Congo, de me retrouver chez moi. Même si, « chez moi », c'est avant tout Albertville ou Kalemie où, sans doute, je n'irai plus jamais…
Merci au destin qui m'a offert ce cadeau, à cette succession de hasards et de rencontres qui ont rendu cela possible. Merci à ceux qui m'ont invitée chez eux, et reçue avec générosité et amitié.
Écrire… Oui, mais pourquoi ? Pour qui ?
- Par Liliane Schraûwen
- Le 29/12/2013
- Commentaires (0)
- Dans De la littérature
Voici donc le texte de cette communication.
J'avoue que je suis tout d'abord restée perplexe. Une seule réponse me semblait évidente : « pour moi ». C'est pour moi que j'écris, parce que j'en ai besoin. Tant mieux si par chance mes textes trouvent un éditeur. Tant mieux s'ils sont lus. Tant mieux s'ils sont aimés. Et si un jour on me décerne le prix Nobel (on peut toujours rêver…), je ne le refuserai pas, et je me dirai une fois de plus : « tant mieux ».
Mais avant tout, avant la recherche d'éditeur, avant les rêves de reconnaissance, il y a le besoin d'écrire. Je crois que même sans être publiée et donc, forcément, sans être lue, j'écrirais encore. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde peut être lu, plus besoin d'éditeur pour cela, il y a Internet…
Mais ce qui est premier, ce qui est fondamental, c'est la soif d'écrire, le besoin d'écrire, presque aussi vital que la soif d'eau claire ou le besoin de pain. Dans mon cas, cela a toujours été ainsi. Inventer des histoires, oui, sans doute. Créer des mondes. Raconter. Mais avant tout, ou plutôt surtout, le plaisir de jouer avec les mots. Les marier entre eux, les heurter, les apparier, les faire danser sur la page ou sur l'écran, les écouter chanter dans ma voix qui les lit à mi-voix, ou dans ma tête où ils résonnent.
Lorsque j'enseignais la littérature à mes étudiants, un moment venait toujours où se posait la question de savoir ce qu'est « un vrai écrivain ». Attention, je ne dis pas « un bon écrivain », car il y a là quelque chose de relatif, de subjectif, et certains sont forcément meilleurs que d'autres. Le génie, le talent au superlatif, ça existe. Contentons-nous donc de parler du « vrai écrivain ». Je disais à mes étudiants qu'il faut, pour entrer dans cette catégorie, 5 conditions, qui doivent se trouver réunies. Ces conditions sont les suivantes :
- Un véritable écrivain est toujours mû, à mon sens, par un besoin quasi pathologique d'écrire. Et quand j'emploie le mot « pathologique », ce n'est pas une figure de style.
- Il doit, consciemment ou le plus souvent inconsciemment, avoir créé un univers qui est caractéristique, identifiable, que l'on retrouve d'œuvre en œuvre, de livre en livre.
- De même, ce que j'appelle « le vrai écrivain » a-t-il une thématique qui lui est propre. Là aussi, c'est un phénomène qui n'est pas voulu, qui n'est pas conscient. Mais lorsqu'on se penche sur l'œuvre d'un grand auteur, on retrouve quelques thèmes, toujours les mêmes, thèmes qui la traversent et la sous-tendent.
- Il possède également un style reconnaissable entre tous, qui le définit et qui fait partie de lui. Un style qui fait que lorsqu'on lit quelques pages de lui, on se dit quelque chose comme « on dirait du Le Clézio »… « Si ce n'est pas lui, c'est un excellent imitateur… »
- Enfin, bien sûr, (et c'est le minimum), il doit maîtriser la langue dans laquelle il s'exprime.
Vous aurez remarqué que la première de ces 5 conditions est, à mon point de vue, le besoin absolu et irrépressible d'écrire, un besoin tel que l'on se sent mal quand on a laissé passer du temps sans pratiquer cette coupable activité… Bien sûr, cela ne suffit pas : il y a des tas de gens qui ressentent ce besoin mais qui n'ont rien à dire, ou qui le disent si mal que c'est un vrai désastre… Condition nécessaire donc mais pas suffisante.
Cela répond donc – un peu – à la question du « pour qui écrire » : pour soi avant tout, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Comme le drogué qui se trouve en état de manque quand il n'a pas pris sa dose.
En mars 1985, le magazine Libération a sorti un numéro spécial portant non pas sur le « pour qui écrire », mais sur le « pourquoi écrire ». De très nombreux écrivains avaient été interrogés ou lus, et leurs réponses n'allaient pas toutes dans le même sens. J'en ai quand même retenu certaines, qui m'ont semblé exprimer ce « besoin pathologique » dont je parlais tout à l'heure, tout comme j'ai noté certaines phrases au fil de mes lectures.
Georges SIMENON (Pourquoi écrivez-vous ? Libération, mars 1985, p. 23)
J'écris parce que j'ai dès mon enfance éprouvé le besoin de m'exprimer et que je ressens un malaise quand je ne le fais pas.
Milan KUNDERA (Pourquoi écrivez-vous ? Libération, mars 1985, p. 68)
Ne serait-ce qu'une ridicule illusion, on est persuadé d'écrire parce qu'on a à dire ce que personne n'a dit.
Isaac ASIMOV (Pourquoi écrivez-vous ? Libération, mars 1985, p. 47)
J'écris pour la même raison que je respire, parce que si je ne le faisais pas, je mourrais.
Marguerite Duras
Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale et découvrir que seule l'écriture vous sauvera.
S. de Beauvoir
Le projet d'écriture n'est pas fou. Poussez un peu, dites ce qui vous tient le plus à cœur, on n'atteint les autres qu'en se livrant.
Marc Cholodenko
Écrire a toujours été, d'abord inconsciemment (sinon ce n'eût pas commencé), puis consciemment, question de survie.
John IRVING interviewé par Raphaëlle RÉROLLE in Le Monde des Livres du 6 octobre 2006
Je me tue à cela. Quelque chose me pousse vers la narration. Ce n'est pas d'ordre intellectuel, mais émotionnel ou compulsif. En tout cas, cela m'est aussi nécessaire que de manger ou de dormir – d'autant que je ne mange ni ne dors beaucoup.
On le voit, la notion de « besoin » est fondamentale. Mais de nombreux écrivains vont plus loin, et l'on voit apparaître, derrière le « pourquoi », la notion du « pour qui » : les autres, mes amis, mon peuple, les lecteurs, une personne en particulier…
Jorge Amado (écrivain brésilien)
[…] j'écris pour être lu, avoir une influence sur les gens et ainsi modifier la réalité de mon pays, en créant pour le peuple qui souffre la perspective d'une vie meilleure, et en portant haut les drapeaux de la lutte et de l'espoir. Je pense que la littérature est une arme du peuple, que l'écrivain est l'interprète des désirs et des combats de son peuple.
Lev Kopelev (écrivain allemand)
J'écris parce que je veux parler aux autres – ou ne serait-ce qu'à une seule personne – d'événements, d'impressions, de pensées, qu'il me semble indispensable de conserver, de fixer; parce qu'à l'aide du verbe j'essaye de résister à la destruction, à la mort, au néant. Je veux suspendre l'instant.
Jorge Luis BORGES cité par Jean d'ORMESSON in Le Figaro Littéraire (10/06/1999)
J'écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps.
Joël DICKER, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert
Écrire, cela signifie que vous êtes capable de ressentir plus fort que les autres et de transmettre ensuite. Écrire, c'est permettre à vos lecteurs de voir ce que parfois ils ne peuvent voir.
Philippe DJIAN interviewé par Raphaëlle LEYRIS in Le Monde des Livres (31/8/2012)
J'écris pour donner à d'autres ce que la découverte de la littérature m'a offert comme lecteur.
Éric-Emmanuel SCHMITT interviewé par Francis MATTHYS in La Libre Culture (27/9/2000)
Bien que je ne sois absolument ni un provocateur ni un hérétique, j'écris pour provoquer de la pensée, pour faire réfléchir.
Douglas KENNEDY interviewé par Raphaëlle RÉROLLE in Le Monde des Livres (25/5/2012)
L'écriture est un acte public. J'écris exactement ce que je veux, mais je le fais pour mes lecteurs, c'est évident. Pas pour le marché, pour eux.
Hervé de SAINT-HILAIRE in Le Monde des Livres (27/8/1998)
Un écrivain, même monstrueux, même ridicule, un écrivain donc dont un livre a une fois consolé ne fût-ce qu'une seule personne ne saurait être tout à fait mauvais.
Éric-Emmanuel SCHMITT interviewé par Francis MATTHYS in La Libre Culture (27/9/2000)
La fonction de l'écrivain : être un semeur. Qui fait penser tout en divertissant.
Beaucoup d'écrivains, donc, ont le souci du lecteur.
Et moi ?, me suis-je demandé. Ai-je ce souci ? Qui est-il, mon lecteur idéal, celui à qui je parle peut-être à travers mes textes, sans en être bien consciente ? Existe-t-il ?
Je me suis souvenue alors du moment où, toute petite, j'ai eu envie de devenir écrivain, même si sans doute je ne connaissais pas ce terme. C'était, justement, à Kalemie. Mon père, tous les soirs, me prenait sur ses genoux et me lisait quelques pages d'un roman pour enfants. Je me souviens, encore aujourd'hui, du nom de l'auteur, de certains titres, de certaines histoires. C'étaient des livres à la couverture cartonnée, vert clair, un peu granuleuses sous les doigts. J'insiste sur ce point : il ne me les racontait pas, il me les lisait. Je n'avais pas six ans, je ne savais pas lire moi-même, et ces phrases, ces mots que j'entendais, je ne les comprenais pas tous. Mais j'écoutais, et je ressentais un plaisir infini à sentir, d'une certaine manière, ce qui restait obscur, ce qui se cachait derrière les mots. Je me disais, par moments, que c'était beau. Non pas l'aventure qui était le sujet du livre, mais la manière dont elle était racontée. Le style, en somme. Je me souviens très bien avoir pensé que moi aussi, un jour, quand je serais grande, j'apporterais ce même plaisir à d'autres. En quelque sorte, ma vocation était née.
Le temps a passé, la vie a coulé. J'ai dû m'occuper de ma famille, j'ai dû travailler. J'écrivais des petites choses, pour moi, des bribes, des textes courts, des poèmes. Juste pour moi. Et puis un jour, j'ai passé le cap. J'ai envoyé un manuscrit à un éditeur, il a été publié. Et j'ai continué. Et si je veux être honnête, oui, il y avait à chaque fois un lecteur rêvé (ou plusieurs). Le premier de tous, celui pour qui j'ai écrit et pour qui, peut-être, je continue d'écrire, je crois bien qu'il ne m'a jamais lue. C'était mon père. C'était un peu comme si je voulais lui montrer que j'en étais capable. Je savais que, dans sa jeunesse, il avait eu des projets d'écriture, lui aussi. J'avais envie qu'il soit fier de moi. Mais il était malade et n'était plus capable de lire des ouvrages de ce genre, et après, il est mort. S'il a lu ne serait-ce que quelques pages de mon cru, il ne m'en a jamais rien dit. J'ai écrit pour mes enfants, aussi. Pour qu'un jour ils comprennent certaines choses… Pour qu'ils me connaissent mieux, peut-être. Je ne crois pas avoir atteint mon but, là non plus. Tant pis… Au fond, quand vous écrivez une lettre, l'important n'est pas qu'elle soit lue, mais que vous l'ayez écrite. C'est un peu comme un voyage : ce qui compte, ce n'est pas d'arriver quelque part, mais de se mettre en route et d'avancer. Si mon père ne me lira jamais, si les enfants pour lesquels j'ai écrit n'ont pas lu ou pas compris, eh bien, d'autres pères et d'autres enfants, quelque part, peut-être, très loin dans l'espace et dans le temps, liront et vibreront. Ne fût-ce qu'un seul. C'est déjà beaucoup.
Et puis il y a eu d'autres lecteurs, d'autres destinataires. J'ai publié un recueil de nouvelles intitulé « Race de Salauds »… et je crois bien que chacun de ces textes était destiné à un salaud spécifique… Mais s'ils m'ont lue, ils n'ont pas dû se reconnaître. Je doute d'ailleurs que les vrais salauds s'intéressent à la littérature…
Je ne sais pas s'il faut écrire pour quelqu'un, finalement, je veux dire pour quelqu'un d'autre que pour soi. Ceux à qui l'on s'adresse, le plus souvent, n'ouvrent pas le courrier, ou bien ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Et l'on peut alors être amèrement déçu.
Je préfère l'image de la bouteille à la mer. Vous y glissez un message, une lettre d'amour, un poème, une réflexion profonde, un appel au secours peut-être, ou un cri de haine et de révolte, et vous la jetez dans le fleuve. Avec un peu de chance, elle s'en ira jusqu'à l'océan, ballotée sur les vagues. Le temps passera et puis, un jour, quelque part, très loin, quelqu'un la trouvera. Une femme inconnue lira vos mots d'amour, un enfant se mettra à rêver… Vous, l'auteur, vous serez très vieux déjà, ou bien mort depuis 100 ans, 200 ans, mais qu'importe. Quelqu'un, quelque part, vous aura reconnu.
En Europe, de temps à autre, il existe des concours de ballons pour les enfants. On gonfle des ballons à l'hélium. Chaque enfant accroche à son ballon une carte avec son nom, son adresse, un message s'il le souhaite, et puis le ballon s'envole. Parfois l'enfant reçoit, très longtemps après, une petite carte venue de loin : quelqu'un a trouvé son message porté par le vent. Mais le plus souvent, il ne se passe rien. Le message n'est arrivé nulle part, ou bien celui qui l'a découvert n'y a rien compris… C'est ça, la vie. C'est ça, écrire, ai-je pensé : c'est accrocher aux nuages des phrases plus légères que le vent, et les regarder monter dans l'air pur…
J'en étais là de mes réflexions lorsqu'on a annoncé la mort de Nelson Mandela. J'ai cessé de rêver et d'écrire, et j'ai regardé la télévision. Partout, on racontait sa vie, son combat. Et puis une chaine de télévision a diffusé le magnifique film que Clint Eastwood lui a consacré, Invictus, avec Morgan Freeman dans le rôle de Mandela. Je l'avais déjà vu, mais je l'ai regardé à nouveau.
Invictus… Plusieurs fois dans le film, on voit Mandela sous les traits de Freeman réciter ce poème de William Ernest Henley que plus personne ne connaît ni ne lit aujourd'hui, mais dont le poème a traversé le temps, notamment grâce à Mandela (et à quelques films et séries télé). Un tout petit poème, quatre quatrains à peine, écrit par un homme mort en 1903 mais ressassé par un prisonnier noir de l'apartheid – et quel prisonnier ! – un tout petit poème qui, dira-t-il souvent, l'a aidé à survivre et à résister.
Voilà, me suis-je dit, pour qui écrivait l'Américain William Ernest Henley : pour cet homme qui n'était pas né mais qui, un jour, se nourrirait de ces 16 vers…
Le voilà, le lecteur idéal : un inconnu qui peut-être, un jour, quelque part, dans très longtemps, dira « c'est beau », et ce sera déjà beaucoup… Un inconnu qu'un poème aura aidé à vivre.
Tristes tropiques et désolante « Équation africaine »
- Par Liliane Schraûwen
- Le 29/12/2013
- Commentaires (0)
- Dans De la littérature
J'ai essa yé. Je vous jure que j'ai essayé. Parce que sans doute j'avais aimé l'un ou l'autre de ses livres précédents (tout en regrettant parfois des faiblesses de style, mais que celui qui n'a jamais péché…). Quand même, quand j'ai appris en 2008 que cet auteur avait déploré publiquement que le prix Nobel ne lui fût pas attribué, à lui qui le méritait, prétendait-il, autant sinon plus que Le Clézio, je me suis dit qu'il ne faut pas exagérer, que l'on ne mélange pas les serviettes avec les torchons, que la vanité poussée à ce stade mériterait sans doute quelque visite chez un psychiatre, et que la quantité de « perles » récoltées chez lui au fil de mes lectures méritaient effectivement un prix du genre « prix Nobel de la faute de français » ou « prix Nobel de la circonlocution bavarde ». Mais il n'est pas le seul à se prendre au sérieux dans le monde des plumitifs ni à manquer de rigueur dans l'écriture, et mon dossier « perles et autres fautes » comporte bien d'autres références, hélas. Bref, pas de quoi fouetter un chat, me suis-je dit. J'ai donc acheté (en Pocket) et tenté de lire « L'équation africaine », à cause sans doute du mot « africain » auquel je résiste rarement. La critique d'ailleurs avait été bonne.
yé. Je vous jure que j'ai essayé. Parce que sans doute j'avais aimé l'un ou l'autre de ses livres précédents (tout en regrettant parfois des faiblesses de style, mais que celui qui n'a jamais péché…). Quand même, quand j'ai appris en 2008 que cet auteur avait déploré publiquement que le prix Nobel ne lui fût pas attribué, à lui qui le méritait, prétendait-il, autant sinon plus que Le Clézio, je me suis dit qu'il ne faut pas exagérer, que l'on ne mélange pas les serviettes avec les torchons, que la vanité poussée à ce stade mériterait sans doute quelque visite chez un psychiatre, et que la quantité de « perles » récoltées chez lui au fil de mes lectures méritaient effectivement un prix du genre « prix Nobel de la faute de français » ou « prix Nobel de la circonlocution bavarde ». Mais il n'est pas le seul à se prendre au sérieux dans le monde des plumitifs ni à manquer de rigueur dans l'écriture, et mon dossier « perles et autres fautes » comporte bien d'autres références, hélas. Bref, pas de quoi fouetter un chat, me suis-je dit. J'ai donc acheté (en Pocket) et tenté de lire « L'équation africaine », à cause sans doute du mot « africain » auquel je résiste rarement. La critique d'ailleurs avait été bonne.
Donc, j'ai essayé. J'ai péniblement atteint la page 210 d'un livre qui en compte 349. Deux cent dix pages d'un sinistre pensum, au terme desquelles j'ai déclaré forfait, sans avoir ne serait-ce que la curiosité de savoir ce qu'il adviendrait de ce docteur Krausmann bavard et sans relief. Je me suis prodigieusement ennuyée tout au long d'innombrables descriptions aussi mornes que le désert qui constitue le cadre du récit, et surtout très mal écrites : clichés, phrases interminables, erreurs de ponctuation, adjectifs à profusion (et souvent inadéquats), comparaisons et métaphores qui prêtent à rire, impropriétés, constructions fantaisistes… Sans même parler du fait qu'un médecin allemand, un Français coureur de désert et des rebelles noirs appartenant à un pays désertique mais indéterminé s'expriment tous dans un français truffé d'expressions familières ou argotiques en une profusion de discours aussi bavards que tout à fait improbables…
Comment, mais comment, ai-je pensé, un éditeur sérieux peut-il accepter de publier un texte aussi mauvais, c'est-à-dire aussi mal écrit ? Comment la critique peut-elle encenser un auteur qui, s'il était l'un de mes étudiants et présentait un TFE rédigé de la sorte, n'obtiendrait pas les six dixièmes de points nécessaires à sa réussite ?
Quelques exemples parmi les dizaines d'autres que j'ai répertoriés ? Lisez plutôt :
- Il revient sur ses pas en frémissant d'une rage hypertrophiée…
- Dans son visage massif, d'un noir de charbon, ses narines papillonnent, cadençant les spasmes qui se sont déclenchés sur ses pommettes.
- Quatre jours et quatre nuits interminables à me limer les os sur un sol rêche…
- Le sol est dur et accidenté : les véhicules rebondissent dessus à s'esquinter.
- C'est un territoire pierreux, anthracite, que la désertification ronge à satiété.
- Je suis choqué par la liberté dévergondée avec laquelle les voleurs dépouillent des gens aussi miséreux…
- Nous débouchons sur un plateau d'une virginité cosmique…
- Tassé comme une borne, très noir de peau, enfaîté d'un crâne tondu vissé aux épaules, sans cou et sans menton, l'officier…
- Son visage n'a pas de traits, juste une sphère cabossée aux narines dilatées qu'animent deux yeux globuleux aussi vifs que la foudre.
- C'est un quinquagénaire amaigri aux longs cheveux chenus.
- Sa carcasse colmate l'embrasure de la porte.
- Il est assis sur son séant (bonjour le pléonasme !)
- Mes réflexes se sont avachis.
- Lorsque la poussière s'est estompée au large, un étau me presse le cœur comme un citron. (J'y penserai lorsque je me préparerai un jus de fruits…)
- Mes anxiétés se surpassent.
- Jessica avait les joues prises entre ses poings translucides.
- …un butor véhément affublé d'une bouche assez grande pour gober un œuf d'autruche.
- C'est une zone à haut risque, et on est que six (sic).
- Son regard laiteux cherche à faire rentrer sous terre tout ce qu'il rase.
- La plus grande des solitudes, on la contracte face à un peloton d'exécution.
- Les balles me traversaient de part et d'autre.
- J'avais les yeux fixés dans le ciel.
Et ceci n'est qu'un modeste florilège…
La première qualité d'un prétendu écrivain, me suis-je encore dit, n'est-elle pas de maîtriser à peu près correctement la langue dans laquelle il a choisi de s'exprimer ? Tout le reste vient ensuite : thématique, sujet, message pseudo-philosophique et autre nécessité intérieure. Si « le bon usage » est celui des auteurs publiés et adoubés par la critique, on peut redouter le pire pour notre pauvre langue française… Critiquons donc « les jeunes » et leurs textos, la presse, Internet, l'enseignement… Déplorons la désaffection des adolescents face à la lecture, pourquoi pas ? Mais si vous voulez le fond de ma pensée, il vaut mieux ne rien lire, parfois, que lire un tel ramassis de barbarismes…
Allons, monsieur Yasmina Khadra, vous valez mieux que ça. Votre « Cousine K. » l'a prouvé jadis, et aussi votre « Attentat » qui cependant présentait les premiers symptômes de la maladie qui aujourd'hui vous « ronge à satiété » pour reprendre l'une de vos surprenantes images. Permettez-moi de vous le dire en toute modeste confraternité : ce n'est pas en écrivant ainsi que vous l'aurez, ce prix Nobel dont vous rêvez…
Vous lecteurs également valent mieux que ça. Le moindre des respects à leur égard n'est-il pas de leur offrir le meilleur de ce que vous pouvez produire, plutôt que de remplir de platitudes illisibles des pages qui mériteraient d'être relues et corrigées ? Quant à votre éditeur, je ne peux que lui suggérer de recourir aux services d'un correcteur compétent, voire d'un rewriter… ou d'un nègre. Ainsi resterions-nous en Afrique… dans une Afrique qui, elle aussi, mérite mieux que cette triste équation.
Soirée Pen CLub ou... Les charmes de l'autofiction
- Par Liliane Schraûwen
- Le 12/06/2013
- Commentaires (2939)
- Dans De la littérature
Me voilà donc à me garer rue Ducale, le long du Parc Royal, vers 17 h 45. Il faisait doux, ce qui vaut la peine d'être noté, vu le climat dont nous jouissons – si l'on peut dire – en ce printemps humide et glacial. Les oiseaux gazouillaient, les joggeurs joggaient sous les ombrages.
Petit périple dans les jardins du Palais des Académies avant de trouver la bonne entrée, escalier monumental, dorures, portes multiples… Quelques rangées de chaises dans une vaste salle où le public s'installe sous l'œil sévère d'un tout jeune Baudouin qui nous domine sur un mur latéral, en pied et en grand uniforme, une épée de cérémonie devant lui. Devant nous, une table derrière laquelle s'installeront les vedettes du jour en compagnie d'Huguette de Broqueville , l'inaltérable et sans doute perpétuelle présidente du Pen Club de Belgique, et de Nicole Verschoore qui officiera en tant qu'animatrice et intervieweuse, et dont j'apprends qu'elle est « Docteur en philosophie et lettres, Boursière du Fonds national de Recherche scientifique et assistante à l'Université de Gand ». J'ai une pensée pour Michèle Lenoble-Pinson qui sans nul doute eût préconisé l'emploi du terme « docteure ». Tiens, c'est vrai, elle n'est pas présente ce soir. Étonnant.
Une toile d'Albert Ier par Opsomer, d'une facture plus expressive et plus artistique que la représentation de son petit-fils, agrémente avantageusement le mur qui nous fait face. Un peu partout le long des autres murs, des bibliothèques remplies de livres, des bustes d'écrivains morts depuis belle lurette, une lettre encadrée de Jean Cocteau et d'autres traces d'un passé aussi mort et figé que le bronze et le marbre qui nous entourent.
Les gens arrivent, s'installent. Hésitant entre l'amusement et l'atterrement, je me dis que, décidément, le niveau d'âge (et de conservation) de ceux qui fréquentent ce genre de manifestation est plus proche d'un nombre à trois chiffres que du degré zéro (de l'écriture, ou de l'état civil). Un jeune homme dont j'apprendrai qu'il est étudiant en psychologie (ce qui explique sans nul doute son intérêt pour « l'écriture de soi ») fait tache parmi cette profusion de vieillards tous plus ou moins podagres. Outre le juvénile étudiant égaré en ces lieux, quelques très rares jeunots ayant à peine dépassé la cinquantaine observent leurs aînés avec curiosité, inquiétude, agacement, mépris, pitié peut-être… Moi, perdue dans le troupeau, j'ai un peu honte de mon manque de charité. D'autant que, pour un œil extérieur, je ne dépare sans doute pas ce cacochyme aréopage, même si je marche (encore) sans canne ni béquilles... J'aperçois Jacques De Decker, secrétaire perpétuel de notre belge académie, qui s'éclipsera bien avant la fin. Je reconnais Edmond Morel qui ne me reconnaît pas. Dominique Aguessy me sourit, et je me dis qu'elle ne doit pas se sentir dépaysée, vu le niveau d'âge de ceux qui participent aux soirées AEB… C'est à croire que la littérature en Belgique ne s'écrit et ne se lit qu'au-delà de la soixantaine bien sonnée. Je me prends à regretter d'être venue, agacée par les raclements de gorge, les quintes de toux, les confidences « murmurées » de malentendants à d'autres malentendants…
Mais voici – enfin – qu'Huguette de Broqueville d'abord, Nicole Verschoore ensuite, prennent la parole. La première lit difficilement un petit texte de présentation de ses invités, dans un brouhaha où se mêlent bavardages, grincements d'un parquet antique et malmené, arrivées tardives de malpolis incongrus. Comme quoi l'âge, me dis-je, n'est pas une garantie de bonne éducation.
Nicole Verschoore à son tour entre dans l'arène. On peut être Docteur ou Docteure, me dis-je encore, et avoir cependant bien du mal à s'exprimer en public, à structurer sa pensée et son propos, à capter l'attention d'un auditoire, à se faire entendre… Et puis, enfin, on permet à Serge Doubrovsky de parler. Cela fait un moment que j'observe ce jeune homme de 85 ans. On me l'a enseigné à l'université, je l'ai lu et enseigné à mon tour à des générations de ces petits crabes tant aimés, mais jamais je ne l'avais vu. Il ne ressemble guère à ce que je sais de lui. Beau visage, sympathique, avec dans le regard une sorte de curiosité, de fraîcheur presque enfantine. Il parle, il explique, il raconte. Passionnant, ce diable d'homme. Il a longtemps été professeur (bonjour, collègue !), et sans nul doute a-t-il dû captiver ses étudiants. Il éclaire le concept d'autofiction dont, de toute évidence, la plupart des personnes présentes ne savent pas grand-chose. Il dessine les liens qui unissent l'homme réel qu'il est ou qu'il a été à celui qu'il met en scène dans ses livres. Il parle de lui, forcément. Il le fait avec talent. Il évoque la mort de sa mère, nous dit que son entrée en autofiction (si j'ose dire) vient de sa psychanalyse. On s'en serait douté, tant ces deux démarches sont proches. Camille Laurens d'ailleurs nous expliquera ensuite que, pour elle aussi, la psychanalyse fut déterminante.
Moi qui ne suis pas très amatrice d'autofiction et moins encore de psychanalyse, je me surprends pourtant à écouter avec passion les propos de Doubrovsky d'abord, de Camille Laurens ensuite, tant ces propos sont… « intelligents ». Je ne trouve pas d'autre terme pour définir ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment (et ils ont bien du mérite, vu le caractère fumeux et abscons des commentaires et des questions de leur intervieweuse). Comme on se régale devant un feu d'artifice, comme on se délecte d'une musique bien interprétée, d'une pièce de théâtre réussie, d'un texte « génial » (au sens propre), je savoure ce festival d'intelligence auquel il m'est donné d'assister. Doubrovsky nous dit qu'au stade où il est arrivé aujourd'hui, il pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre roman et autobiographie. Il cite Rousseau, bien sûr. « Nous sommes sans cesse en train de nous inventer » - « Nous sommes tous à la fois dans la réalité et la fiction ». Il truffe son récit et ses explications d'anecdotes personnelles. Il parle de lui aussi bien qu'il en écrit, et tant pis s'il y a dans son projet d'écriture quelque chose qui continue de me rebuter, comme toutes les formes d'autofiction, surtout quand elle interfère dans la vie et le réel d'individus bien vivants (ou bien morts…). « Il n'y a pas d'opposition absolue : autofiction et autobiographie sont deux modes narratifs sur sa propre vie ».
Au mépris de toute logique, Nicole Verschoore décide de nous faire la lecture d'un passage dans lequel l'aspect visuel de la page est essentiel (les « blancs » qui aèrent ou qui trouent le texte) : je renonce décidément à comprendre sa démarche. Elle pose des questions du genre « je vous interroge sur votre lyrisme » ou « êtes-vous sentimental », avant d'expliquer à Doubrovsky et au public médusés qu'elle ne posera pas les questions qu'elle voudrait poser, ou qu'il n'y a plus rien à dire… Doubrovsky nous parle du miracle que fut sa vie, de toutes ces morts qu'il a vécues : le risque d'arrestation en 1943, la tuberculose et le sanatorium en compagnie de Roland Barthes (le même Roland Barthes que l'inénarrable et inculte Naguy a nommé récemment « Bartès »). Il n'a pas peur de la mort, nous dit-il, pour l'avoir connue souvent déjà : « je suis athée, mais je n'ai pas peur ; je vais disparaître entièrement, mes livres resteront, c'est tout ». Il nous dit aussi qu'il va vraiment arrêter d'écrire. Cet « Homme de passage » qui est son dernier livre sera réellement le dernier. Il se termine d'ailleurs par la mort de celui qu'il faut bien appeler l'auteur, puisqu'en autofiction la distinction auteur-narrateur est quasiment inexistante. Après la représentation, j'aurai avec lui une conversation passionnante, au cours de laquelle il me répètera qu'il a décidé de ne plus écrire. « J'ai perdu l'élan vital », me dit-il. Et moi je pense que cette perte-là du désir d'écrire, du besoin d'écrire, c'est quelque chose qui déjà ressemble à la mort (ou qui l'annonce ?).
Quand vient le tour de Camille Laurens de faire les frais des élucubrations verschooriennes, après un petit jeu de chaises musicales qui n'augure rien de bon, je me dis que parler après Serge Doubrovsky ne doit pas être tâche aisée, tant il s'est montré disert, intéressant, attachant. Mais très vite, je suis conquise. Elle aussi se montre d'une érudition et d'une intelligence séduisantes. « J'appartiens à l'autofiction » nous dit-elle d'emblée. Mais ça, on le savait déjà. Nicole Verschoore lui parle du thème de la répétition dans son dernier ouvrage, « Encore et jamais », sous-titré « Variations », ce qui nous vaut un exposé passionnant sur ce sujet… avec, et c'était prévisible, des références à la psychanalyse, mais aussi à la philosophie. Dans la vie, nous dit-elle, la répétition est très fréquente, à la fois sous l'angle positif et sous l'angle négatif, la répétition étant le fond même de la névrose. Et de citer sa grand-mère et ces mille tâches répétitives qui constituaient en ce temps-là la vie d'une femme, tâches que l'on peut habiter, auxquelles il est possible de donner de la densité.
Comme Serge Doubrovsky, elle fait référence à des événements très personnels qui se trouveraient à la source de sa psychanalyse et de son implication dans l'autofiction : un abus sexuel subi dans l'enfance, la recommandation de sa grand-mère de « ne jamais en parler », la mort de l'enfant qui a donné naissance (si l'on peut dire) au récit « Philippe » - et aux démêlés très médiatisés avec Marie Darrieussecq. « Êtes-vous d'abord romancière ou d'abord philosophe ? » demande Nicole Verschoore. La réponse – on pouvait s'y attendre – est évidente : « Incontestablement d'abord romancière ». Ce qui ne l'empêche pas de faire référence à Deleuze qui voit, nous dit-elle, la répétition « comme une catégorie de l'avenir », mais aussi à Rabelais et à son « grand jamais » qu'est la mort. J'avoue par parenthèse que je ne connais pas cette dénomination de la mort chez Rabelais ; chez Elsa Triolet, au contraire… Si donc quelqu'un peut m'éclairer et me donner les références du texte de Rabelais où apparaît cette expression, ma reconnaissance lui sera acquise.
Mais revenons aux propos de Camille Laurens. « La mort est la seule chose qui ne se répète pas » nous dit-elle. En jouant comme elle sur le langage, on peut s'interroger sur le sens du verbe « se répéter » dans ce contexte. On peut en effet considérer qu'il est impossible de répéter sa mort comme on répète une pièce de théâtre, mais on peut également considérer que l'on ne meurt qu'une fois (évidemment), et que cette mort unique est bien sûr la seule péripétie que l'homme ne risque pas de traverser deux ou plusieurs fois…
Écouter Camille Laurens et Serge Doubrovsky c'est, d'une certaine manière, se sentir plus intelligent. Ils m'ont donné en tout cas envie de lire et de relire, et envie d'écrire encore et toujours, même si jamais – je pense – je ne produirai d'autofiction
Ensuite, « verre de l'amitié ». Tout le monde se jette sur le pain-surprise et sur le vin. Les auteurs se font désirer, monopolisés, comme toujours dans ce genre de circonstance, par l'un ou l'autre bavard ou par quelque fâcheux. Quand enfin ils se mêlent à la troupe des ancêtres qui bavardent tout en faisant un sort aux victuailles solides et liquides, je constate avec étonnement que Serge Doubrovsky n'est guère pris d'assaut, au contraire de Camille Laurens. Je m'approche de lui, le salue, lui dis mon intérêt pour son exposé et mon plaisir à l'avoir enfin rencontré. S'ensuit une conversation presque amicale et tout à fait naturelle. Il est d'une gentillesse et d'une simplicité – et même d'une sincérité – désarmantes, répondant sans détour à mes questions qui ne sont pas toutes exclusivement littéraires. Nous parlons, puisqu'il a lui-même abordé le sujet, de la responsabilité morale et éthique de l'auteur d'autofiction, de la mort de sa première épouse qui n'a pas supporté, explique-t-il, ce qu'il a écrit d'elle. De toute évidence, il parle aussi bien (et aussi volontiers, même à l'inconnue que je suis pour lui) qu'il écrit, et de choses infiniment personnelles. Bizarrement, j'éprouve un vrai plaisir à discuter avec lui. Il est charmant, vif, intéressant, sympathique (au contraire de ce que j'imaginais sur base de mon peu de goût pour le genre qu'il a inventé). Il est aussi très jeune, pour un homme de 85 ans, et je me surprends à penser que je comprends mieux son succès auprès des femmes. Sa jeune épouse, d'ailleurs, celle qu'il nomme joliment « Élisabeth II » et qui avoue 40 ans de moins que lui, est tout aussi charmante.
J'approche Camille Laurens que je sauve des confidences d'une dame « qui est écrivain mais ne publie pas » : « pourtant tout le monde me le conseille, surtout mon curé » ajoute-t-elle. Cela me fait rire et me rappelle une scène vécue et naguère racontée dans mes « Instants de Femmes » (« Exhibition »), tant il est vrai que le public de ces manifestations littérairo-mondaines est universel et interchangeable. Je salue l'écrivain et non l'écrivaine, car je me refuse, quoi qu'en puissent dire Michèle Lenoble-Pinson et même André Goosse, à féminiser ce terme et quelques autres. Je lui dis qu'il m'arrive de lire sur Facebook l'un ou l'autre écho la concernant. Ah, me répond-elle, nous sommes donc amies sur Facebook ! Moi qui songeais très sérieusement à me désinscrire de ce réseau dont je reparlerai ailleurs, me voici aussi surprise qu'honorée de me trouver « amie » de l'une des vedettes de la soirée. Remarquez : pour un écrivain, compter au rang des « amis » d'une jurée du Prix Femina, ce n'est pas à dédaigner !
Quelques mots, beaucoup de gentillesse là aussi, puis je m'en retourne vers le Parc Royal et ma voiture, contente de ma soirée malgré le spectacle déprimant d'une intellectuelle mais inéluctable vieillesse qui nous guette tous.
C'est ceux qui assistaient à cette soirée que j'évoque ici, vous l'aurez compris, et non les deux écrivains invités
La Foire du Livre de Bruxelles
- Par Liliane Schraûwen
- Le 09/03/2013
- Commentaires (0)
- Dans De la littérature
Jeudi, les choses sérieuses ont commencé. Je veux dire que les portes se sont ouvertes aux vrais amateurs de livres. Qui donc prétend que les gens ne lisent plus ? Comme chaque année, les visiteurs se bousculent (surtout aujourd’hui, samedi). Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, enfants et ados se pressaient dans les allées. Comme chaque année encore, il y avait une file interminable de fans en folie qui serraient contre leur cœur le dernier opus de notre Amélie nationale, toujours vêtue de noir, les lèvres peintes d’un rouge agressif, et coiffée de son inénarrable chapeau. D’autres plumitifs au rang desquels je figure attendaient le chaland devant quelques livres qui n’intéressaient pas grand-monde. Surtout mon petit dernier, « trop gros » à ce que j’ai entendu.
La joie, quand même, de revoir des amis, des confrères ; le plaisir de « parler boutique », et celui de rencontrer, pour ne citer que ces deux-là dont j’admire le talent, Véronique Olmi et Joël Dicker.
Quelques contacts aussi, ce qui n’est pas à dédaigner.
Fatigant, parfois excitant pour l’esprit, plaisant lorsqu’on retrouve ou découvre d’autres auteurs sympathiques et intéressants. Rassurant, aussi, de constater le vrai succès de vrais écrivains, à côté de ces vedettes championnes des ventes (je pense une fois de plus à Joël Dicker, pour ne citer que lui). Comme quoi le public n’est pas universellement, euh, comment dirais-je… « con » serait-il le terme adéquat ?
Mais quand même, ai-je pensé, comment faire si l’on écrit des livres « trop gros », si l’on n’aime pas les chapeaux noirs et moins encore les fruits pourris ou le thé noir, si l’on se refuse à composer le cocktail constitué d’un peu d’amour – un zeste d’exotisme – un soupçon de fantastique – une dose d’intrigue policière – des dialogues nombreux – des clichés à profusion – une masse de bons sentiments – un nombre appréciable de fautes d’orthographe et de style, qui fait aujourd’hui le succès des best-sellers ? Comment faire connaître mon existence aux lecteurs et, d’abord, aux médias qui vont les inciter à me lire ?
Ce n’est pas l’amaigrissement annoncé et programmé des pages « livres » du Soir qui va arranger les choses, bien entendu. Triste pays que celui dans lequel la littérature se voit ainsi rabotée, du moins dans le plus grand de nos quotidiens.
Puisque le thème de cette année est celui des écrits meurtriers, je me demande si, demain, je ne devrais pas trucider devant les caméras de télévision quelque pseudo-journaliste ou quelque critique qui m’ignore ou, mieux encore, le rédacteur en chef ou le décideur de telle ou telle publication dans laquelle la culture se verra tout prochainement réduite à la portion congrue ? Ainsi ferais-je d’une pierre deux ou trois coups. J’attirerais l’attention sur moi tout en m’intégrant parfaitement dans le thème meurtrier de la Foire 2013, ce qui serait tout bénéfice pour mon œuvre ; je me retrouverais au fond d’une cellule où rien ne viendrait plus me distraire de la seule occupation qui me console un peu d’avoir dû quitter mon métier ; et j’y serais blanchie et nourrie, sans nul besoin de chercher désespérément comment boucler mes fins de mois.
Si quelqu'un a une autre idée, qu’il n’hésite pas à me la suggérer. En attendant, je vais enfouir dans mon sac le grand couteau à désosser la volaille qui dort dans un tiroir. Ça peut toujours servir…
Il me reste deux jours pour accomplir mon forfait. Cela devrait suffire.
Dans l'abîme de la mise en abyme
- Par Liliane Schraûwen
- Le 16/02/2013
- Commentaires (0)
- Dans De la littérature
Cette série est sympathique et attrayante. Les énigmes policières ne sont ni pires ni meilleures que la plupart de celles qui constituent la trame d’autres séries, mais les personnages sont décalés et, surtout, bien campés. Nathan Fillion et Stana Katic sont parfaits dans leurs rôles respectifs. L’humour, l’ironie, le second degré forment l’un des ingrédients principaux de Castle, et l’un comme l’autre des deux comédiens maîtrisent harmonieusement ce registre.
Bref, Castle est un agréable divertissement dont l’un des charmes, pour moi en tout cas, se trouve dans la condition d’écrivain du héros. Et cela même s’il s’agit d’un écrivain très américain, presque une caricature à force de cumuler tous les stéréotypes de ce que peut imaginer le public au sujet de cette activité (qui, dans son cas, est un métier à part entière) : célèbre, il jouit d'un incroyable succès. Il est d’ailleurs doté d’un grand talent (c’est du moins ce qu’il affirme lui-même avec un manque de modestie qui caractérise son personnage). Séduisant, ce qui ne gâte rien, il a de nombreuses amitiés dans tous les milieux ; il gagne des sommes astronomiques grâce à ses livres, vit dans un magnifique appartement, ne connaît aucun souci… sinon celui d’arriver à nouer avec Kate Beckett la relation à laquelle il aspire alors qu'elle se dérobe. Bien sûr, vu l'existence trépidante qui est la sienne, on peut se demander quand il trouve le temps d’écrire tous les ouvrages dont il est l’auteur, mais foin du réalisme et des contraintes du dur labeur de l’écrivain ! Nous sommes dans une série télé, pas dans la vraie vie, et rien n’interdit de rêver.
Sauf que… sauf que, depuis peu, le rêve semble avoir colonisé la réalité, car on peut acheter et même lire les œuvres de Richard Castle. Celles-là mêmes dont il est question dans la série, et notamment le premier Nikki Hard, abondamment cité dans le feuilleton et intitulé « Vague de chaleur ». Richard Castle, l’auteur fictif d’une fiction télévisuelle, a pris chair. Il existe, il est vivant autant qu’on peut l’être quand on a son nom sur la couverture d’un livre ou quand on possède un site Internet. Si, si, je vous assure. Allez donc le vérifier en visitant la FNAC.
Génial, me suis-je dit, au sens premier de ce mot. À ma connaissance, c’est la première fois qu’un tel phénomène se produit. Des « novélisations » de films ou de séries télé, on en trouve à la pelle, toujours calamiteuses sur le plan du style autant que sur celui du contenu, tant il est vrai qu’il existe un abîme entre un film ou un téléfilm et un livre, entre un scénario et un roman, entre le texte et l’image…
Certes, cela fait longtemps que les éditeurs ont appris à surfer sur la vague de l’un ou l’autre succès littéraire, grâce notamment à ces « produits dérivés » mentionnés aujourd’hui dans tous les contrats d’édition : figurines à l’effigie de l’un ou l’autre personnage de BD ou de roman, vêtements, gadgets en tout genre, adaptations diverses… Ce n’est pas Harry Potter qui me contredira.
Mais ceci, il fallait y penser ! Créer de toutes pièces un écrivain, publier sous son nom les œuvres qui lui sont attribuées dans la série (et il y en a déjà un fameux paquet) : sur le plan du marketing, c’est une trouvaille extraordinaire.
Le réalisme est poussé jusqu’à faire figurer sur la première et la quatrième de couverture les commentaires flatteurs de James Patterson et de Stephen J. Cannell qui, comme on le sait, sont quant à eux de vrais auteurs de thrillers (parmi les meilleurs vendeurs de livres et les mieux payés des écrivains américains, sans préjuger de leur talent dont je ne puis rien dire, ne les ayant jamais lus). Ils apparaissent d’ailleurs « en vrai » dans certains épisodes, jouant leur propre rôle d’amis et de pairs du beau Richard.
Ça, c’est la meilleure mise en abyme que j’aie jamais rencontrée. Dommage que je n’enseigne plus, j’aurais construit là-dessus un cours passionnant.
Que l’on se rassure cependant, je n’ai pas poussé l’enthousiasme jusqu’à acheter les œuvres de l’écrivain fictif. Quelqu'un m’en a dispensée, me prêtant généreusement « Vague de Chaleur ». Je ne suis amatrice ni de polars, ni de romans noirs, ni de thrillers (à moins qu’ils soient écrits par Stephen King, bien sûr), mais j’ai quand même ouvert le livre. Je l’ai feuilleté, j’ai commencé à lire. Il faut avoir l’esprit large, n’est-il pas ? Et puis, qui sait, il existe peut-être, caché derrière Castle, un véritable écrivain ; quelquefois les nègres ont du talent, et j’aurais aimé cela, qui aurait ajouté une vraie touche de vrai génie à la géniale idée-marketing qui a présidé à ces publications.
Hélas, rien de tel dans les deux cent cinquante pages qui me sont tombées des mains. Tous les défauts du (mauvais) genre, au contraire. Des dialogues à la louche, des adverbes et des adjectifs à profusion, de quoi remplir suffisamment de papier pour que l’on puisse considérer ce désastre comme un « livre ». Des fautes de style sans nombre, des répétitions liées à une évidente pauvreté de vocabulaire, des pléonasmes généreux, des « on » pour des « nous » et des « nous » pour des « on »…. Quant à l’intrigue, disons qu’elle est… faible (litote ou euphémisme ?), du moins pour ce qu’un survol rapide m’a permis d’en juger.
Nikki et Rook, les deux personnages, parlent comme Kate et Richard dont ils sont de (très) mauvais clones. Mais ce qui, grâce notamment au jeu des comédiens et à la mise en scène, passe plutôt bien à la télé, dans une fiction d’action et de suspense, devient calamiteux à l’écrit. La forme est absolument consternante, sans que je puisse savoir si la faute en revient au nègre ou à sa traductrice. Qu’on en juge : « au moment où elle ressentit les rebords déchiquetés du trou qu’on avait percé dans sa vie, le lieutenant Nikki Heat était enfin prête », et cela dès la première page du premier chapitre. Six lignes plus bas, on peut lire que « toutes les scènes de crime avaient un parfum de chaos » (ça sent quoi, le chaos ???). Poursuivons et tournons la page : on nous parle d’une « boisson glacée dont le nom se terminait par une voyelle ». Bigre ! Voilà qui est intéressant…
Sachez aussi que « Nikki s’échappa de l’étreinte de son agresseur, se retourna et lui flanqua le talon de sa main libre dans le nez » ; « elle se retourna [quand je vous disais que le vocabulaire était pauvre], balança un grand coup de pied rotatif… » ; « elle se retourna [encore !!!] et croisa le retard de Raley dans la cour »… Plus poétique que ça, tu meurs !
Quant à l’orthographe (et là, c’est évidemment la traduction qui est en cause), elle est… approximative, c’est le moins qu’on puisse dire. Nouvelle litote.
Mais tout cela, finalement, n’est pas bien grave, et ne me choque guère. Car personne ici, si l’on excepte Richard Castle qui n’existe pas, ne parle de littérature. Personne ne joue au grand écrivain, à l’artiste incompris, au génie méconnu. Personne ne se prend au sérieux. Il est juste question de vendre du papier en se laissant porter par la vague du succès d’une série qui marche. Remarquez, il y a de l’idée : à quand la création d’un serial killer qui ressemblerait à Dexter ? Mais cessons de plaisanter : je maintiens que l’idée de créer l’écrivain qui dans la série écrit les romans que vous trouverez désormais dans tous les supermarchés du Royaume et de la République, notre voisine, est fascinante. Déplorons seulement la piètre qualité des livres ainsi produits, mais il me paraît évident que le but premier de leurs auteurs et de leurs éditeurs n’est pas de révolutionner l’art littéraire…
Au moins, tout cela est honnête, et me consterne bien moins que les airs penchés de certains « écrivains » français qui, modernes ersatz de feu Guy des Cars, font semblant de croire à leur talent sinon à leur génie. Rappelez-vous : ce même Guy des Cars qui affirmait être un écrivain plus important et plus véritable que bien d’autres que personne ne lisait, alors qu’il atteignait, quant à lui, de formidables chiffres de vente. Vous me direz qu’à ce titre, la plupart des auteurs publiés par Harlequin mériteraient le Nobel de littérature, mais il faut savoir de quoi l’on parle : d’art ou d’argent ? De succès commercial ou de légitimité artistique ? Bourdieu avait très bien compris tout cela. Quoi qu’il en soit, face à la cuistrerie des vendeurs qui se prennent pour ce qu’ils ne sont pas, je me trouve partagée entre le rire et l’agacement. Comme si l’un ou l’autre barbouilleur de cartes postales prétendait rivaliser avec Van Gogh, arguant du fait que ce dernier n’a quasiment rien vendu de son vivant, alors que le maître ès cartes postales, par contre…
Non, décidément, je préfère Castle qui n’existe pas, qui ne cache pas son jeu, et qui ne se considère comme un génie que sur le petit écran et, justement, dans la fiction. Sa vanité d’ailleurs ajoute au côté un peu ridicule de son personnage.
Je pourrais m’arrêter là, sur cette mise en abyme somme toute assez réjouissante, et passer sous silence les Levy et autres Musso…
Mais le hasard a voulu que, après avoir abandonné la « Vague de chaleur » qui ne m’a guère réchauffée en ces temps de frimas, j’ai ouvert un autre livre, signé d’un écrivain véritable dont je tairai le nom par charité, et par prudence aussi. Car le monde de la littérature et de l’édition est tout petit, et je ne souhaite pas m’y faire d’ennemis trop puissants. Oui, je sais, vu le peu de lecteurs de ce blog, et l’infime proportion de « commentaires » à mes « posts », commentaires qui sont généralement le fait d’amis pris de pitié pour le silence des espaces infinis où trop souvent je navigue, je ne risque pas grand-chose.
Quand même : on n’est jamais trop prudent. En outre, j’ai de la sympathie pour l’auteur dont je voudrais vous parler maintenant, et même une certaine admiration, du moins jusqu’à aujourd’hui. J’ai lu plusieurs de ses œuvres sans qu’elles me tombent des mains, au contraire de celles de Marc Levy ou des volumes de chez Harlequin. Car de celui dont je vous parle ici, j’ai toujours les qualités littéraires, et professé qu’il était un écrivain véritable, un écrivain de talent.
Mais voici qu’il publie un ouvrage qui…, un ouvrage que…, comment dire ??? Un ouvrage différent de ceux que, depuis plus de trente ans, il nous a proposés, c’est le moins qu’on puisse dire. Un ouvrage qui n’a rien à voir non plus avec les recueils de poèmes qui ont également fait sa notoriété. Un ouvrage… oserais-je le dire, un ouvrage bâclé. Mal écrit, mal relu. Là aussi, comme chez Castle qui a le mérite, au moins, de ne pas exister, des kilos de répétitions. Pourtant, celui-ci est un styliste, un vrai. Il l‘a prouvé. Certes, ses œuvres précédentes étaient moins ambitieuses, du moins en ce qui concerne le nombre de pages. Intimiste, voilà ce qu’on disait de lui. Et ce n’était pas un reproche…
Notre intimiste cette fois a commis quelque trois cents pages quand cent, voire moins, auraient amplement suffi. Trois cents pages qui auraient dû être sévèrement relues. Cela nous aurait évité trois « que » en deux lignes (p. 31), et de nombreuses autres maladresses qui sont, en réalité, de vraies fautes de style et de syntaxe, du genre : « C’est en conduisant ses nièces à l’école primaire que C avait fait la connaissance de J qui y conduisait les siens ». Aïe : deux « conduire » un peu trop rapprochés à mon goût ; quant aux « siens », sont-ils les pendants masculins des « nièces » précitées ?
Je ne m’attarderai pas sur les répétitions de « jamais », de « voir », de « elle », de « volonté » (toujours à une ou deux lignes d’intervalle), de « maison (quatre fois en dix lignes), etc. Il y a même des phrases qui sont reprises intégralement à neuf lignes de distance, si si, je vous assure. À quoi bon insister sur ces innombrables faiblesses ? J’ai bien assez des barbarismes et autres impropriétés qui fourmillent dans ces pages décidément trop nombreuses. Qu’on en juge : « personne n’eut envie de rouvrir tout de suite les lumières », alors qu’il suffisait de la rallumer (la lumière) ou de les rallumer (les lampes), en ouvrant les portes ou les huitres, selon le cas. Je n’insisterai pas trop non plus sur le « feu qui commençait doucement à s’éteindre » (n’ayons pas peur des clichés !), dans un « silence paisible » (et pléonastique, sans aucun doute). Mais que penser de ceci, qui aurait valu au plus crétin de mes étudiants une note féroce assortie de quelque commentaire peu flatteur : « M payait un loyer pour la partie de la maison où il s’était installé avec ses enfants après le décès de son épouse ; la plus grosse partie [de quoi ? de la maison ?] était couverte par la participation des gens qui utilisaient les locaux… ».
Rien à faire. Comme l’ont dit bien des auteurs avant moi, et non des moindres, ce qui transforme un amalgame de feuilles couvertes de mots en une œuvre, en un livre, en littérature, c’est d’abord et avant tout sa qualité d’écriture : « Le style n'est pas, pitié!, une valeur ajoutée au produit littéraire, il est l'âme et la raison d'être du texte. » (François NOURRISSIER in Le Point [26/4/1997]) ; « Je crois qu’écrire, c’est une question de style. Vous connaissez, mieux que moi, les jeunes gens qui arrivent chez un éditeur en disant ‘ J’ai une histoire merveilleuse ‘, ou pire : ‘ Ma vie est un roman. ‘ Oui, c’est ça… Ce ne sont pas les histoires qui font la littérature, c’est le style. » (Jean d’ORMESSON interviewé par Thierry RICHARD in Le Magazine des Livres n° 23 [mars/avril 2010]) ; « La littérature sans le style, c'est d'un triste! » (Héléna MARIENSKÈ interviewé par Jacques de DECKER in Les Livres [supplément littéraire du Soir, 1/2/2008])…
Voilà pourquoi je n’ai pas réussi à dépasser la page 75 du livre de cet écrivain que cependant j’admire – en général. Voilà pourquoi je préfère, finalement, Castle et les géniaux promoteurs de cette série qui, au moins, jouent cartes sur table.
Mais que font donc les critiques ?
- Par Liliane Schraûwen
- Le 08/12/2012
- Commentaires (0)
- Dans De la littérature
Un livre, qu’est-ce d’autre qu’un produit que l’on vend, que l’on achète, que l’on brade ou que l’on solde ? Il peut faire l’objet de campagnes de pub, ni plus ni moins que toutes ces marchandises dont on nous vante les mérites à la télé, sur Internet ou dans les magazines que l’on feuillette sans les lire – car l’homme aujourd’hui ne lit plus guère. Des couches pour bébés, des montres et des bijoux, du lait, des céréales, des confiseries, des cosmétiques (car nous le valons bien), des smartphones, des tablettes numériques et autres iPad, des voitures, des jouets, des protections hygiéniques et des tampons périodiques, des produits de nettoyage… Des D.V.D., des C.D. Et des livres.
Les talk-shows se suivent et se ressemblent. Fogiel après Ardisson, Ruquier après Fogiel, le tout mâtiné de Bafie ou de Bedos-le-fils. Le meneur de jeu (choisi sans doute sur sa capacité à ricaner de tout et de rien, à moins que ce soit sur sa propension à tenir des propos graveleux) est immanquablement encadré de l’un ou l’autre roquet payé pour briller aux dépens d’invités inconscients ou masochistes. Et peu importe qu’ils se nomment Éric Zemmour, Guy Carlier ou Éric Nauleau, l’essentiel restant leur agressivité gratuite et ce qu’on appelle « l’esprit français », à savoir un savant mélange d’ironie facile et de méchanceté acide, le tout chapeauté par un côté « grande gueule » qui ne laisse aucune chance à leur interlocuteur. Les victimes se succèdent : comédien ou rappeur en période de promo, ancienne star du X, humoriste égrillard ou libidineux, homme politique, fils ou fille de, pseudo-vedette d’une quelconque émission de téléréalité, ex-miss France, footballeur ou rugbyman, playboy décervelé, top modèle siliconé, présentateur télé plus ou moins ringard en quête d’une nouvelle notoriété… Et parmi tous ces people, chaque semaine, l’un ou l’autre plumitif dont on se demande ce qu’il est allé faire dans cette galère. Nègre, biographe, journaliste, scribouillard, romancier ou théâtreux à la mode, auteur de pamphlet ou de biographie non autorisée viennent joyeusement se faire étriller par de soi-disant « chroniqueurs » qui ne sont là que pour se mettre en valeur à leurs dépends. Quelquefois, perdu dans ce troupeau, un écrivain. Je veux dire quelqu'un qui a un tout petit peu de talent et qui, sans doute, se trouve parachuté là par un éditeur en quête de publicité facile.
Car les livres, de nos jours, même les vrais, ceux que l’on a plaisir à lire et que l’on peine à lâcher, ceux qui nous touchent et nous émeuvent, sont bien des produits. Rien de plus. Des produits culturels, certes, servant d’alibis à ces consternantes émissions. C’est à ce titre qu’ils ont la vie brève. Entre le placement en librairie et le retour des invendus à l’éditeur, combien de temps s’écoule-t-il ? Un mois, deux ? Guère plus. Après quoi d’autres nouveautés s’installent dans les rayonnages et sur les tables, prétendus mémoires de célébrités, ouvrages de « développement personnel » ou d’ésotérisme, essais politiques, livres de vulgarisation très justement sous-titrés « pour les nuls », conseils amoureux ou pédagogiques, prix littéraires de l’année, recueils de princiers ragots et de royales rumeurs…
Imaginez cela. Un mois ou deux de vie, pour un livre que son auteur a mis, parfois, plusieurs années à construire. Une œuvre, et peu importe qu’elle soit médiocre ou géniale, une œuvre remplie de rêve et de folie, une œuvre de peine, d’amour et de haine. Des pages et des pages d’efforts, de ratures, d’hésitations, de remords, de doutes, d’espoirs et de regrets. Des mois, des années de travail.
On choisit des mots comme on choisit des pierres précieuses. On les polit avec amour, on les enchâsse au creux de phrases longuement ciselées, on efface, on recommence. Les chapitres s’ajoutent aux chapitres. Cela commence à ressembler à un livre, dans lequel on se met tout entier. Un livre qui sent la sueur et la peine, quelquefois, et le sang. Ou bien un livre qui chante dans l’été et ses pages alors frémissent sous la brise parfumée. On y parle de soi, on s’y cache, on s’y révèle. On y raconte ses blessures et ses peurs. On y réinvente le monde et la vie. Tout cela tremble et palpite, et l’auteur se promène dans les librairies, étonné et ému de lire quelquefois son nom sur une couverture cartonnée, au détour d’une travée.
Mais après quelques semaines à peine, les libraires remballent tous ces rêves dans de grandes boites en carton, et les remplacent par d’autres, tout aussi éphémères.
Alors, pour qu’un livre ait une toute petite chance de trouver son public et d’échapper à ces modernes autodafés, il lui faut un peu d’aide. Un peu de lumière. Un coup de projecteur. Afin que quelqu'un, quelque part, sache qu’il existe et, peut-être, ait envie de le prendre en main, de le feuilleter, de le lire. Juste un peu de lumière. Quelques mots, quelques lignes dans un journal.
Les critiques sont là pour ça. Pour informer leurs lecteurs qu’un livre est né. Pour dire ce qu’ils en pensent. Du bien, ou même du mal, pourquoi pas ? C’est leur métier. Lisez-le, vous y rencontrerez un être humain semblable à vous. C’est à vous qu’il s’adresse. C’est de vous qu’il parle.
C’est pour cela que les éditeurs envoient des services de presse aux principaux médias, ces mêmes services de presse que l’on retrouve très vite dans les rayonnages des bouquineries, le plus souvent sans qu’ils aient été lus ni même feuilletés. Allez donc faire un tour rue du Midi ou boulevard Lemonnier en période de rentrée littéraire, vous verrez…
Combien de romans, sur les étals des librairies, entre la fin du mois d’août et le début du mois de décembre ? Entre six cents et mille, au bas mot. Parmi eux, le mien, le petit dernier. Perdu dans la masse, noyé, englouti.
Bien sûr, on peut comprendre que les critiques n’ont guère le temps de parcourir ou ne serait-ce que d’ouvrir ces centaines d’ouvrages. Est-ce une raison cependant pour que, tous médias confondus, ils se jettent sur les dix ou quinze bouquins dont tout le monde parle, et les commentent ensemble, sur le même ton et de la même voix ? Est-ce même utile car, après tout, on se doute bien que le Goncourt de l’année ne manque pas de qualités, et que le dernier Olivier Adam mérite le détour. Nul besoin de la caution d’un critique pour s’en assurer. On sait aussi qu’il est de bon ton de comparer le récent opus de notre Amélie nationale à son prédécesseur de l’année dernière. Que surgisse un nouveau Florian Zeller ou un Christine Angot tout neuf, que paraisse l’un ou l’autre Laurent Gaudé, Virginie Despentes, Philippe ou Patrick Besson, Frédéric Beigbeder ou Philippe Djian, et voilà que s’agitent les pages littéraires de nos quotidiens, que frétillent les magazines spécialisés. Alors, pensez donc, un modeste « Schraûwen », petit roman belge né du travail d’un auteur peu connu, sans nul scandale pour le porter : comment imaginer qu’on lui consacre ne fût-ce qu’un tout petit encart ?
Mais ne soyons pas injustes. J’ai eu droit à quelques lignes dans Le Soir, et à une très belle critique dans La Libre Belgique. Les deux principaux quotidiens belges ont parlé de mon dernier opus, et je les en remercie. Mais les autres ? Tous les autres ? Les journaux moins importants ? Les quotidiens français ? Les magazines, littéraires ou non, d’ici ou d’ailleurs ? Les émissions culturelles de la télé et de la radio belges ? Celles que l’on écoute en France ? Rien. Niets. Nothing. Nada. Le silence du vide et de la mort…
C’est ainsi que personne ou presque n’aura entendu parler de ce livre qui vaut ce qu’il vaut, ni plus ni moins, mais qui n’est pas pire que bien d’autres. Personne par conséquent n’aura l’idée de le commander à la FNAC où d’ailleurs il ne figure dans aucun rayon, pas même dans celui, à peu près invisible, consacré à la « littérature belge ». Personne non plus ne l’achètera. Personne ne le commandera sur Internet. Ce qui revient à dire que personne ne le lira. Mort, le dernier « Schraûwen ». Plus exactement : mort-né. Comme bien d’autres.
Que faut-il faire, dites-moi, pour exister en tant qu’écrivain dans notre petit pays… et dans les autres ? De toute évidence, il ne suffit pas d’avoir été publié. Ni d’avoir, par le passé, été couronné de quelque prix. Ni d’avoir derrière soi, déjà, quelque chose qui ressemble à « une œuvre ». Ni même, je le crains, de posséder une miette de talent.
Mais entendons-nous. Je ne voudrais pas que se méprennent les rares lecteurs de ce blog presque aussi peu connu que son auteur. Je ne rêve pas de gloire. Aucun désir chez moi de me trouver poursuivie par des hordes de paparazzi en fureur, ni de voir mon nom ou mon image briller sur papier glacé. Et je vous le dis tout net : si par extraordinaire je devais un jour être sollicitée par un quelconque Ruquier, je déclinerais poliment l’invitation, et cela même si l’affreux Zemmour et le sinistre Nauleau ont – grâce à Dieu – déserté son plateau.
Mais quand même… J’écris des livres. J’ai la chance de les voir publiés. Est-ce trop demander que de désirer, en sus, qu’ils soient lus ? N’écrit-on pas toujours, d’une certaine manière, à quelqu'un ? Pour quelqu'un ? Ne s’adresse-t-on pas, dans toutes ces pages et à travers tous ces mots que l’on aligne, aux autres ?
Alors, oui, je suis en colère. Et triste. Et déçue. Un peu comme celui qui envoie à un ami une lettre qui n’arrivera jamais… parce que le facteur a mal fait son travail. Pour un écrivain, ce facteur paresseux, ce peut être le critique. Qu’ils fassent donc leur boulot, ces professionnels de la chose littéraire : qu’ils lisent, qu’ils découvrent, qu’ils cherchent, au lieu de se contenter de digérer d’abord les avis de leurs confrères afin de ronronner avec eux.
J’ai noté récemment cette phrase de Douglas KENNEDY interviewé par Raphaëlle RÉROLLE (dans Le Monde des Livres du 25 mai 2012) : « L'écriture est un acte public. J'écris exactement ce que je veux, mais je le fais pour mes lecteurs, c'est évident. Pas pour le marché, pour eux ». Un acte public… On ne saurait mieux dire. Nous en sommes tous là : nous écrivons pour nous-mêmes, d’abord, mus par une nécessité quasi-pathologique. Et en même temps, nous écrivons pour les autres, proches et lointains, familiers et inconnus. Pour nos « frères humains ». Pour ceux qu’on appelle « le public ». Pour leur parler, pour les toucher,
Encore faudrait-il arriver à l'atteindre, ce public.







